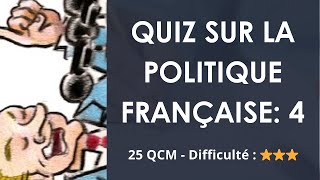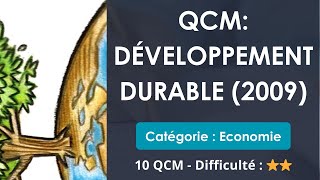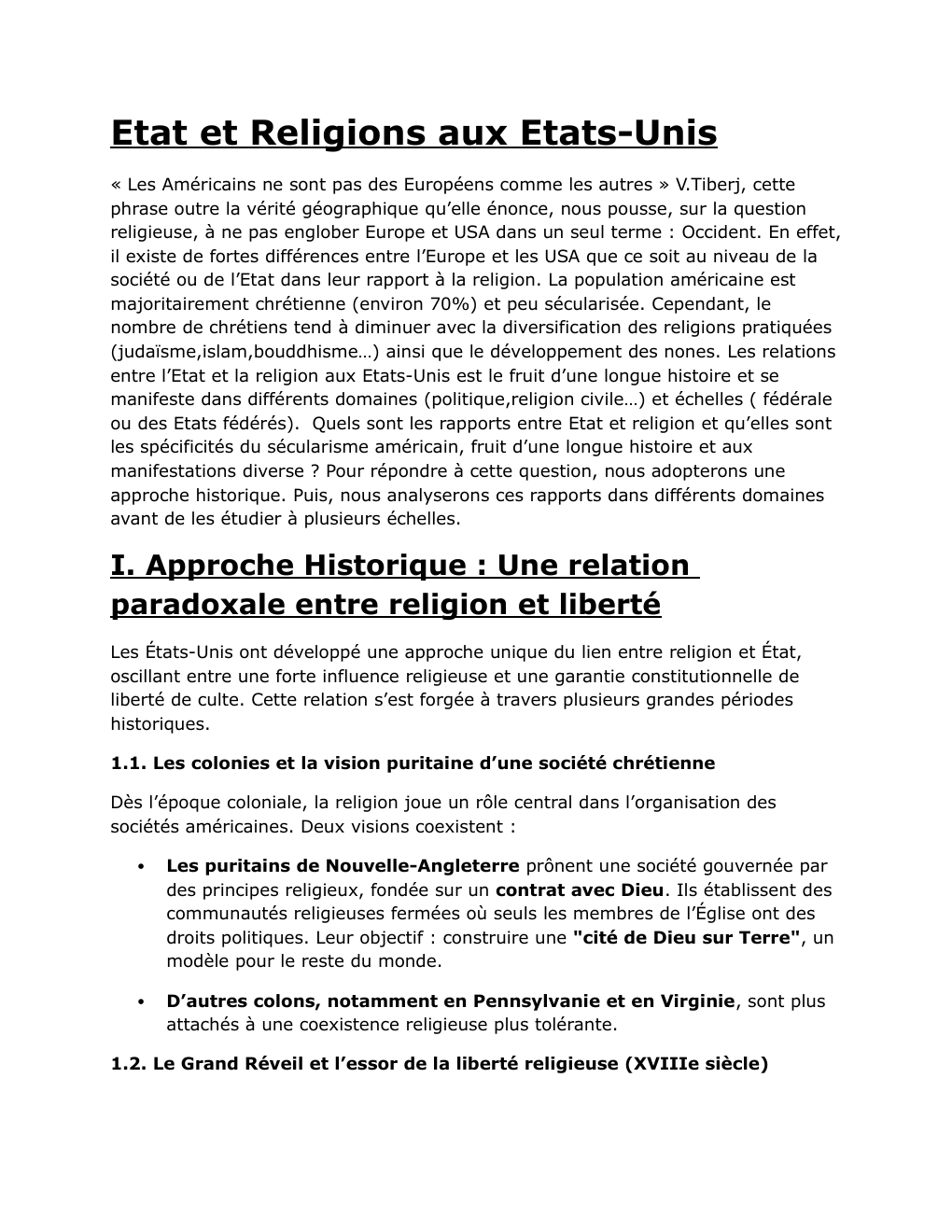Etats et religions aux USA
Publié le 21/03/2025
Extrait du document
«
Etat et Religions aux Etats-Unis
« Les Américains ne sont pas des Européens comme les autres » V.Tiberj, cette
phrase outre la vérité géographique qu’elle énonce, nous pousse, sur la question
religieuse, à ne pas englober Europe et USA dans un seul terme : Occident.
En effet,
il existe de fortes différences entre l’Europe et les USA que ce soit au niveau de la
société ou de l’Etat dans leur rapport à la religion.
La population américaine est
majoritairement chrétienne (environ 70%) et peu sécularisée.
Cependant, le
nombre de chrétiens tend à diminuer avec la diversification des religions pratiquées
(judaïsme,islam,bouddhisme…) ainsi que le développement des nones.
Les relations
entre l’Etat et la religion aux Etats-Unis est le fruit d’une longue histoire et se
manifeste dans différents domaines (politique,religion civile…) et échelles ( fédérale
ou des Etats fédérés).
Quels sont les rapports entre Etat et religion et qu’elles sont
les spécificités du sécularisme américain, fruit d’une longue histoire et aux
manifestations diverse ? Pour répondre à cette question, nous adopterons une
approche historique.
Puis, nous analyserons ces rapports dans différents domaines
avant de les étudier à plusieurs échelles.
I.
Approche Historique : Une relation
paradoxale entre religion et liberté
Les États-Unis ont développé une approche unique du lien entre religion et État,
oscillant entre une forte influence religieuse et une garantie constitutionnelle de
liberté de culte.
Cette relation s’est forgée à travers plusieurs grandes périodes
historiques.
1.1.
Les colonies et la vision puritaine d’une société chrétienne
Dès l’époque coloniale, la religion joue un rôle central dans l’organisation des
sociétés américaines.
Deux visions coexistent :
Les puritains de Nouvelle-Angleterre prônent une société gouvernée par
des principes religieux, fondée sur un contrat avec Dieu.
Ils établissent des
communautés religieuses fermées où seuls les membres de l’Église ont des
droits politiques.
Leur objectif : construire une "cité de Dieu sur Terre", un
modèle pour le reste du monde.
D’autres colons, notamment en Pennsylvanie et en Virginie, sont plus
attachés à une coexistence religieuse plus tolérante.
1.2.
Le Grand Réveil et l’essor de la liberté religieuse (XVIIIe siècle)
À partir des années 1740, le Grand Réveil, un mouvement religieux évangélique,
transforme le paysage spirituel américain.
Il met l’accent sur :
Une relation individuelle et émotionnelle avec Dieu.
Une contestation de l’autorité des Églises traditionnelles.
Une vision plus démocratique du leadership religieux.
Ce mouvement favorise la diversité religieuse et affaiblit les anciennes structures
théocratiques.
1.3.
La Constitution et la séparation Église-État
Lors de la rédaction de la Constitution de 1787, les Pères fondateurs adoptent
une position laïque :
Aucune mention de Dieu dans le texte constitutionnel.
Article 6 : interdit d’exiger une profession de foi pour accéder à une fonction
publique.
Premier Amendement (1791) : "Le Congrès n'adoptera aucune loi relative
à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son libre exercice."
Thomas Jefferson parle alors d’un "mur de séparation" entre l’Église et l’État,
bien que la religion continue d’imprégner la culture politique.
1.4.
Le XIXe siècle : Évangélisme et affirmation d’une Amérique chrétienne
Après la Révolution américaine, la religiosité recule, mais un Second Grand Réveil
(1795-1850) relance la ferveur religieuse :
Expansion des églises méthodistes et baptistes.
Forte moralisation de la société (campagnes contre l’alcool, l’esclavage, etc.).
Influence croissante du protestantisme évangélique dans la politique et la
culture.
Ce réveil religieux favorise une vision de l’Amérique comme une nation divine,
destinée à guider le monde.
1.5.
Guerre de Sécession et divisions religieuses
Durant la Guerre de Sécession (1861-1865), la religion joue un rôle clé :
Les Nordistes utilisent la Bible pour justifier l’abolition de l’esclavage.
Les Sudistes s’appuient sur des arguments religieux pour défendre leur mode
de vie.
Après la guerre, les églises du Nord s’engagent dans des réformes sociales, tandis
que celles du Sud restent conservatrices.
1.6.
XXe siècle : Entre modernisme et fondamentalisme
Face à l’industrialisation et aux évolutions sociales, deux courants s’opposent :
Les modernistes veulent adapter la religion aux découvertes scientifiques.
Les fondamentalistes rejettent toute interprétation moderne et défendent
une lecture littérale de la Bible.
En 1925, le procès du singe (Scopes Trial) illustre cette fracture en opposant
l’évolutionnisme et le créationnisme.
II.
Aujourd’hui : la religion dans la
politique, la société et la justice
2.1.
Droite et gauche religieuse
La droite religieuse
Dans les années 1970, l'arrêt Roe v.
Wade (1973) légalisant l’avortement
mobilise les évangéliques conservateurs.
Ils fondent des lobbys influents
(Moral Majority, Christian Coalition) et s’intègrent au Parti républicain.
Avec
Ronald Reagan puis George W.
Bush, ils imposent des thèmes comme la
défense des « valeurs familiales ».
Cela va aussi impacter la politique
étrangère américaine notamment dans la rhétorique consistant à présenter
deux blocs, deux forces : celle du bien et celle du mal.
La gauche religieuse et le réveil démocrate
Face à la droite chrétienne, une gauche religieuse se structure autour de la
justice sociale et des droits civiques.
Barack Obama incarne ce renouveau en
2008 en intégrant des leaders évangéliques progressistes.
Le rôle croissant des "nones"
Depuis les années 2000, les « nones » (Américains sans affiliation religieuse)
représentent 25 % de la population.
Leur part dans la population augmente,
ils sont moins influencés par la religion.
2.2.
La Religion Civile Américaine : Un Facteur Unificateur
Concept défini par Robert Bellah, la religion civile aux États-Unis structure
un socle moral et patriotique sans référence explicite à une confession.
Elle
repose sur :
Des symboles : le serment présidentiel sur la Bible, les devises comme « In
God We Trust ».
Des rites civiques : Thanksgiving, Memorial Day.
Un mythe national : les États-Unis comme nation élue par Dieu.
Elle permet d’unir croyants et non-croyants dans une vision collective de la
démocratie.
2.3 Un Mur de Séparation Fragilisé
De la séparation stricte à l’accommodation religieuse
Dans....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Sujet: Les religions empêchent-elles les hommes de s’entendre ?
- Les Etats Unis, une puissance maritime globale
- N'y a-t-il de religiosité que dans les religions ?
- Pas de religions sans Eglises ?
- L'ORGANISATION DU TERRITOIRE DES ETATS-UNIS