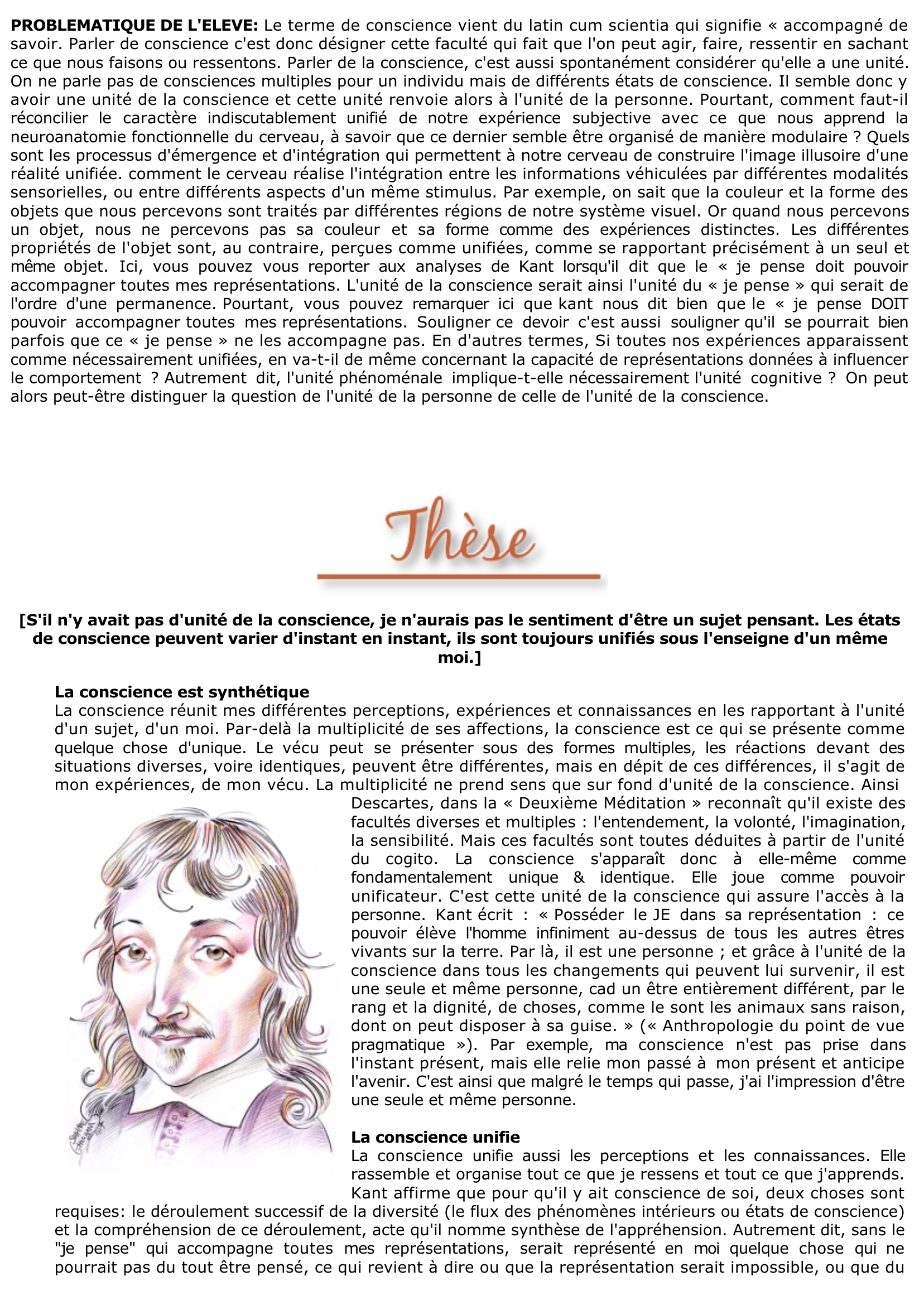Y a-t-il une unité de la conscience ?
Extrait du document
«
PROBLEMATIQUE DE L'ELEVE: Le terme de conscience vient du latin cum scientia qui signifie « accompagné de
savoir.
Parler de conscience c'est donc désigner cette faculté qui fait que l'on peut agir, faire, ressentir en sachant
ce que nous faisons ou ressentons.
Parler de la conscience, c'est aussi spontanément considérer qu'elle a une unité.
On ne parle pas de consciences multiples pour un individu mais de différents états de conscience.
Il semble donc y
avoir une unité de la conscience et cette unité renvoie alors à l'unité de la personne.
Pourtant, comment faut-il
réconcilier le caractère indiscutablement unifié de notre expérience subjective avec ce que nous apprend la
neuroanatomie fonctionnelle du cerveau, à savoir que ce dernier semble être organisé de manière modulaire ? Quels
sont les processus d'émergence et d'intégration qui permettent à notre cerveau de construire l'image illusoire d'une
réalité unifiée.
comment le cerveau réalise l'intégration entre les informations véhiculées par différentes modalités
sensorielles, ou entre différents aspects d'un même stimulus.
Par exemple, on sait que la couleur et la forme des
objets que nous percevons sont traités par différentes régions de notre système visuel.
Or quand nous percevons
un objet, nous ne percevons pas sa couleur et sa forme comme des expériences distinctes.
Les différentes
propriétés de l'objet sont, au contraire, perçues comme unifiées, comme se rapportant précisément à un seul et
même objet.
Ici, vous pouvez vous reporter aux analyses de Kant lorsqu'il dit que le « je pense doit pouvoir
accompagner toutes mes représentations.
L'unité de la conscience serait ainsi l'unité du « je pense » qui serait de
l'ordre d'une permanence.
Pourtant, vous pouvez remarquer ici que kant nous dit bien que le « je pense DOIT
pouvoir accompagner toutes mes représentations.
Souligner ce devoir c'est aussi souligner qu'il se pourrait bien
parfois que ce « je pense » ne les accompagne pas.
En d'autres termes, Si toutes nos expériences apparaissent
comme nécessairement unifiées, en va-t-il de même concernant la capacité de représentations données à influencer
le comportement ? Autrement dit, l'unité phénoménale implique-t-elle nécessairement l'unité cognitive ? On peut
alors peut-être distinguer la question de l'unité de la personne de celle de l'unité de la conscience.
[S'il n'y avait pas d'unité de la conscience, je n'aurais pas le sentiment d'être un sujet pensant.
Les états
de conscience peuvent varier d'instant en instant, ils sont toujours unifiés sous l'enseigne d'un même
moi.]
La conscience est synthétique
La conscience réunit mes différentes perceptions, expériences et connaissances en les rapportant à l'unité
d'un sujet, d'un moi.
Par-delà la multiplicité de ses affections, la conscience est ce qui se présente comme
quelque chose d'unique.
Le vécu peut se présenter sous des formes multiples, les réactions devant des
situations diverses, voire identiques, peuvent être différentes, mais en dépit de ces différences, il s'agit de
mon expériences, de mon vécu.
La multiplicité ne prend sens que sur fond d'unité de la conscience.
Ainsi
Descartes, dans la « Deuxième Méditation » reconnaît qu'il existe des
facultés diverses et multiples : l'entendement, la volonté, l'imagination,
la sensibilité.
Mais ces facultés sont toutes déduites à partir de l'unité
du cogito.
La conscience s'apparaît donc à elle-même comme
fondamentalement unique & identique.
Elle joue comme pouvoir
unificateur.
C'est cette unité de la conscience qui assure l'accès à la
personne.
Kant écrit : « Posséder le JE dans sa représentation : ce
pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres
vivants sur la terre.
Par là, il est une personne ; et grâce à l'unité de la
conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est
une seule et même personne, cad un être entièrement différent, par le
rang et la dignité, de choses, comme le sont les animaux sans raison,
dont on peut disposer à sa guise.
» (« Anthropologie du point de vue
pragmatique »).
Par exemple, ma conscience n'est pas prise dans
l'instant présent, mais elle relie mon passé à mon présent et anticipe
l'avenir.
C'est ainsi que malgré le temps qui passe, j'ai l'impression d'être
une seule et même personne.
La conscience unifie
La conscience unifie aussi les perceptions et les connaissances.
Elle
rassemble et organise tout ce que je ressens et tout ce que j'apprends.
Kant affirme que pour qu'il y ait conscience de soi, deux choses sont
requises: le déroulement successif de la diversité (le flux des phénomènes intérieurs ou états de conscience)
et la compréhension de ce déroulement, acte qu'il nomme synthèse de l'appréhension.
Autrement dit, sans le
"je pense" qui accompagne toutes mes représentations, serait représenté en moi quelque chose qui ne
pourrait pas du tout être pensé, ce qui revient à dire ou que la représentation serait impossible, ou que du.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Tout homme a conscience de son unité. Comment expliquez-vous cette conscience d'unité ?
- Philosophie : Conscience/ Inconscient
- la conscience nous condamne a l'inquiétude ?
- Montrez les différents éléments de l’argumentation qui permettent d’établir que Kant a une conception de la conscience qui se trouve être encore ici d’inspiration cartésienne
- la conscience peut-elle faire obstacle au bonheur ?