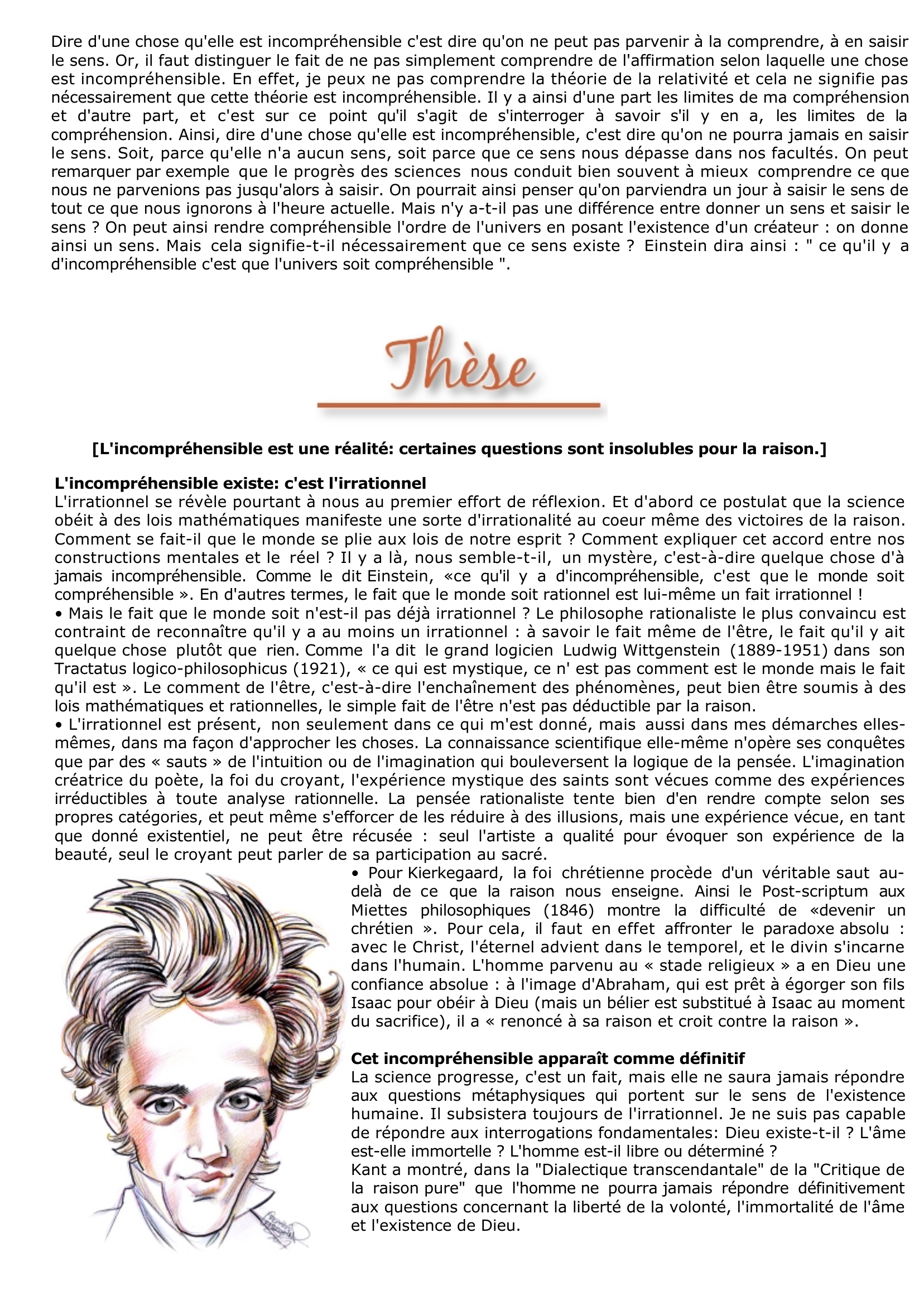Y a-t-il de l'incompréhensible ?
Extrait du document
«
Dire d'une chose qu'elle est incompréhensible c'est dire qu'on ne peut pas parvenir à la comprendre, à en saisir
le sens.
Or, il faut distinguer le fait de ne pas simplement comprendre de l'affirmation selon laquelle une chose
est incompréhensible.
En effet, je peux ne pas comprendre la théorie de la relativité et cela ne signifie pas
nécessairement que cette théorie est incompréhensible.
Il y a ainsi d'une part les limites de ma compréhension
et d'autre part, et c'est sur ce point qu'il s'agit de s'interroger à savoir s'il y en a, les limites de la
compréhension.
Ainsi, dire d'une chose qu'elle est incompréhensible, c'est dire qu'on ne pourra jamais en saisir
le sens.
Soit, parce qu'elle n'a aucun sens, soit parce que ce sens nous dépasse dans nos facultés.
On peut
remarquer par exemple que le progrès des sciences nous conduit bien souvent à mieux comprendre ce que
nous ne parvenions pas jusqu'alors à saisir.
On pourrait ainsi penser qu'on parviendra un jour à saisir le sens de
tout ce que nous ignorons à l'heure actuelle.
Mais n'y a-t-il pas une différence entre donner un sens et saisir le
sens ? On peut ainsi rendre compréhensible l'ordre de l'univers en posant l'existence d'un créateur : on donne
ainsi un sens.
Mais cela signifie-t-il nécessairement que ce sens existe ? Einstein dira ainsi : " ce qu'il y a
d'incompréhensible c'est que l'univers soit compréhensible ".
[L'incompréhensible est une réalité: certaines questions sont insolubles pour la raison.]
L'incompréhensible existe: c'est l'irrationnel
L'irrationnel se révèle pourtant à nous au premier effort de réflexion.
Et d'abord ce postulat que la science
obéit à des lois mathématiques manifeste une sorte d'irrationalité au coeur même des victoires de la raison.
Comment se fait-il que le monde se plie aux lois de notre esprit ? Comment expliquer cet accord entre nos
constructions mentales et le réel ? Il y a là, nous semble-t-il, un mystère, c'est-à-dire quelque chose d'à
jamais incompréhensible.
Comme le dit Einstein, «ce qu'il y a d'incompréhensible, c'est que le monde soit
compréhensible ».
En d'autres termes, le fait que le monde soit rationnel est lui-même un fait irrationnel !
• Mais le fait que le monde soit n'est-il pas déjà irrationnel ? Le philosophe rationaliste le plus convaincu est
contraint de reconnaître qu'il y a au moins un irrationnel : à savoir le fait même de l'être, le fait qu'il y ait
quelque chose plutôt que rien.
Comme l'a dit le grand logicien Ludwig Wittgenstein (1889-1951) dans son
Tractatus logico-philosophicus (1921), « ce qui est mystique, ce n' est pas comment est le monde mais le fait
qu'il est ».
Le comment de l'être, c'est-à-dire l'enchaînement des phénomènes, peut bien être soumis à des
lois mathématiques et rationnelles, le simple fait de l'être n'est pas déductible par la raison.
• L'irrationnel est présent, non seulement dans ce qui m'est donné, mais aussi dans mes démarches ellesmêmes, dans ma façon d'approcher les choses.
La connaissance scientifique elle-même n'opère ses conquêtes
que par des « sauts » de l'intuition ou de l'imagination qui bouleversent la logique de la pensée.
L'imagination
créatrice du poète, la foi du croyant, l'expérience mystique des saints sont vécues comme des expériences
irréductibles à toute analyse rationnelle.
La pensée rationaliste tente bien d'en rendre compte selon ses
propres catégories, et peut même s'efforcer de les réduire à des illusions, mais une expérience vécue, en tant
que donné existentiel, ne peut être récusée : seul l'artiste a qualité pour évoquer son expérience de la
beauté, seul le croyant peut parler de sa participation au sacré.
• Pour Kierkegaard, la foi chrétienne procède d'un véritable saut audelà de ce que la raison nous enseigne.
Ainsi le Post-scriptum aux
Miettes philosophiques (1846) montre la difficulté de «devenir un
chrétien ».
Pour cela, il faut en effet affronter le paradoxe absolu :
avec le Christ, l'éternel advient dans le temporel, et le divin s'incarne
dans l'humain.
L'homme parvenu au « stade religieux » a en Dieu une
confiance absolue : à l'image d'Abraham, qui est prêt à égorger son fils
Isaac pour obéir à Dieu (mais un bélier est substitué à Isaac au moment
du sacrifice), il a « renoncé à sa raison et croit contre la raison ».
Cet incompréhensible apparaît comme définitif
La science progresse, c'est un fait, mais elle ne saura jamais répondre
aux questions métaphysiques qui portent sur le sens de l'existence
humaine.
Il subsistera toujours de l'irrationnel.
Je ne suis pas capable
de répondre aux interrogations fondamentales: Dieu existe-t-il ? L'âme
est-elle immortelle ? L'homme est-il libre ou déterminé ?
Kant a montré, dans la "Dialectique transcendantale" de la "Critique de
la raison pure" que l'homme ne pourra jamais répondre définitivement
aux questions concernant la liberté de la volonté, l'immortalité de l'âme
et l'existence de Dieu..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓