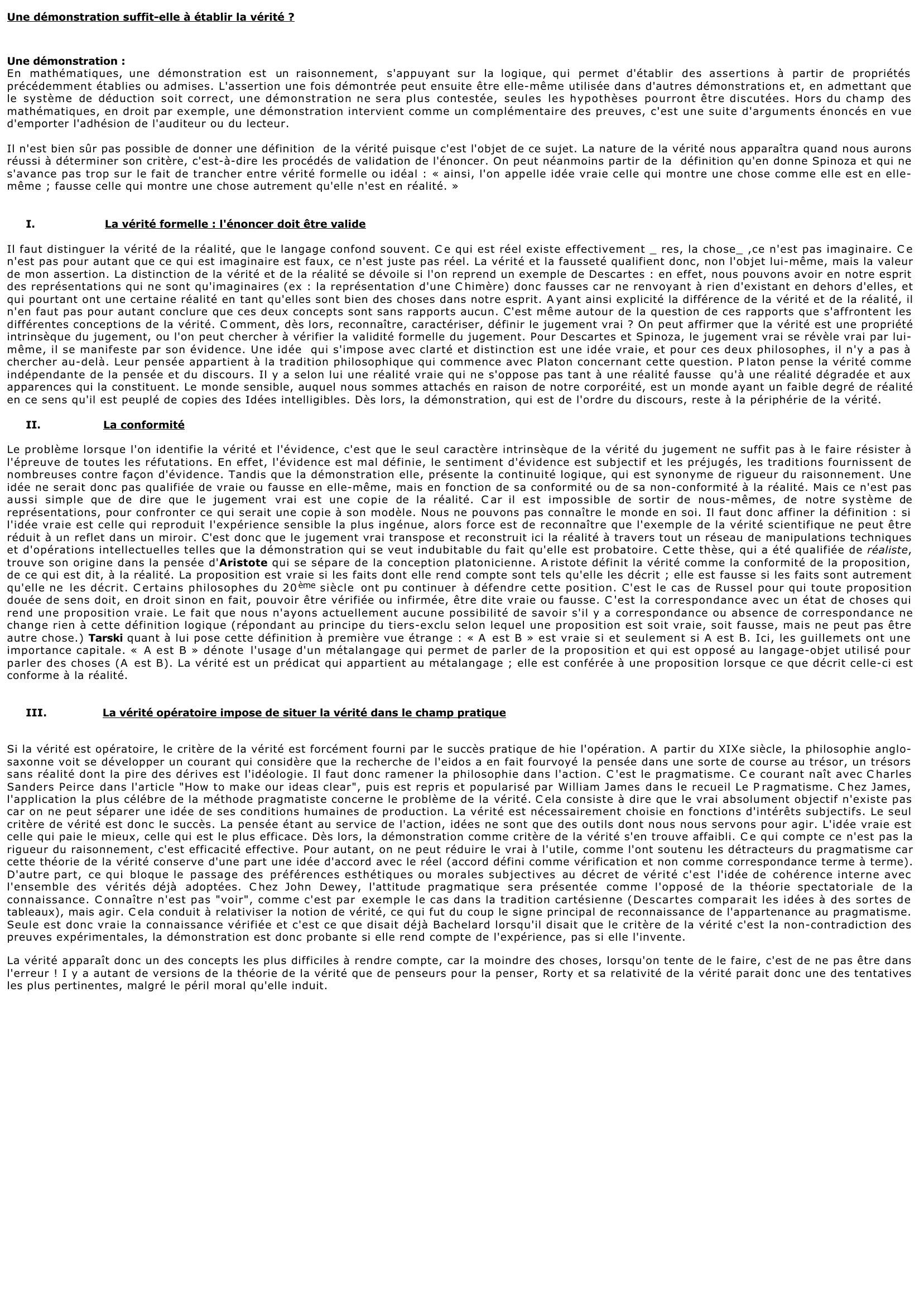Une démonstration suffit-elle à établir une vérité ?
Extrait du document
«
Une démonstration suffit-elle à établir la vérité ?
Une démonstration :
En mathématiques, une démonstration est un raisonnement, s'appuyant sur la logique, qui permet d'établir des assertions à partir de propriétés
précédemment établies ou admises.
L'assertion une fois démontrée peut ensuite être elle-même utilisée dans d'autres démonstrations et, en admettant que
le système de déduction soit correct, une démonstration ne sera plus contestée, seules les hypothèses pourront être discutées.
Hors du champ des
mathématiques, en droit par exemple, une démonstration intervient comme un complémentaire des preuves, c'est une suite d'arguments énoncés en vue
d'emporter l'adhésion de l'auditeur ou du lecteur.
Il n'est bien sûr pas possible de
réussi à déterminer son critère,
s'avance pas trop sur le fait de
même ; fausse celle qui montre
I.
donner une définition de la vérité puisque c'est l'objet de ce sujet.
La nature de la vérité nous apparaîtra quand nous aurons
c'est-à-dire les procédés de validation de l'énoncer.
On peut néanmoins partir de la définition qu'en donne Spinoza et qui ne
trancher entre vérité formelle ou idéal : « ainsi, l'on appelle idée vraie celle qui montre une chose comme elle est en elleune chose autrement qu'elle n'est en réalité.
»
La vérité formelle : l'énoncer doit être valide
Il faut distinguer la vérité de la réalité, que le langage confond souvent.
C e qui est réel existe effectivement _ res, la chose_ ,ce n'est pas imaginaire.
C e
n'est pas pour autant que ce qui est imaginaire est faux, ce n'est juste pas réel.
La vérité et la fausseté qualifient donc, non l'objet lui-même, mais la valeur
de mon assertion.
La distinction de la vérité et de la réalité se dévoile si l'on reprend un exemple de Descartes : en effet, nous pouvons avoir en notre esprit
des représentations qui ne sont qu'imaginaires (ex : la représentation d'une C himère) donc fausses car ne renvoyant à rien d'existant en dehors d'elles, et
qui pourtant ont une certaine réalité en tant qu'elles sont bien des choses dans notre esprit.
A yant ainsi explicité la différence de la vérité et de la réalité, il
n'en faut pas pour autant conclure que ces deux concepts sont sans rapports aucun.
C'est même autour de la question de ces rapports que s'affrontent les
différentes conceptions de la vérité.
C omment, dès lors, reconnaître, caractériser, définir le jugement vrai ? On peut affirmer que la vérité est une propriété
intrinsèque du jugement, ou l'on peut chercher à vérifier la validité formelle du jugement.
Pour Descartes et Spinoza, le jugement vrai se révèle vrai par luimême, il se manifeste par son évidence.
Une idée qui s'impose avec clarté et distinction est une idée vraie, et pour ces deux philosophes, il n'y a pas à
chercher au-delà.
Leur pensée appartient à la tradition philosophique qui commence avec Platon concernant cette question.
P laton pense la vérité comme
indépendante de la pensée et du discours.
Il y a selon lui une réalité vraie qui ne s'oppose pas tant à une réalité fausse qu'à une réalité dégradée et aux
apparences qui la constituent.
Le monde sensible, auquel nous sommes attachés en raison de notre corporéité, est un monde ayant un faible degré de réalité
en ce sens qu'il est peuplé de copies des Idées intelligibles.
Dès lors, la démonstration, qui est de l'ordre du discours, reste à la périphérie de la vérité.
II.
La conformité
Le problème lorsque l'on identifie la vérité et l'évidence, c'est que le seul caractère intrinsèque de la vérité du jugement ne suffit pas à le faire résister à
l'épreuve de toutes les réfutations.
En effet, l'évidence est mal définie, le sentiment d'évidence est subjectif et les préjugés, les traditions fournissent de
nombreuses contre façon d'évidence.
Tandis que la démonstration elle, présente la continuité logique, qui est synonyme de rigueur du raisonnement.
Une
idée ne serait donc pas qualifiée de vraie ou fausse en elle-même, mais en fonction de sa conformité ou de sa non-conformité à la réalité.
Mais ce n'est pas
aussi simple que de dire que le jugement vrai est une copie de la réalité.
C ar il est impossible de sortir de nous-mêmes, de notre système de
représentations, pour confronter ce qui serait une copie à son modèle.
Nous ne pouvons pas connaître le monde en soi.
Il faut donc affiner la définition : si
l'idée vraie est celle qui reproduit l'expérience sensible la plus ingénue, alors force est de reconnaître que l'exemple de la vérité scientifique ne peut être
réduit à un reflet dans un miroir.
C'est donc que le jugement vrai transpose et reconstruit ici la réalité à travers tout un réseau de manipulations techniques
et d'opérations intellectuelles telles que la démonstration qui se veut indubitable du fait qu'elle est probatoire.
C ette thèse, qui a été qualifiée de réaliste,
trouve son origine dans la pensée d'Aristote qui se sépare de la conception platonicienne.
A ristote définit la vérité comme la conformité de la proposition,
de ce qui est dit, à la réalité.
La proposition est vraie si les faits dont elle rend compte sont tels qu'elle les décrit ; elle est fausse si les faits sont autrement
qu'elle ne les décrit.
C ertains philosophes du 20 ème siècle ont pu continuer à défendre cette position.
C'est le cas de Russel pour qui toute proposition
douée de sens doit, en droit sinon en fait, pouvoir être vérifiée ou infirmée, être dite vraie ou fausse.
C 'est la correspondance avec un état de choses qui
rend une proposition vraie.
Le fait que nous n'ayons actuellement aucune possibilité de savoir s'il y a correspondance ou absence de correspondance ne
change rien à cette définition logique (répondant au principe du tiers-exclu selon lequel une proposition est soit vraie, soit fausse, mais ne peut pas être
autre chose.) Tarski quant à lui pose cette définition à première vue étrange : « A est B » est vraie si et seulement si A est B.
Ici, les guillemets ont une
importance capitale.
« A est B » dénote l'usage d'un métalangage qui permet de parler de la proposition et qui est opposé au langage-objet utilisé pour
parler des choses (A est B).
La vérité est un prédicat qui appartient au métalangage ; elle est conférée à une proposition lorsque ce que décrit celle-ci est
conforme à la réalité.
III.
La vérité opératoire impose de situer la vérité dans le champ pratique
Si la vérité est opératoire, le critère de la vérité est forcément fourni par le succès pratique de hie l'opération.
A partir du XIXe siècle, la philosophie anglosaxonne voit se développer un courant qui considère que la recherche de l'eidos a en fait fourvoyé la pensée dans une sorte de course au trésor, un trésors
sans réalité dont la pire des dérives est l'idéologie.
Il faut donc ramener la philosophie dans l'action.
C 'est le pragmatisme.
C e courant naît avec C harles
Sanders Peirce dans l'article "How to make our ideas clear", puis est repris et popularisé par William James dans le recueil Le P ragmatisme.
C hez James,
l'application la plus célébre de la méthode pragmatiste concerne le problème de la vérité.
C ela consiste à dire que le vrai absolument objectif n'existe pas
car on ne peut séparer une idée de ses conditions humaines de production.
La vérité est nécessairement choisie en fonctions d'intérêts subjectifs.
Le seul
critère de vérité est donc le succès.
La pensée étant au service de l'action, idées ne sont que des outils dont nous nous servons pour agir.
L'idée vraie est
celle qui paie le mieux, celle qui est le plus efficace.
Dès lors, la démonstration comme critère de la vérité s'en trouve affaibli.
C e qui compte ce n'est pas la
rigueur du raisonnement, c'est efficacité effective.
Pour autant, on ne peut réduire le vrai à l'utile, comme l'ont soutenu les détracteurs du pragmatisme car
cette théorie de la vérité conserve d'une part une idée d'accord avec le réel (accord défini comme vérification et non comme correspondance terme à terme).
D'autre part, ce qui bloque le passage des préférences esthétiques ou morales subjectives au décret de vérité c'est l'idée de cohérence interne avec
l'ensemble des vérités déjà adoptées.
C hez John Dewey, l'attitude pragmatique sera présentée comme l'opposé de la théorie spectatoriale de la
connaissance.
C onnaître n'est pas "voir", comme c'est par exemple le cas dans la tradition cartésienne ( Descartes comparait les idées à des sortes de
tableaux), mais agir.
C ela conduit à relativiser la notion de vérité, ce qui fut du coup le signe principal de reconnaissance de l'appartenance au pragmatisme.
Seule est donc vraie la connaissance vérifiée et c'est ce que disait déjà Bachelard lorsqu'il disait que le critère de la vérité c'est la non-contradiction des
preuves expérimentales, la démonstration est donc probante si elle rend compte de l'expérience, pas si elle l'invente.
La vérité apparaît donc un des concepts les plus difficiles à rendre compte, car la moindre des choses, lorsqu'on tente de le faire, c'est de ne pas être dans
l'erreur ! I y a autant de versions de la théorie de la vérité que de penseurs pour la penser, Rorty et sa relativité de la vérité parait donc une des tentatives
les plus pertinentes, malgré le péril moral qu'elle induit..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Démontre-t-on pour convaincre ou pour établir une vérité ?
- Faut-il nécessairement se référer à la réalité pour établir la vérité ?
- « C’est la folie qui détient la vérité de la psychologie » MICHEL FOUCAULT
- vérité cours
- Philosophie: croyance, certitude et vérité