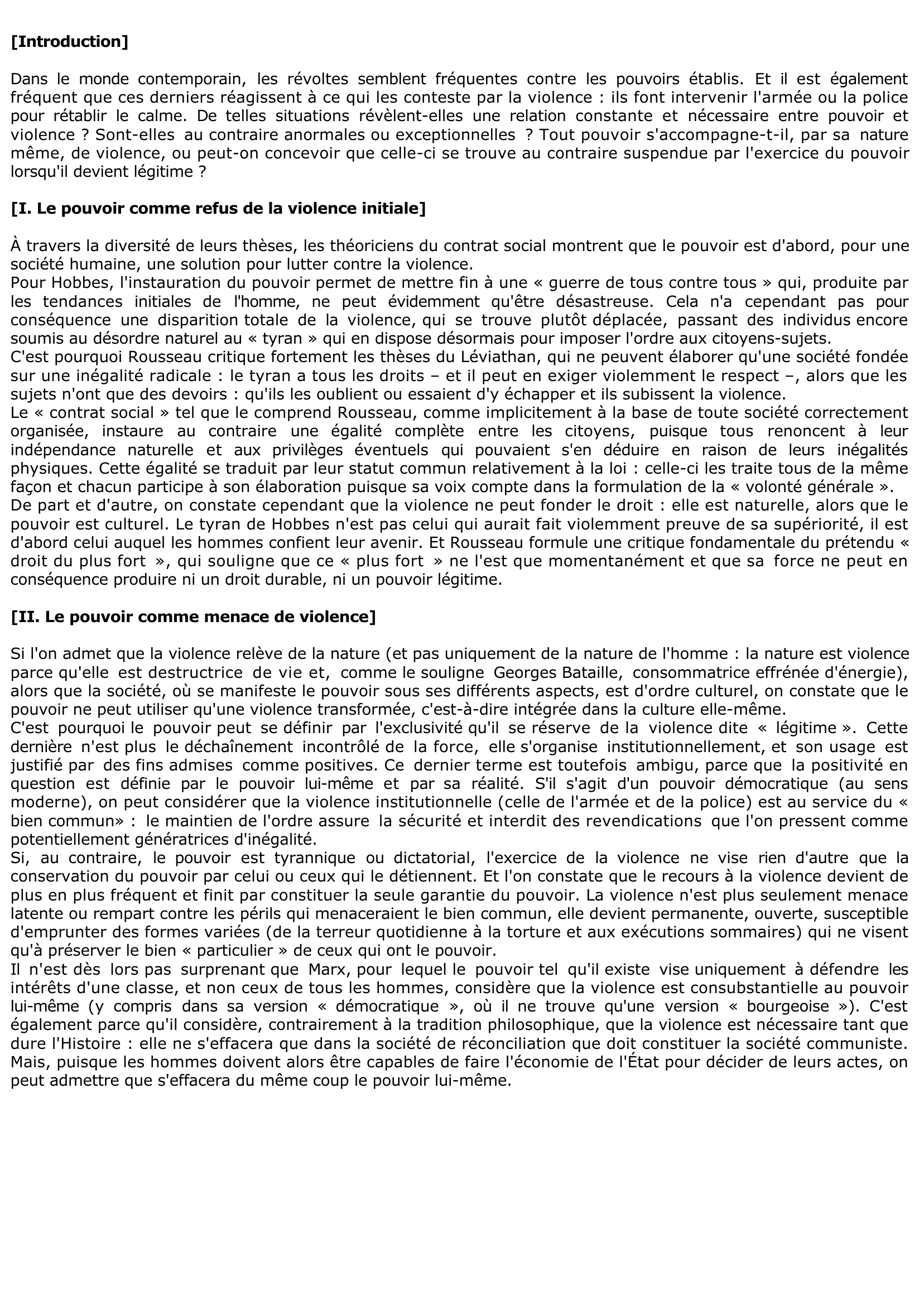Tout pouvoir s'accompagne-t-il de violence ?
Extrait du document
«
[Introduction]
Dans le monde contemporain, les révoltes semblent fréquentes contre les pouvoirs établis.
Et il est également
fréquent que ces derniers réagissent à ce qui les conteste par la violence : ils font intervenir l'armée ou la police
pour rétablir le calme.
De telles situations révèlent-elles une relation constante et nécessaire entre pouvoir et
violence ? Sont-elles au contraire anormales ou exceptionnelles ? Tout pouvoir s'accompagne-t-il, par sa nature
même, de violence, ou peut-on concevoir que celle-ci se trouve au contraire suspendue par l'exercice du pouvoir
lorsqu'il devient légitime ?
[I.
Le pouvoir comme refus de la violence initiale]
À travers la diversité de leurs thèses, les théoriciens du contrat social montrent que le pouvoir est d'abord, pour une
société humaine, une solution pour lutter contre la violence.
Pour Hobbes, l'instauration du pouvoir permet de mettre fin à une « guerre de tous contre tous » qui, produite par
les tendances initiales de l'homme, ne peut évidemment qu'être désastreuse.
Cela n'a cependant pas pour
conséquence une disparition totale de la violence, qui se trouve plutôt déplacée, passant des individus encore
soumis au désordre naturel au « tyran » qui en dispose désormais pour imposer l'ordre aux citoyens-sujets.
C'est pourquoi Rousseau critique fortement les thèses du Léviathan, qui ne peuvent élaborer qu'une société fondée
sur une inégalité radicale : le tyran a tous les droits – et il peut en exiger violemment le respect –, alors que les
sujets n'ont que des devoirs : qu'ils les oublient ou essaient d'y échapper et ils subissent la violence.
Le « contrat social » tel que le comprend Rousseau, comme implicitement à la base de toute société correctement
organisée, instaure au contraire une égalité complète entre les citoyens, puisque tous renoncent à leur
indépendance naturelle et aux privilèges éventuels qui pouvaient s'en déduire en raison de leurs inégalités
physiques.
Cette égalité se traduit par leur statut commun relativement à la loi : celle-ci les traite tous de la même
façon et chacun participe à son élaboration puisque sa voix compte dans la formulation de la « volonté générale ».
De part et d'autre, on constate cependant que la violence ne peut fonder le droit : elle est naturelle, alors que le
pouvoir est culturel.
Le tyran de Hobbes n'est pas celui qui aurait fait violemment preuve de sa supériorité, il est
d'abord celui auquel les hommes confient leur avenir.
Et Rousseau formule une critique fondamentale du prétendu «
droit du plus fort », qui souligne que ce « plus fort » ne l'est que momentanément et que sa force ne peut en
conséquence produire ni un droit durable, ni un pouvoir légitime.
[II.
Le pouvoir comme menace de violence]
Si l'on admet que la violence relève de la nature (et pas uniquement de la nature de l'homme : la nature est violence
parce qu'elle est destructrice de vie et, comme le souligne Georges Bataille, consommatrice effrénée d'énergie),
alors que la société, où se manifeste le pouvoir sous ses différents aspects, est d'ordre culturel, on constate que le
pouvoir ne peut utiliser qu'une violence transformée, c'est-à-dire intégrée dans la culture elle-même.
C'est pourquoi le pouvoir peut se définir par l'exclusivité qu'il se réserve de la violence dite « légitime ».
Cette
dernière n'est plus le déchaînement incontrôlé de la force, elle s'organise institutionnellement, et son usage est
justifié par des fins admises comme positives.
Ce dernier terme est toutefois ambigu, parce que la positivité en
question est définie par le pouvoir lui-même et par sa réalité.
S'il s'agit d'un pouvoir démocratique (au sens
moderne), on peut considérer que la violence institutionnelle (celle de l'armée et de la police) est au service du «
bien commun» : le maintien de l'ordre assure la sécurité et interdit des revendications que l'on pressent comme
potentiellement génératrices d'inégalité.
Si, au contraire, le pouvoir est tyrannique ou dictatorial, l'exercice de la violence ne vise rien d'autre que la
conservation du pouvoir par celui ou ceux qui le détiennent.
Et l'on constate que le recours à la violence devient de
plus en plus fréquent et finit par constituer la seule garantie du pouvoir.
La violence n'est plus seulement menace
latente ou rempart contre les périls qui menaceraient le bien commun, elle devient permanente, ouverte, susceptible
d'emprunter des formes variées (de la terreur quotidienne à la torture et aux exécutions sommaires) qui ne visent
qu'à préserver le bien « particulier » de ceux qui ont le pouvoir.
Il n'est dès lors pas surprenant que Marx, pour lequel le pouvoir tel qu'il existe vise uniquement à défendre les
intérêts d'une classe, et non ceux de tous les hommes, considère que la violence est consubstantielle au pouvoir
lui-même (y compris dans sa version « démocratique », où il ne trouve qu'une version « bourgeoise »).
C'est
également parce qu'il considère, contrairement à la tradition philosophique, que la violence est nécessaire tant que
dure l'Histoire : elle ne s'effacera que dans la société de réconciliation que doit constituer la société communiste.
Mais, puisque les hommes doivent alors être capables de faire l'économie de l'État pour décider de leurs actes, on
peut admettre que s'effacera du même coup le pouvoir lui-même..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Tout pouvoir s'accompagne-t-il de violence ?
- Le pouvoir politique doit-il dépasser ou utiliser la violence à son profit ?
- Un pouvoir qui use de violence est-il un pouvoir fort ?
- En quoi peut-on dire que la violence est au cœur des régimes totalitaires et de leur idéologie ?
- Dissertation: Toute politique n'est-elle qu'une lutte pour le pouvoir ?