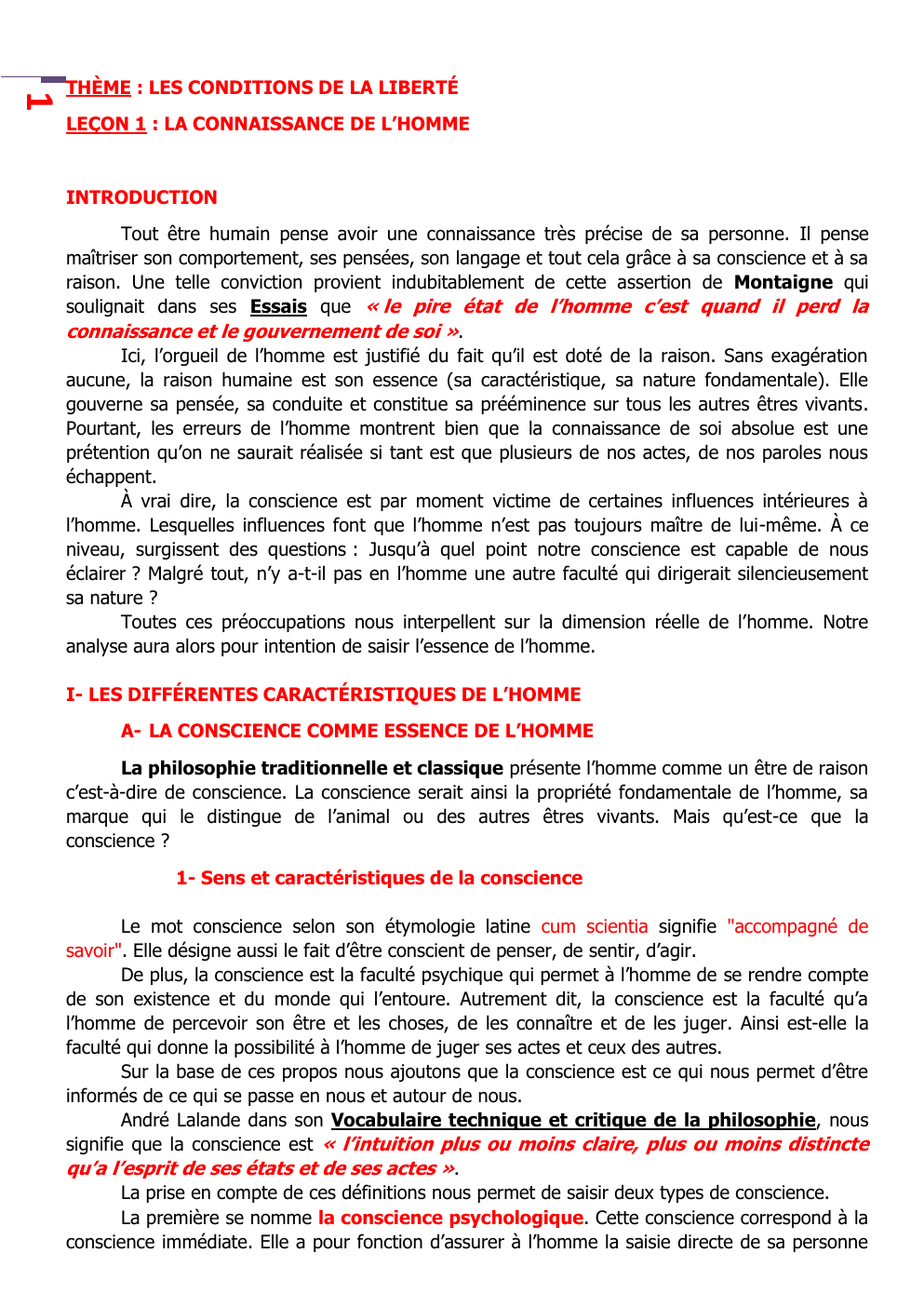THÈME : LES CONDITIONS DE LA LIBERTÉ LEÇON 1 : LA CONNAISSANCE DE L’HOMME
Publié le 08/02/2025
Extrait du document
«
1
THÈME : LES CONDITIONS DE LA LIBERTÉ
LEÇON 1 : LA CONNAISSANCE DE L’HOMME
INTRODUCTION
Tout être humain pense avoir une connaissance très précise de sa personne.
Il pense
maîtriser son comportement, ses pensées, son langage et tout cela grâce à sa conscience et à sa
raison.
Une telle conviction provient indubitablement de cette assertion de Montaigne qui
soulignait dans ses Essais que « le pire état de l’homme c’est quand il perd la
connaissance et le gouvernement de soi ».
Ici, l’orgueil de l’homme est justifié du fait qu’il est doté de la raison.
Sans exagération
aucune, la raison humaine est son essence (sa caractéristique, sa nature fondamentale).
Elle
gouverne sa pensée, sa conduite et constitue sa prééminence sur tous les autres êtres vivants.
Pourtant, les erreurs de l’homme montrent bien que la connaissance de soi absolue est une
prétention qu’on ne saurait réalisée si tant est que plusieurs de nos actes, de nos paroles nous
échappent.
À vrai dire, la conscience est par moment victime de certaines influences intérieures à
l’homme.
Lesquelles influences font que l’homme n’est pas toujours maître de lui-même.
À ce
niveau, surgissent des questions : Jusqu’à quel point notre conscience est capable de nous
éclairer ? Malgré tout, n’y a-t-il pas en l’homme une autre faculté qui dirigerait silencieusement
sa nature ?
Toutes ces préoccupations nous interpellent sur la dimension réelle de l’homme.
Notre
analyse aura alors pour intention de saisir l’essence de l’homme.
I- LES DIFFÉRENTES CARACTÉRISTIQUES DE L’HOMME
A- LA CONSCIENCE COMME ESSENCE DE L’HOMME
La philosophie traditionnelle et classique présente l’homme comme un être de raison
c’est-à-dire de conscience.
La conscience serait ainsi la propriété fondamentale de l’homme, sa
marque qui le distingue de l’animal ou des autres êtres vivants.
Mais qu’est-ce que la
conscience ?
1- Sens et caractéristiques de la conscience
Le mot conscience selon son étymologie latine cum scientia signifie "accompagné de
savoir".
Elle désigne aussi le fait d’être conscient de penser, de sentir, d’agir.
De plus, la conscience est la faculté psychique qui permet à l’homme de se rendre compte
de son existence et du monde qui l’entoure.
Autrement dit, la conscience est la faculté qu’a
l’homme de percevoir son être et les choses, de les connaître et de les juger.
Ainsi est-elle la
faculté qui donne la possibilité à l’homme de juger ses actes et ceux des autres.
Sur la base de ces propos nous ajoutons que la conscience est ce qui nous permet d’être
informés de ce qui se passe en nous et autour de nous.
André Lalande dans son Vocabulaire technique et critique de la philosophie, nous
signifie que la conscience est « l’intuition plus ou moins claire, plus ou moins distincte
qu’a l’esprit de ses états et de ses actes ».
La prise en compte de ces définitions nous permet de saisir deux types de conscience.
La première se nomme la conscience psychologique.
Cette conscience correspond à la
conscience immédiate.
Elle a pour fonction d’assurer à l’homme la saisie directe de sa personne
2
et de son environnement.
En plus d’être appelée conscience immédiate, elle se nomme aussi
conscience spontanée.
Ce qui est tout le contraire de la conscience morale.
La conscience morale se rapporte
au fait de faire la distinction entre le bien et le mal.
Aussi permet-elle à l’homme d’atteindre sa
dignité en étant dans le vrai.
C’est enfin cette idée qu’a voulu traduire le philosophie français Jean-Jacques Rousseau
lorsqu’il a soutenu dans Émile ou de l’éducation la condition suivante : « Conscience !
Conscience ! Instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré d’un être
ignorant et borné mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal qui rend
l’homme semblable à Dieu.
C’est toi qui fait l’excellence de sa nature et la moralité de
ses actions ».
En termes un peu plus clairs, Rousseau veut montrer que c’est la conscience qui
nous place ou nous élève au diapason (registre, répertoire) de Dieu, c’est elle qui nous met sur
un piédestal (fondement, base) solide à partir duquel nous régentons (dominons, dirigeons) le
monde.
En définitive, c’est la conscience qui nous évite d’errer et de chanceler (tituber) ou de
trébucher à tout moment.
Par-delà ces précisions, il nous appartient alors de passer en revue les éléments
argumentatifs qui montrent la conscience comme essence de l’homme.
2- La conscience comme caractéristique essentielle de l’homme
Depuis l’antiquité, par une conviction socratique, il y a une possibilité de parvenir à la
connaissance de l’homme.
Ainsi selon les philosophes Rationalistes (René Descartes ; Alain ;
Jean-Paul Sartre ; Blaise Pascal ; Ludwig Feuerbach ; Henri Bergson ; Emmanuel
Kant ; Jean-Jacques Rousseau ; Edmund Husserl…) l’homme se définit comme un être de
« conscience ».
La formulation du titre nous invite à prendre en compte le mot caractéristique.
Dans une
approche définitionnelle, ce mot renvoie à un ensemble d’éléments qui vont permettre de
distinguer une chose des autres.
Dans ce cas de figure, la caractéristique est indentifiable à
l’essence de l’homme.
Dire donc de la conscience qu’elle est la caractéristique de l’homme, c’est soutenir que ce
qui fait la nature fondamentale de l’homme c’est la conscience.
Cela dit, quels arguments nous permettent de présenter la conscience comme ce qui
définit essentiellement l’homme ?
En réponse à cette préoccupation, il nous faudra commencer par soutenir qu’avec les
autres êtres vivants l’homme partage la réalité d’un corps biologique, des sens et de l’instinct.
Par contre, il se distingue de par la conscience dont il est doté.
On pourrait donc dire que
la conscience est la marque authentique de l’homme.
Car selon son étymologie qui signifie ce qui
est accompagné de savoir, la conscience est cette entité psychique en tout homme lui
permettant de saisir ce qui se passe en lui et hors de lui.
A cet effet, à travers son
« Cogito ergo sum » :« Je pense donc je suis », René DESCARTES (Philosophe Français ;
père de la philosophie moderne : 1596-165O) met en relief « la conscience » comme un élément
constitutif de la nature humaine.
C’est pourquoi écrit-il dans Discours de la méthode ceci :
« Je connus de là que je suis une substance dont toute l’essence ou la nature n’est
que de penser ».
Pour dire que la conscience est ce qui permet à homme de penser, de dire
« je » et est ce qui confère une identité à l’homme.
De là, l’homme est un être conscient de soi, c’est-à-dire un être capable de se
connaitre soi-même, capable de se contempler, de se représenter à lui-même ce que
la pensée peut lui assigner comme essence.
Et le rendant ainsi supérieur aux autres êtres
3
vivants.
À ce propos, Alexandre Kojève dans Introduction à la lecture de Hegel affirme
que « L’homme est conscience de soi.
Il est conscient de soi, conscient de sa réalité et
de sa dignité humaine, et c’est en ceci qu’il diffère essentiellement de l’animal qui ne
dépasse le niveau du simple sentiment de soi ».
Pour KOJÈVE, l’homme est le seul être
qui se connaît véritablement contrairement à l’animal.
Cette connaissance de son existence est
possible grâce à la conscience dont le propre est de revenir sur soi-même.
Aussi, appréhender l’homme comme un être conscient, c’est dire qu’il est capable de
porter des jugements de valeur sur ses actes et intentions.
Il sait distinguer le bien
du mal, le vrai du faux.
Ce qui fait de lui un sujet (un être) moral.
Or pour arriver à cela,
il faudrait qu’il soit auparavant habité par la conscience.
Car comme le dit Jean-Jacques
ROUSSEAU (Philosophe Français ; père de la philosophie politique et morale : 1712-1778) dans
son œuvre Emile ou De l’éducation : « la conscience est un principe inné de justice et
de vertu sur lequel nous jugeons nos actions et celles d’autrui comme bonnes ou
mauvaises.
»
Blaise Pascal quant à lui ajoute dans les Pensées que « la conscience est le
meilleur livre du monde que nous ayons ; c’est celui que l’on doit consulter le plus
souvent ».
Et quant à Michael Girardi, renchérissant ces propos de Pascal dans Les
réflexions et pensées diverses écrit ceci :« la conscience est le meilleur livre de morale
que l’on puisse avoir, consultons-la souvent ».
En un mot, l’homme se définit essentiellement comme un être de conscience, un être de
raison, une chose pensante, un roseau pensant parce qu’il possède une faculté lui permettant
d’avoir un savoir revenant sur lui-même et une connaissance du monde extérieur.
Cette connaissance peut être spontanée : l’homme sait qu’il sait ou sent sans un acte de
réflexion.
On dit alors que la conscience est immédiate.
La conscience peut se porter vers un objet avec une vive attention.
Elle observe et veut
comprendre.
Cette connaissance est sélective : on dit dans ce cas que la conscience est médiate
(indirecte).
Enfin, la conscience peut revenir sur les actes de la pensée même, pour coïncider avec
elle-même et se prendre comme objet d’étude.
La conscience dite réfléchie : la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA CONNAISSANCE DE L’HOMME EST-ELLE POSSIBLE ?
- Explication du texte de Heidegger Thème : Rapport de l’homme à la technique
- Goethe: La connaissance est-elle un facteur de liberté ?
- Spinoza: Connaissance et liberté
- KANT: «Le droit est l'ensemble conceptuel des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être concilié avec l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de la liberté.»