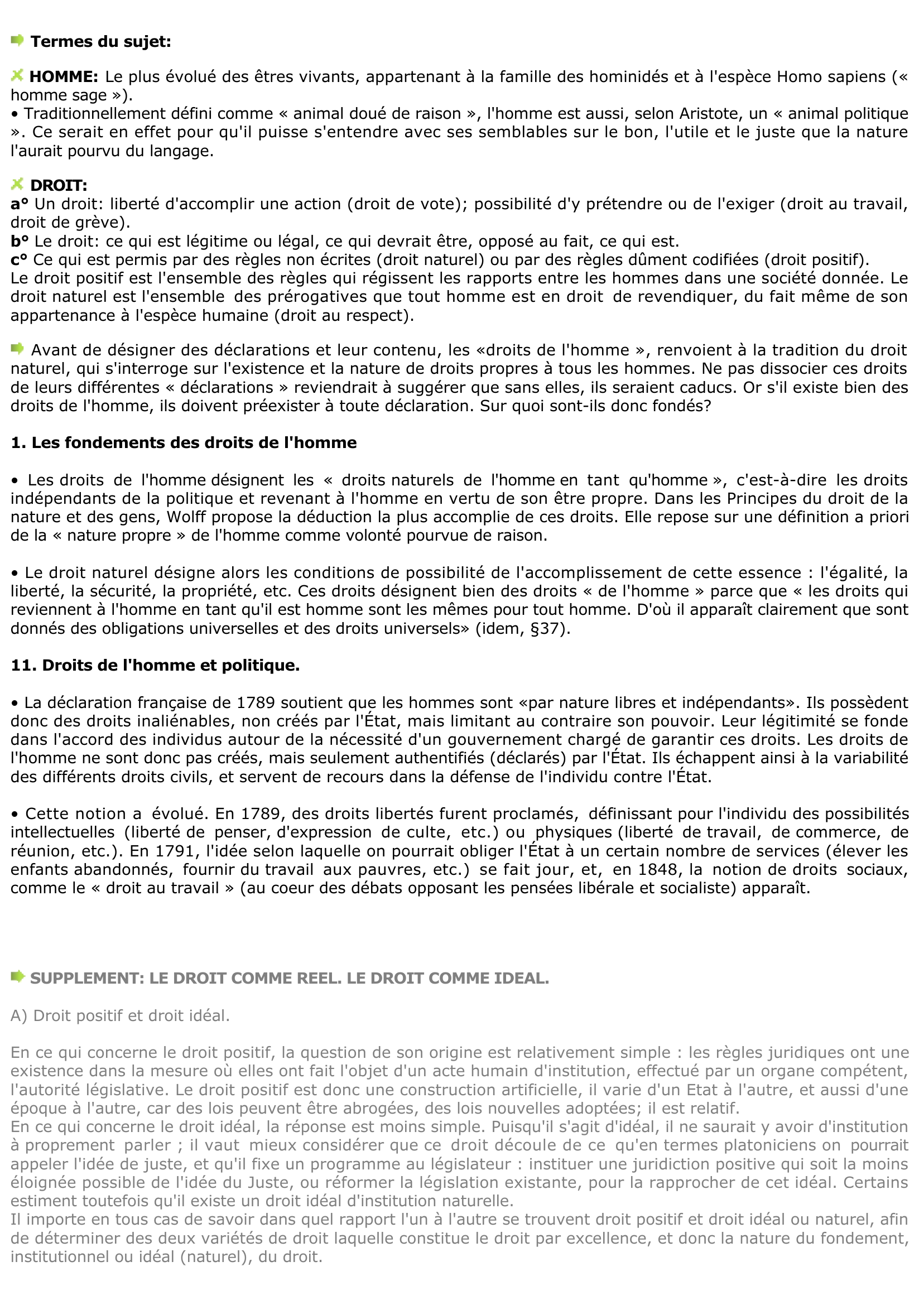Sur quoi les droits de l'homme sont-ils fondés ?
Extrait du document
«
Termes du sujet:
HOMME: Le plus évolué des êtres vivants, appartenant à la famille des hominidés et à l'espèce Homo sapiens («
homme sage »).
• Traditionnellement défini comme « animal doué de raison », l'homme est aussi, selon Aristote, un « animal politique
».
Ce serait en effet pour qu'il puisse s'entendre avec ses semblables sur le bon, l'utile et le juste que la nature
l'aurait pourvu du langage.
DROIT:
a° Un droit: liberté d'accomplir une action (droit de vote); possibilité d'y prétendre ou de l'exiger (droit au travail,
droit de grève).
b° Le droit: ce qui est légitime ou légal, ce qui devrait être, opposé au fait, ce qui est.
c° Ce qui est permis par des règles non écrites (droit naturel) ou par des règles dûment codifiées (droit positif).
Le droit positif est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les hommes dans une société donnée.
Le
droit naturel est l'ensemble des prérogatives que tout homme est en droit de revendiquer, du fait même de son
appartenance à l'espèce humaine (droit au respect).
Avant de désigner des déclarations et leur contenu, les «droits de l'homme », renvoient à la tradition du droit
naturel, qui s'interroge sur l'existence et la nature de droits propres à tous les hommes.
Ne pas dissocier ces droits
de leurs différentes « déclarations » reviendrait à suggérer que sans elles, ils seraient caducs.
Or s'il existe bien des
droits de l'homme, ils doivent préexister à toute déclaration.
Sur quoi sont-ils donc fondés?
1.
Les fondements des droits de l'homme
• Les droits de l'homme désignent les « droits naturels de l'homme en tant qu'homme », c'est-à-dire les droits
indépendants de la politique et revenant à l'homme en vertu de son être propre.
Dans les Principes du droit de la
nature et des gens, Wolff propose la déduction la plus accomplie de ces droits.
Elle repose sur une définition a priori
de la « nature propre » de l'homme comme volonté pourvue de raison.
• Le droit naturel désigne alors les conditions de possibilité de l'accomplissement de cette essence : l'égalité, la
liberté, la sécurité, la propriété, etc.
Ces droits désignent bien des droits « de l'homme » parce que « les droits qui
reviennent à l'homme en tant qu'il est homme sont les mêmes pour tout homme.
D'où il apparaît clairement que sont
donnés des obligations universelles et des droits universels» (idem, §37).
11.
Droits de l'homme et politique.
• La déclaration française de 1789 soutient que les hommes sont «par nature libres et indépendants».
Ils possèdent
donc des droits inaliénables, non créés par l'État, mais limitant au contraire son pouvoir.
Leur légitimité se fonde
dans l'accord des individus autour de la nécessité d'un gouvernement chargé de garantir ces droits.
Les droits de
l'homme ne sont donc pas créés, mais seulement authentifiés (déclarés) par l'État.
Ils échappent ainsi à la variabilité
des différents droits civils, et servent de recours dans la défense de l'individu contre l'État.
• Cette notion a évolué.
En 1789, des droits libertés furent proclamés, définissant pour l'individu des possibilités
intellectuelles (liberté de penser, d'expression de culte, etc.) ou physiques (liberté de travail, de commerce, de
réunion, etc.).
En 1791, l'idée selon laquelle on pourrait obliger l'État à un certain nombre de services (élever les
enfants abandonnés, fournir du travail aux pauvres, etc.) se fait jour, et, en 1848, la notion de droits sociaux,
comme le « droit au travail » (au coeur des débats opposant les pensées libérale et socialiste) apparaît.
SUPPLEMENT: LE DROIT COMME REEL.
LE DROIT COMME IDEAL.
A) Droit positif et droit idéal.
En ce qui concerne le droit positif, la question de son origine est relativement simple : les règles juridiques ont une
existence dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un acte humain d'institution, effectué par un organe compétent,
l'autorité législative.
Le droit positif est donc une construction artificielle, il varie d'un Etat à l'autre, et aussi d'une
époque à l'autre, car des lois peuvent être abrogées, des lois nouvelles adoptées; il est relatif.
En ce qui concerne le droit idéal, la réponse est moins simple.
Puisqu'il s'agit d'idéal, il ne saurait y avoir d'institution
à proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit découle de ce qu'en termes platoniciens on pourrait
appeler l'idée de juste, et qu'il fixe un programme au législateur : instituer une juridiction positive qui soit la moins
éloignée possible de l'idée du Juste, ou réformer la législation existante, pour la rapprocher de cet idéal.
Certains
estiment toutefois qu'il existe un droit idéal d'institution naturelle.
Il importe en tous cas de savoir dans quel rapport l'un à l'autre se trouvent droit positif et droit idéal ou naturel, afin
de déterminer des deux variétés de droit laquelle constitue le droit par excellence, et donc la nature du fondement,
institutionnel ou idéal (naturel), du droit..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- " En quel sens peut-on dire que les droits de l'homme sont universels" ?
- Peut-on considérer les droits de l'homme indépendamment des droits de citoyen ?
- Les droits de l'homme : évidence ou problème ?
- l'homme n'a-t-il que les droits que lui donne les lois de son pays ?
- La liberté se réduit-elle à une déclaration des droits de l'homme ?