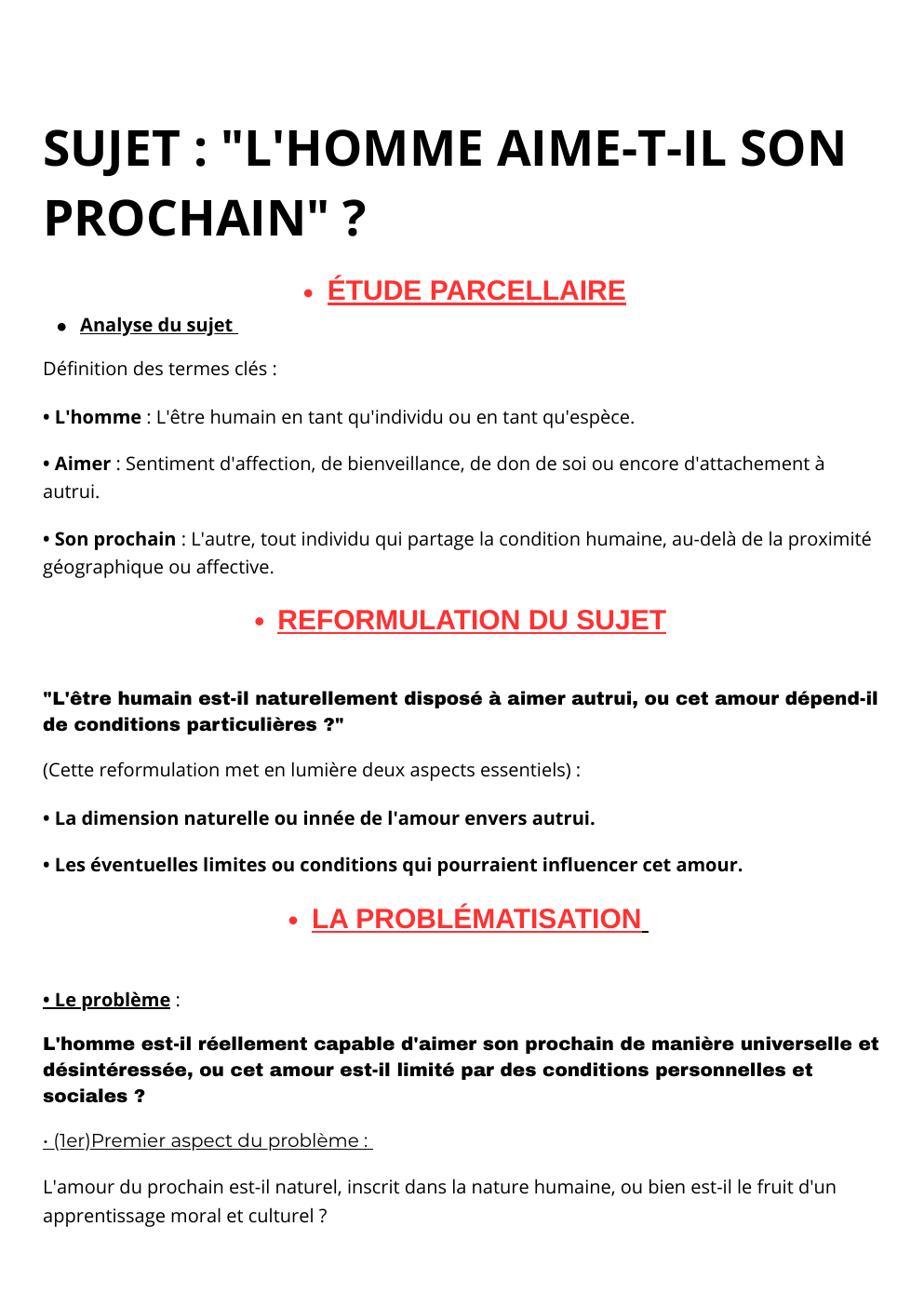SUJET : "L'HOMME AIME-T-IL SON PROCHAIN" ?
Publié le 23/01/2025
Extrait du document
«
SUJET : "L'HOMME AIME-T-IL SON
PROCHAIN" ?
ÉTUDE PARCELLAIRE
Analyse du sujet
Définition des termes clés :
• L'homme : L'être humain en tant qu'individu ou en tant qu'espèce.
• Aimer : Sentiment d'affection, de bienveillance, de don de soi ou encore d'attachement à
autrui.
• Son prochain : L'autre, tout individu qui partage la condition humaine, au-delà de la proximité
géographique ou affective.
REFORMULATION DU SUJET
"L'être humain est-il naturellement disposé à aimer autrui, ou cet amour dépend-il
de conditions particulières ?"
(Cette reformulation met en lumière deux aspects essentiels) :
• La dimension naturelle ou innée de l'amour envers autrui.
• Les éventuelles limites ou conditions qui pourraient influencer cet amour.
LA PROBLÉMATISATION
• Le problème :
L'homme est-il réellement capable d'aimer son prochain de manière universelle et
désintéressée, ou cet amour est-il limité par des conditions personnelles et
sociales ?
• (1er)Premier aspect du problème :
L'amour du prochain est-il naturel, inscrit dans la nature humaine, ou bien est-il le fruit d'un
apprentissage moral et culturel ?
• (2e)Deuxième aspect du problème :
L'amour envers autrui peut-il être totalement désintéressé, ou est-il toujours influencé par des
intérêts personnels, conscients ou inconscients ?
• (3e) Troisième aspect du problème :
Cet amour est-il universel, s'étendant véritable à tous les hommes, ou reste-t-il réservé à un
cercle restreint (famille, amis, proches) ?
REDACTION DE L'INTRODUCTION
Aimer son prochain, c'est manifester une affection désintéressée et bienveillante envers autrui,
sans considération d'intérêt ou de condition.
Cette exigence morale, valorisée dans de
nombreuses traditions philosophiques et religieuses, semble pourtant en tension avec certains
comportements humains qui traduisent l'égoïsme, l'indifférence ou l'hostilité envers les autres.
Dès lors, se pose une question fondamentale : l'homme aime-t-il réellement son prochain ?
Cette interrogation soulève un problème central : l'amour pour autrui est-il une disposition
naturelle de l'homme ou une construction morale et culturelle ? Nous pouvons nous demander
si cet amour peut être universel, sincère et désintéressé, ou s'il reste toujours conditionné par
des intérêts, des limites sociales et des préférences personnelles.
Pour répondre à cette question, nous examinons d'abord la possibilité que l'amour du prochain
soit une inclinaison naturelle chez l'homme, avant de considérer les obstacles et conditions qui
limitent cet amour, pour enfin réfléchir à la portée et aux implications de cet idéal moral.
DEVELOPPEMENT
AXE 1 : L’amour du prochain comme inclination naturelle de l’homme
Cet axe défend l’idée que l’homme est naturellement disposé à aimer autrui, par sa nature
sociale et empathique, ainsi que par les valeurs universelles prônées par certaines traditions
philosophiques et religieuses.
Argument 1 : L’homme est un être social par nature
• Explication :
Aristote soutient que l’homme est un "animal politique", c’est-à-dire un être naturellement porté
à vivre en communauté et à tisser des liens sociaux.
Cette inclinaison à vivre ensemble repose
sur des relations d’entraide, d’affection et de solidarité, nécessaires à la survie et à
l’épanouissement de l’individu.
L’amour du prochain, dans ce sens, est une condition inhérente à
la nature humaine.
• Illustration :
Aristote affirme : « L’homme est par nature un animal social, et celui qui vit hors de la
société est soit une bête, soit un dieu.
» (Politique).
Cela montre que l’homme, en tant qu’être
social, trouve son accomplissement dans des relations harmonieuses avec autrui.
• Explication (de l'illustration) : Aristote affirme que l'homme est naturellement porté à vivre
en société.
Il ne s'agit pas d'un choix, mais d'une nécessité ancrée dans son essence.
Selon lui,
l'homme trouve son accomplissement dans les relations avec les autres : la communication, la
coopération et la construction de communautés.
La société permet à l'homme de réaliser ses
potentialités, car il a besoin des autres pour développer son langage, sa pensée et ses vertus.
Argument 2 : Les sentiments d’empathie sont naturels
• Explication :
L’empathie, capacité à se mettre à la place d’autrui et à ressentir ses émotions, est une
disposition universelle de l’homme.
Les études psychologiques montrent que dès l’enfance, les
êtres humains manifestent des comportements altruistes et bienveillants envers les autres.
Cela
suggère que l’amour du prochain, bien qu’il puisse être influencé par des contextes extérieurs,
repose sur une base innée.
• Illustration :
Jean-Jacques Rousseau écrit dans Émile : « L’homme est naturellement bon ; c’est la
société qui le corrompt.
» Cette citation souligne que l’altruisme et l’amour sont des traits
fondamentaux de la nature humaine, avant d’être altérés par les structures sociales.
• Explication (de l'illustration) :
Rousseau pense
que, dans l'état de nature, l'homme est fondamentalement bon.
Cet état originel correspond à
une existence simple, où l'individu vit en harmonie....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Expliquez, et s'il y a lieu discutez, cette pensée de Jean Guéhenno : «On ne juge jamais mieux qu'à vingt ans l'univers : on l'aime tel qu'il devrait être. Toute la sagesse, après, est à maintenir vivant en soi un tel amour. » (Journal d'un homme de quar
- Expliquez et commentez ces affirmations d'Ernest Renan dans l'Avenir de la science : » L'homme ne communique avec les choses que par le savoir et par l'amour : sans la science, il n'aime que des chimères. La science seule fournit le fond de réalité néces
- Pourquoi l'homme aime-t-il ?
- l'homme aime-t-il la justice pour elle-même ?
- Texte 1 : « Homme est tu capable d’être juste ? »