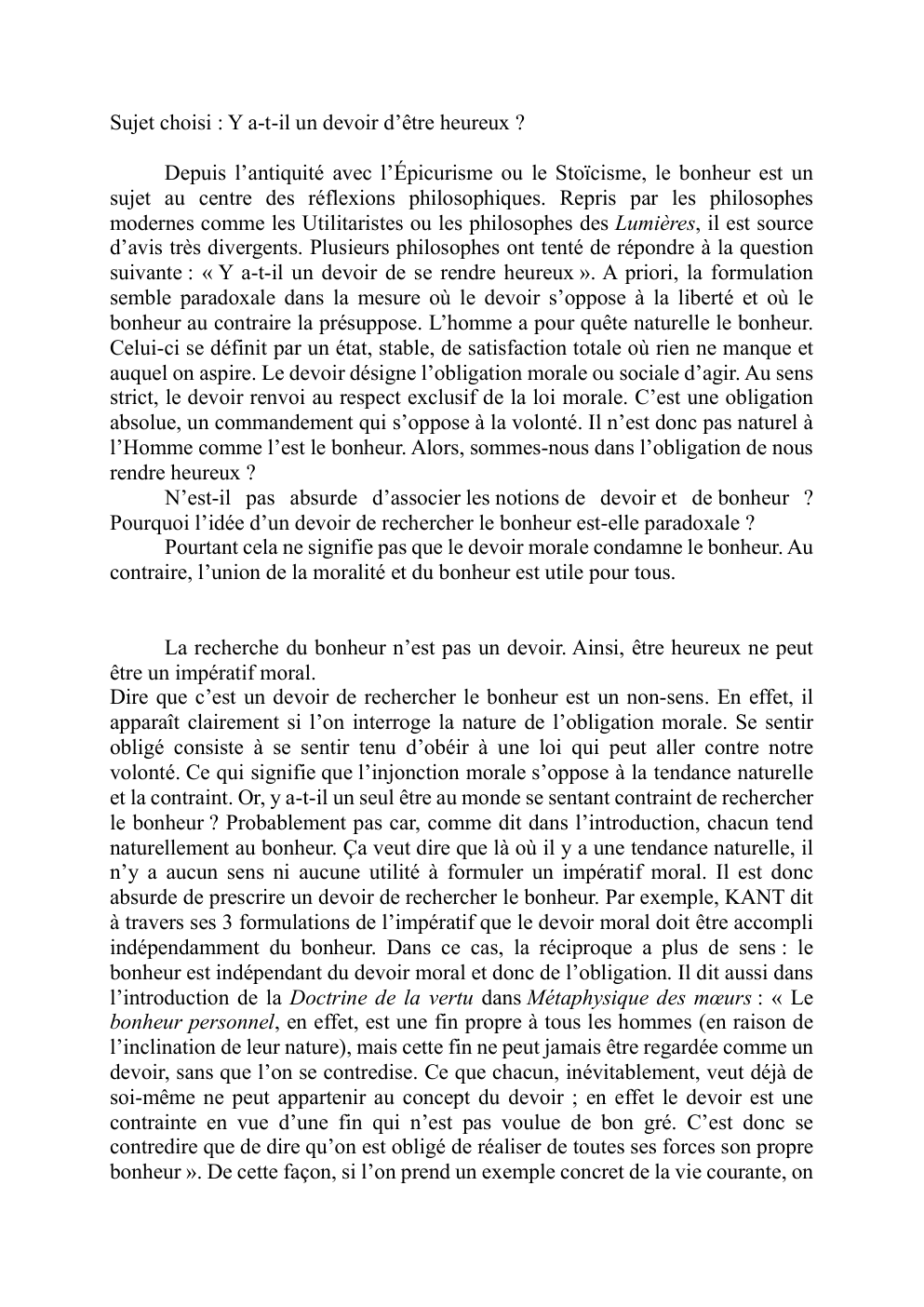Sujet choisi : Y a-t-il un devoir d’être heureux ?
Publié le 21/03/2025
Extrait du document
«
Sujet choisi : Y a-t-il un devoir d’être heureux ?
Depuis l’antiquité avec l’Épicurisme ou le Stoïcisme, le bonheur est un
sujet au centre des réflexions philosophiques.
Repris par les philosophes
modernes comme les Utilitaristes ou les philosophes des Lumières, il est source
d’avis très divergents.
Plusieurs philosophes ont tenté de répondre à la question
suivante : « Y a-t-il un devoir de se rendre heureux ».
A priori, la formulation
semble paradoxale dans la mesure où le devoir s’oppose à la liberté et où le
bonheur au contraire la présuppose.
L’homme a pour quête naturelle le bonheur.
Celui-ci se définit par un état, stable, de satisfaction totale où rien ne manque et
auquel on aspire.
Le devoir désigne l’obligation morale ou sociale d’agir.
Au sens
strict, le devoir renvoi au respect exclusif de la loi morale.
C’est une obligation
absolue, un commandement qui s’oppose à la volonté.
Il n’est donc pas naturel à
l’Homme comme l’est le bonheur.
Alors, sommes-nous dans l’obligation de nous
rendre heureux ?
N’est-il pas absurde d’associer les notions de devoir et de bonheur ?
Pourquoi l’idée d’un devoir de rechercher le bonheur est-elle paradoxale ?
Pourtant cela ne signifie pas que le devoir morale condamne le bonheur.
Au
contraire, l’union de la moralité et du bonheur est utile pour tous.
La recherche du bonheur n’est pas un devoir.
Ainsi, être heureux ne peut
être un impératif moral.
Dire que c’est un devoir de rechercher le bonheur est un non-sens.
En effet, il
apparaît clairement si l’on interroge la nature de l’obligation morale.
Se sentir
obligé consiste à se sentir tenu d’obéir à une loi qui peut aller contre notre
volonté.
Ce qui signifie que l’injonction morale s’oppose à la tendance naturelle
et la contraint.
Or, y a-t-il un seul être au monde se sentant contraint de rechercher
le bonheur ? Probablement pas car, comme dit dans l’introduction, chacun tend
naturellement au bonheur.
Ça veut dire que là où il y a une tendance naturelle, il
n’y a aucun sens ni aucune utilité à formuler un impératif moral.
Il est donc
absurde de prescrire un devoir de rechercher le bonheur.
Par exemple, KANT dit
à travers ses 3 formulations de l’impératif que le devoir moral doit être accompli
indépendamment du bonheur.
Dans ce cas, la réciproque a plus de sens : le
bonheur est indépendant du devoir moral et donc de l’obligation.
Il dit aussi dans
l’introduction de la Doctrine de la vertu dans Métaphysique des mœurs : « Le
bonheur personnel, en effet, est une fin propre à tous les hommes (en raison de
l’inclination de leur nature), mais cette fin ne peut jamais être regardée comme un
devoir, sans que l’on se contredise.
Ce que chacun, inévitablement, veut déjà de
soi-même ne peut appartenir au concept du devoir ; en effet le devoir est une
contrainte en vue d’une fin qui n’est pas voulue de bon gré.
C’est donc se
contredire que de dire qu’on est obligé de réaliser de toutes ses forces son propre
bonheur ».
De cette façon, si l’on prend un exemple concret de la vie courante, on
ne peut être obligé de faire quelque chose que l’on aime et que l’on fait déjà par
passion car ça nous rend heureux.
Mais si le bonheur est perçu comme un devoir,
il prend la forme d’une obligation contre notre volonté, ce qui n’a définitivement
aucun sens puisque le bonheur est au fondement de notre volonté à faire certaines
choses.
La recherche du bonheur est aussi égoïste.
Comme dit dans le paragraphe
précédent, le bonheur est la finalité de la vie de chaque homme.
En effet, le sujet
du bonheur semble ne pouvoir revenir que sur soi-même.
« Je » suis ce sujet qui
vit ma vie avec mes émotions, mes sentiments, mes pensées.
On peut aider autrui
à trouver son bonheur dans la pensée d’une intention qui paraît désintéressée, mais
comment s’assurer que cela ne soit pas animé d’une raison qui provient de
l’inconscient, comme celui d’apaiser ma conscience ? Or, un tel sentiment incliné
vers l’intérêt de soi est contraire en vertu de l’altruisme universel, dont le devoir
est à l’origine.
En effet, agir par devoir c’est considérer les autres comme une fin
et non comme un moyen et ceci par respect pour cet autre qui est comme moi.
Et
donc, si le bonheur passe toujours par « l’usage » d’autrui, alors on considérerait
autrui comme un simple outil.
Ce qui est donc en totale opposition avec la
deuxième formulation de l’impératif catégorique de KANT : « Agis de telle sorte
que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout
autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un
moyen.
».
Par exemple, respecter la loi morale parce que ce respect ménage la
réputation de l’individu ou le préserve des désagréments de la sanction permet à
l’homme d’agir en conformité avec le devoir mais l’action conforme au devoir
n’est pas morale si elle n’a pas été accomplie par devoir car on est moral par la
pureté de l’intention.
La prise en considération du bonheur ou d’un autre intérêt
dans la détermination de la volonté l’empêche donc d’être une bonne volonté.
Cela reprend l’idée que se soucier de son bonheur est détaché du devoir moral.
De cette façon, le bonheur s’éloigne du devoir : il y a une incompatibilité entre le
devoir moral et la recherche du bonheur.
Enfin, l’idée du bonheur ne peut être universellement définie, car elle est
toujours constituée par des idéaux culturellement subjectifs.
En effet, les études
sociologiques révèlent qu’elle a différentes connotations pour différents types de
société.
Les sociétés qui tentent d’harmoniser les responsabilités, comme celle du
Japon, font référence à un sentiment de paix dans l’ordre harmonieux.
A contrario,
les sociétés qui privilégient les prouesses et les accomplissements individuels de
ses membres évoquent le sentiment du succès à travers les défis.
Si le bonheur ne
reste qu’une notion dont le contenu n’est pas objectif, alors elle ne peut être réglée
dans un raisonnement logique.
Il est donc difficile de considérer la recherche du
bonheur comme une obligation morale, car elle ne découle pas d’une nécessité
objective et universellement définie.
De plus, si l’impératif moral contrarie la
tendance naturelle, il va de soi qu’il peut y avoir une contradiction entre le devoir
et le bonheur.
Par exemple, si le bonheur d’un individu est d’être aimé par la
femme de son ami, il s’ensuit que ce qui le rendrait heureux est en contradiction
avec ce qui le rendrait moralement bon.
Ou alors si le bonheur d’un individu est
de tuer des gens, il est aux antipodes de la morale.
Ainsi, le bonheur est défini
différemment selon les sociétés et selon les individus.
Mais il peut être en totale
contradiction avec le devoir moral.
Après cette première partie, il semble que le devoir moral et le bonheur ne
sont pas de même nature.
Poursuivre le bonheur est la fin d’être sensible alors que
la moralité est la fin d’être raisonnable.
Mais l’opposition n’est pas absolue.
La
moralité est considérée comme le bien suprême mais le bien complet nous semble
être l’union de la vertu et du bonheur.
Mais alors comment l’envisager sans se
contredire ?
Il existe donc tout de même un devoir de rechercher le bonheur.
Selon les
philosophes antiques comme les épicuriens, le bonheur est la cause de la moralité
donc chercher son bonheur c’est devenir un être moral.
Ainsi, si l’on cherche à se
rendre heureux, on deviendra inéluctablement des êtres moraux.
Selon les
stoïciens, pour être heureux il faut être vertueux.
Être vertueux repose sur le fait
d’être moral.
Et la réciproque peut aussi s’avérer vraie, il est donc nécessaire
d’être heureux pour faire le bien.
Par exemple, quelqu’un connaissant le bonheur
au quotidien, voudra en principe le faire connaître à ceux....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Y a-t-il un devoir d'être heureux ?
- Faire son devoir sans etre heureux, est-ce toute la morale ?
- Faire notre devoir nous empêche-t-il d'être heureux ?
- Faut il renoncer à être heureux pour faire son devoir?
- La morale consiste-t-elle à faire son devoir sans être heureux?