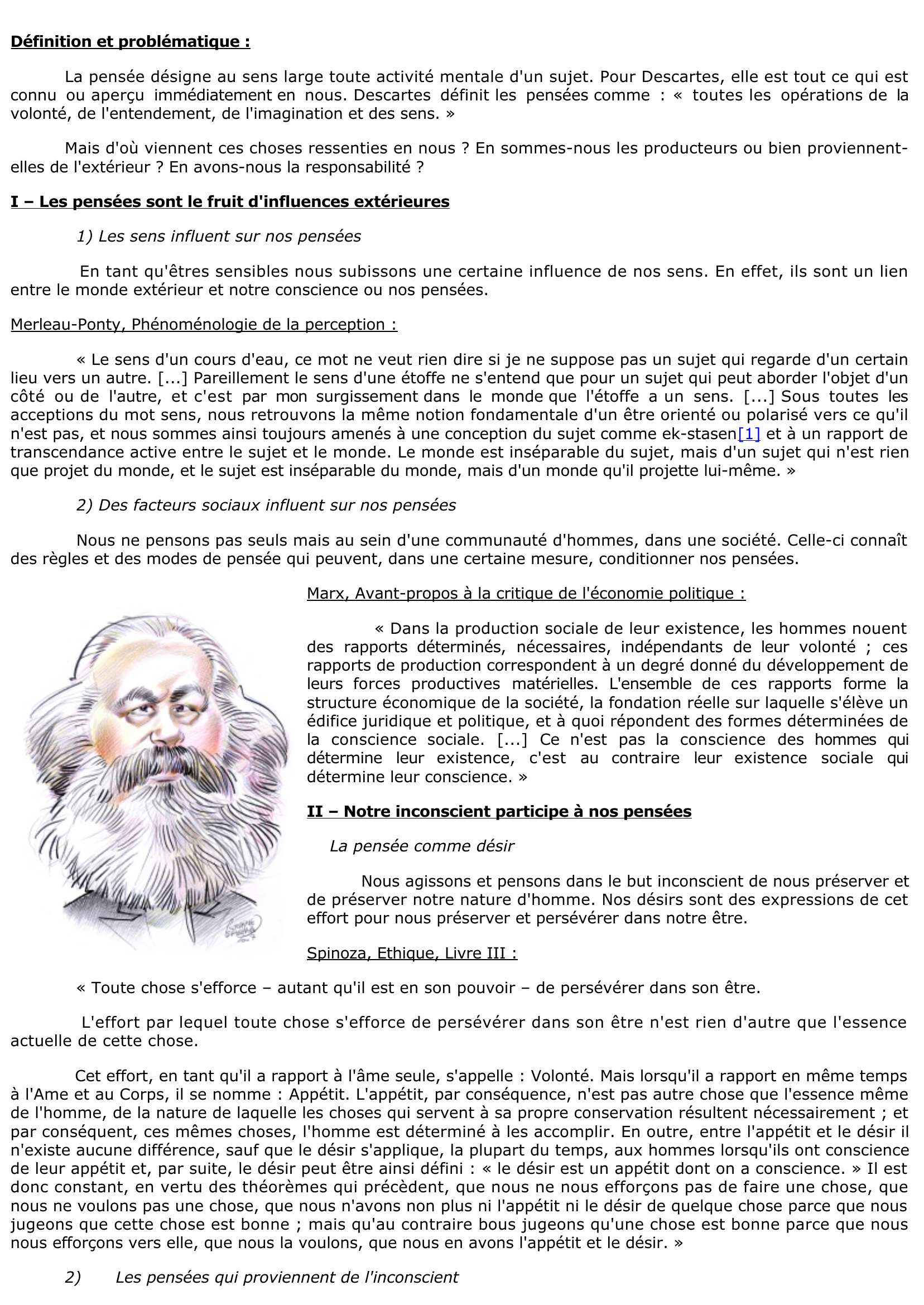Sommes-nous maître de nos pensées ?
Extrait du document
«
Définition et problématique :
La pensée désigne au sens large toute activité mentale d'un sujet.
Pour Descartes, elle est tout ce qui est
connu ou aperçu immédiatement en nous.
Descartes définit les pensées comme : « toutes les opérations de la
volonté, de l'entendement, de l'imagination et des sens.
»
Mais d'où viennent ces choses ressenties en nous ? En sommes-nous les producteurs ou bien proviennentelles de l'extérieur ? En avons-nous la responsabilité ?
I – Les pensées sont le fruit d'influences extérieures
1) Les sens influent sur nos pensées
En tant qu'êtres sensibles nous subissons une certaine influence de nos sens.
En effet, ils sont un lien
entre le monde extérieur et notre conscience ou nos pensées.
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception :
« Le sens d'un cours d'eau, ce mot ne veut rien dire si je ne suppose pas un sujet qui regarde d'un certain
lieu vers un autre.
[...] Pareillement le sens d'une étoffe ne s'entend que pour un sujet qui peut aborder l'objet d'un
côté ou de l'autre, et c'est par mon surgissement dans le monde que l'étoffe a un sens.
[...] Sous toutes les
acceptions du mot sens, nous retrouvons la même notion fondamentale d'un être orienté ou polarisé vers ce qu'il
n'est pas, et nous sommes ainsi toujours amenés à une conception du sujet comme ek-stasen[1] et à un rapport de
transcendance active entre le sujet et le monde.
Le monde est inséparable du sujet, mais d'un sujet qui n'est rien
que projet du monde, et le sujet est inséparable du monde, mais d'un monde qu'il projette lui-même.
»
2) Des facteurs sociaux influent sur nos pensées
Nous ne pensons pas seuls mais au sein d'une communauté d'hommes, dans une société.
Celle-ci connaît
des règles et des modes de pensée qui peuvent, dans une certaine mesure, conditionner nos pensées.
Marx, Avant-propos à la critique de l'économie politique :
« Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent
des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces
rapports de production correspondent à un degré donné du développement de
leurs forces productives matérielles.
L'ensemble de ces rapports forme la
structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un
édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de
la conscience sociale.
[...] Ce n'est pas la conscience des hommes qui
détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui
détermine leur conscience.
»
II – Notre inconscient participe à nos pensées
1)
La pensée comme désir
Nous agissons et pensons dans le but inconscient de nous préserver et
de préserver notre nature d'homme.
Nos désirs sont des expressions de cet
effort pour nous préserver et persévérer dans notre être.
Spinoza, Ethique, Livre III :
« Toute chose s'efforce – autant qu'il est en son pouvoir – de persévérer dans son être.
L'effort par lequel toute chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence
actuelle de cette chose.
Cet effort, en tant qu'il a rapport à l'âme seule, s'appelle : Volonté.
Mais lorsqu'il a rapport en même temps
à l'Ame et au Corps, il se nomme : Appétit.
L'appétit, par conséquence, n'est pas autre chose que l'essence même
de l'homme, de la nature de laquelle les choses qui servent à sa propre conservation résultent nécessairement ; et
par conséquent, ces mêmes choses, l'homme est déterminé à les accomplir.
En outre, entre l'appétit et le désir il
n'existe aucune différence, sauf que le désir s'applique, la plupart du temps, aux hommes lorsqu'ils ont conscience
de leur appétit et, par suite, le désir peut être ainsi défini : « le désir est un appétit dont on a conscience.
» Il est
donc constant, en vertu des théorèmes qui précèdent, que nous ne nous efforçons pas de faire une chose, que
nous ne voulons pas une chose, que nous n'avons non plus ni l'appétit ni le désir de quelque chose parce que nous
jugeons que cette chose est bonne ; mais qu'au contraire bous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous
nous efforçons vers elle, que nous la voulons, que nous en avons l'appétit et le désir.
»
2)
Les pensées qui proviennent de l'inconscient.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « Je dirai de l'argent ce qu'on disait de Caligula, qu'il n'y avait jamais eu un si bon esclave et un si méchant maître ». Mes Pensées, 1127 Montesquieu, Charles de Secondat, baron de ?
- Suffit-il de devenir le maître de ses pensées pour l'etre de ses sentiments ?
- Suffit-il de devenir le maître de ses pensées pour l'être de ses sentiments ?
- Suffit-il de devenir le maître de ses pensées pour l'être de ses sentiments ?
- Commentaire Blaise pascal, Pensées: richesse et vérité