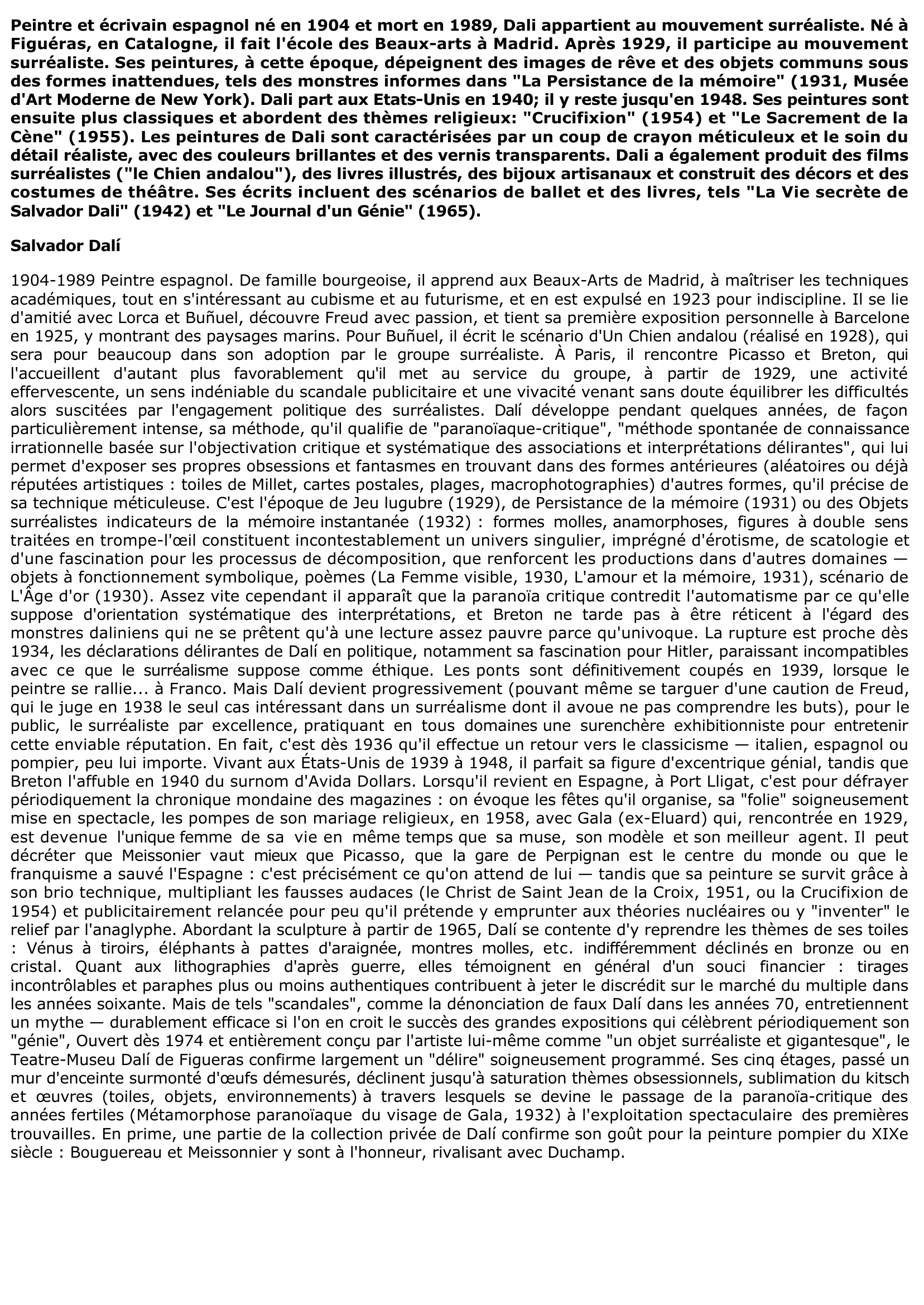Salvador Dalí
Extrait du document
Peintre espagnol. De famille bourgeoise, il apprend aux Beaux-Arts de Madrid, à maîtriser les techniques académiques, tout en s'intéressant au cubisme et au futurisme, et en est expulsé en 1923 pour indiscipline. Il se lie d'amitié avec Lorca et Buñuel, découvre Freud avec passion, et tient sa première exposition personnelle à Barcelone en 1925, y montrant des paysages marins. Pour Buñuel, il écrit le scénario d'Un Chien andalou (réalisé en 1928), qui sera pour beaucoup dans son adoption par le groupe surréaliste. À Paris, il rencontre Picasso et Breton, qui l'accueillent d'autant plus favorablement qu'il met au service du groupe, à partir de 1929, une activité effervescente, un sens indéniable du scandale publicitaire et une vivacité venant sans doute équilibrer les difficultés alors suscitées par l'engagement politique des surréalistes. Dalí développe pendant quelques années, de façon particulièrement intense, sa méthode, qu'il qualifie de "paranoïaque-critique", "méthode spontanée de connaissance irrationnelle basée sur l'objectivation critique et systématique des associations et interprétations délirantes", qui lui permet d'exposer ses propres obsessions et fantasmes en trouvant dans des formes antérieures (aléatoires ou déjà réputées artistiques : toiles de Millet, cartes postales, plages, macrophotographies) d'autres formes, qu'il précise de sa technique méticuleuse. C'est l'époque de Jeu lugubre (1929), de Persistance de la mémoire (1931) ou des Objets surréalistes indicateurs de la mémoire instantanée (1932) : formes molles, anamorphoses, figures à double sens traitées en trompe-l'oeil constituent incontestablement un univers singulier, imprégné d'érotisme, de scatologie et d'une fascination pour les processus de décomposition, que renforcent les productions dans d'autres domaines - objets à fonctionnement symbolique, poèmes (La Femme visible, 1930, L'amour et la mémoire, 1931), scénario de L'Âge d'or (1930).
«
Peintre et écrivain espagnol né en 1904 et mort en 1989, Dali appartient au mouvement surréaliste.
Né à
Figuéras, en Catalogne, il fait l'école des Beaux-arts à Madrid.
Après 1929, il participe au mouvement
surréaliste.
Ses peintures, à cette époque, dépeignent des images de rêve et des objets communs sous
des formes inattendues, tels des monstres informes dans "La Persistance de la mémoire" (1931, Musée
d'Art Moderne de New York).
Dali part aux Etats-Unis en 1940; il y reste jusqu'en 1948.
Ses peintures sont
ensuite plus classiques et abordent des thèmes religieux: "Crucifixion" (1954) et "Le Sacrement de la
Cène" (1955).
Les peintures de Dali sont caractérisées par un coup de crayon méticuleux et le soin du
détail réaliste, avec des couleurs brillantes et des vernis transparents.
Dali a également produit des films
surréalistes ("le Chien andalou"), des livres illustrés, des bijoux artisanaux et construit des décors et des
costumes de théâtre.
Ses écrits incluent des scénarios de ballet et des livres, tels "La Vie secrète de
Salvador Dali" (1942) et "Le Journal d'un Génie" (1965).
Salvador Dalí
1904-1989 Peintre espagnol.
De famille bourgeoise, il apprend aux Beaux-Arts de Madrid, à maîtriser les techniques
académiques, tout en s'intéressant au cubisme et au futurisme, et en est expulsé en 1923 pour indiscipline.
Il se lie
d'amitié avec Lorca et Buñuel, découvre Freud avec passion, et tient sa première exposition personnelle à Barcelone
en 1925, y montrant des paysages marins.
Pour Buñuel, il écrit le scénario d'Un Chien andalou (réalisé en 1928), qui
sera pour beaucoup dans son adoption par le groupe surréaliste.
À Paris, il rencontre Picasso et Breton, qui
l'accueillent d'autant plus favorablement qu'il met au service du groupe, à partir de 1929, une activité
effervescente, un sens indéniable du scandale publicitaire et une vivacité venant sans doute équilibrer les difficultés
alors suscitées par l'engagement politique des surréalistes.
Dalí développe pendant quelques années, de façon
particulièrement intense, sa méthode, qu'il qualifie de "paranoïaque-critique", "méthode spontanée de connaissance
irrationnelle basée sur l'objectivation critique et systématique des associations et interprétations délirantes", qui lui
permet d'exposer ses propres obsessions et fantasmes en trouvant dans des formes antérieures (aléatoires ou déjà
réputées artistiques : toiles de Millet, cartes postales, plages, macrophotographies) d'autres formes, qu'il précise de
sa technique méticuleuse.
C'est l'époque de Jeu lugubre (1929), de Persistance de la mémoire (1931) ou des Objets
surréalistes indicateurs de la mémoire instantanée (1932) : formes molles, anamorphoses, figures à double sens
traitées en trompe-l'œil constituent incontestablement un univers singulier, imprégné d'érotisme, de scatologie et
d'une fascination pour les processus de décomposition, que renforcent les productions dans d'autres domaines —
objets à fonctionnement symbolique, poèmes (La Femme visible, 1930, L'amour et la mémoire, 1931), scénario de
L'Âge d'or (1930).
Assez vite cependant il apparaît que la paranoïa critique contredit l'automatisme par ce qu'elle
suppose d'orientation systématique des interprétations, et Breton ne tarde pas à être réticent à l'égard des
monstres daliniens qui ne se prêtent qu'à une lecture assez pauvre parce qu'univoque.
La rupture est proche dès
1934, les déclarations délirantes de Dalí en politique, notamment sa fascination pour Hitler, paraissant incompatibles
avec ce que le surréalisme suppose comme éthique.
Les ponts sont définitivement coupés en 1939, lorsque le
peintre se rallie...
à Franco.
Mais Dalí devient progressivement (pouvant même se targuer d'une caution de Freud,
qui le juge en 1938 le seul cas intéressant dans un surréalisme dont il avoue ne pas comprendre les buts), pour le
public, le surréaliste par excellence, pratiquant en tous domaines une surenchère exhibitionniste pour entretenir
cette enviable réputation.
En fait, c'est dès 1936 qu'il effectue un retour vers le classicisme — italien, espagnol ou
pompier, peu lui importe.
Vivant aux États-Unis de 1939 à 1948, il parfait sa figure d'excentrique génial, tandis que
Breton l'affuble en 1940 du surnom d'Avida Dollars.
Lorsqu'il revient en Espagne, à Port Lligat, c'est pour défrayer
périodiquement la chronique mondaine des magazines : on évoque les fêtes qu'il organise, sa "folie" soigneusement
mise en spectacle, les pompes de son mariage religieux, en 1958, avec Gala (ex-Eluard) qui, rencontrée en 1929,
est devenue l'unique femme de sa vie en même temps que sa muse, son modèle et son meilleur agent.
Il peut
décréter que Meissonier vaut mieux que Picasso, que la gare de Perpignan est le centre du monde ou que le
franquisme a sauvé l'Espagne : c'est précisément ce qu'on attend de lui — tandis que sa peinture se survit grâce à
son brio technique, multipliant les fausses audaces (le Christ de Saint Jean de la Croix, 1951, ou la Crucifixion de
1954) et publicitairement relancée pour peu qu'il prétende y emprunter aux théories nucléaires ou y "inventer" le
relief par l'anaglyphe.
Abordant la sculpture à partir de 1965, Dalí se contente d'y reprendre les thèmes de ses toiles
: Vénus à tiroirs, éléphants à pattes d'araignée, montres molles, etc.
indifféremment déclinés en bronze ou en
cristal.
Quant aux lithographies d'après guerre, elles témoignent en général d'un souci financier : tirages
incontrôlables et paraphes plus ou moins authentiques contribuent à jeter le discrédit sur le marché du multiple dans
les années soixante.
Mais de tels "scandales", comme la dénonciation de faux Dalí dans les années 70, entretiennent
un mythe — durablement efficace si l'on en croit le succès des grandes expositions qui célèbrent périodiquement son
"génie", Ouvert dès 1974 et entièrement conçu par l'artiste lui-même comme "un objet surréaliste et gigantesque", le
Teatre-Museu Dalí de Figueras confirme largement un "délire" soigneusement programmé.
Ses cinq étages, passé un
mur d'enceinte surmonté d'œufs démesurés, déclinent jusqu'à saturation thèmes obsessionnels, sublimation du kitsch
et œuvres (toiles, objets, environnements) à travers lesquels se devine le passage de la paranoïa-critique des
années fertiles (Métamorphose paranoïaque du visage de Gala, 1932) à l'exploitation spectaculaire des premières
trouvailles.
En prime, une partie de la collection privée de Dalí confirme son goût pour la peinture pompier du XIXe
siècle : Bouguereau et Meissonnier y sont à l'honneur, rivalisant avec Duchamp..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓