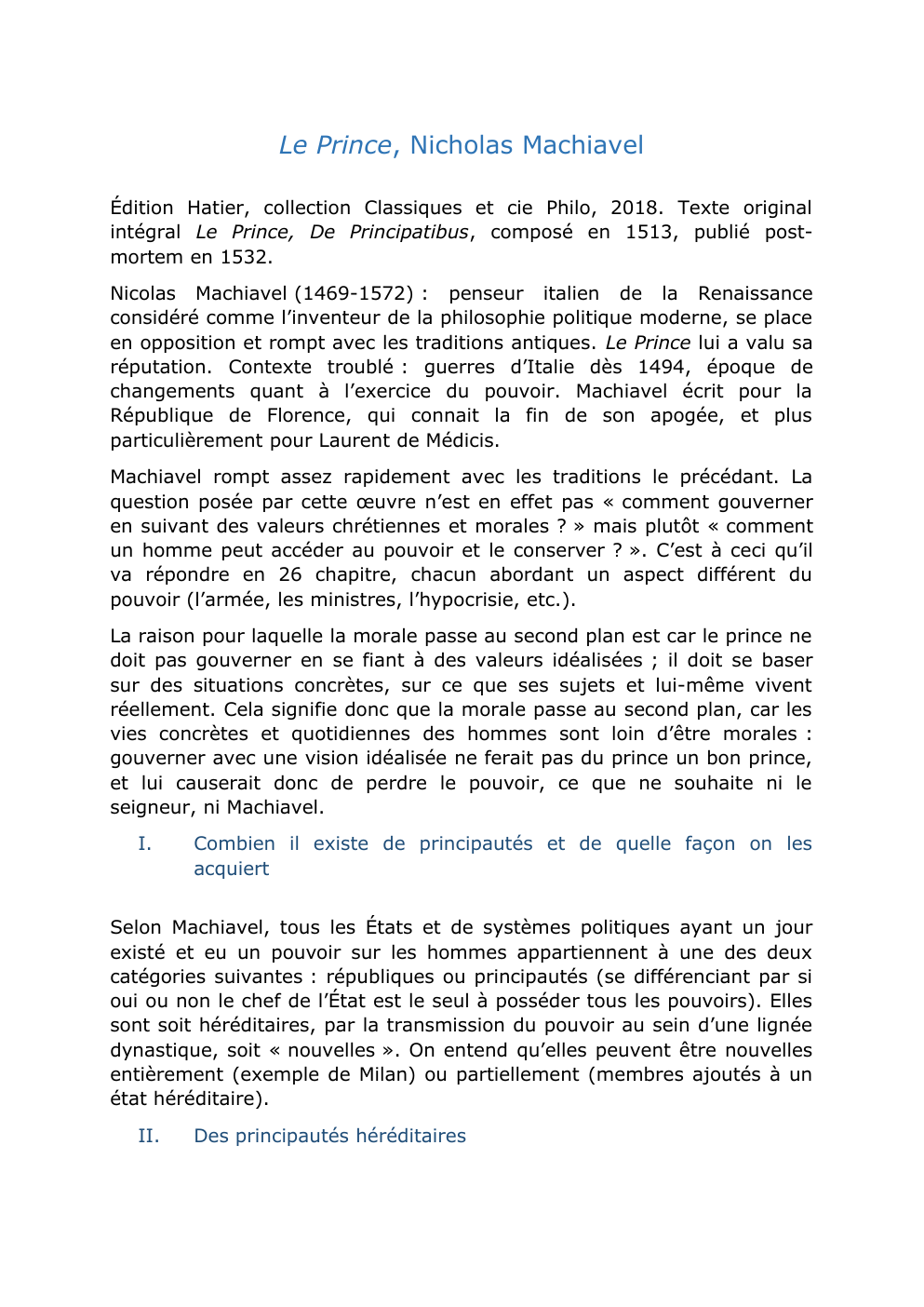Résumé par chapitre du Prince de Machiavel
Publié le 23/04/2025
Extrait du document
«
Le Prince, Nicholas Machiavel
Édition Hatier, collection Classiques et cie Philo, 2018.
Texte original
intégral Le Prince, De Principatibus, composé en 1513, publié postmortem en 1532.
Nicolas Machiavel (1469-1572) : penseur italien de la Renaissance
considéré comme l’inventeur de la philosophie politique moderne, se place
en opposition et rompt avec les traditions antiques.
Le Prince lui a valu sa
réputation.
Contexte troublé : guerres d’Italie dès 1494, époque de
changements quant à l’exercice du pouvoir.
Machiavel écrit pour la
République de Florence, qui connait la fin de son apogée, et plus
particulièrement pour Laurent de Médicis.
Machiavel rompt assez rapidement avec les traditions le précédant.
La
question posée par cette œuvre n’est en effet pas « comment gouverner
en suivant des valeurs chrétiennes et morales ? » mais plutôt « comment
un homme peut accéder au pouvoir et le conserver ? ».
C’est à ceci qu’il
va répondre en 26 chapitre, chacun abordant un aspect différent du
pouvoir (l’armée, les ministres, l’hypocrisie, etc.).
La raison pour laquelle la morale passe au second plan est car le prince ne
doit pas gouverner en se fiant à des valeurs idéalisées ; il doit se baser
sur des situations concrètes, sur ce que ses sujets et lui-même vivent
réellement.
Cela signifie donc que la morale passe au second plan, car les
vies concrètes et quotidiennes des hommes sont loin d’être morales :
gouverner avec une vision idéalisée ne ferait pas du prince un bon prince,
et lui causerait donc de perdre le pouvoir, ce que ne souhaite ni le
seigneur, ni Machiavel.
I.
Combien il existe de principautés et de quelle façon on les
acquiert
Selon Machiavel, tous les États et de systèmes politiques ayant un jour
existé et eu un pouvoir sur les hommes appartiennent à une des deux
catégories suivantes : républiques ou principautés (se différenciant par si
oui ou non le chef de l’État est le seul à posséder tous les pouvoirs).
Elles
sont soit héréditaires, par la transmission du pouvoir au sein d’une lignée
dynastique, soit « nouvelles ».
On entend qu’elles peuvent être nouvelles
entièrement (exemple de Milan) ou partiellement (membres ajoutés à un
état héréditaire).
II.
Des principautés héréditaires
Machiavel explique que dans Le Prince, il va se focaliser sur les
principautés et non les républiques, ces dernières ayant déjà été soumises
à sa réflexion, en reprenant la classification introduite précédemment.
Il
affirme qu’il est moins difficile de conserver le pouvoir dans les
principautés héréditaires, car il existe une habitude liée à l’ordre
dynastique, et le changement de souverain s’effectue généralement sans
grands problèmes tant qu’il n’y a pas introduction de changements
majeurs.
Le prince « naturel » est généralement plus aimé de la
population car il a moins de raisons d’opprimer cette dernière.
III.
Des principautés mixtes
Le prince qui gouverne une principauté mixe fait face à plusieurs
difficultés : la première se trouve dans le fait que ses ennemis sont
doubles.
A la fois ceux à qui l’ordre d’avant bénéficiait, et ceux qui l’ont
appuyé et qu’il ne peut pas aider ou rembourser, tant qu’il n’est pas bien
assuré à la tête de son État.
Machiavel avance alors plusieurs conseils.
Si les deux États sont proches
(conquérant et conquis), il faut réussir à « éteindre » et faire disparaître
toute trace du prince qui y gouvernait auparavant, tout en gardant le
même fonctionnement de la société, pour que les sujets s’adaptent sans
trop de vagues au nouveau prince.
Sinon, le prince doit alors vivre
pleinement dans son nouvel État, pour faire face aux révoltes et attaques
internes comme externes ; il doit aussi mettre en place des colonies afin
de garder son influence et d’éviter d’entretenir une armée couteuse.
Il
conseille également de mettre en place un jeu d’alliance assez fin : avec
des États faibles sans les rendre puissant et des États plus forts sans se
les mettre à dos.
IV.
Pour quelles raisons le royaume de Darius, qui fut occupé par
Alexandre le Grand, ne se rebella point contre ses successeurs
après la mort de celui-ci
Machiavel, tout au long de son œuvre, fait référence à des événements
historiques pour expliquer ses idées et illustrer ses conseils.
Notamment, il
questionne le fait que les populations et territoires conquis sur Darius par
Alexandre ne se soient pas révoltés après sa mort.
Il décrit alors deux
sortes d'États : d'une part, un État (comme le royaume de France)
gouverné par « un prince et ses barons » (donc un prince et d’autres
nobles puissants) peut être facilement conquis, car il se trouve toujours
un noble ennemi du prince régnant qui appuiera le conquérant, mais il est
aussi facilement perdu, pour la même raison, de manière cyclique ;
d’autre part, un État comme la Turquie, avec « un prince et ses esclaves »
ne connaissant pas d'opposition interne liée à des individus de même rang
que le prince est ensuite facilement conservé (bien que conquis seulement
par la guerre).
Le gouvernement de Darius était semblable à celui de la
Turquie, ce qui explique pourquoi, une fois la victoire militaire d’Alexandre
le Grand établie, il y a eu si peu de problèmes.
V.
De quelle façon on doit gouverner les cités ou principautés qui,
avant d’être occupées, vivaient sous leurs propres lois
Face à ce problème, trois solutions : détruire les États conquis, y vivre (on
peut penser à l’exemple des principautés mixtes au chapitre III), ou
« laisser leurs lois, se bornant à exiger un tribut, et à y établir un
gouvernement peu nombreux qui les contiendra dans l’obéissance et la
fidélité » au peuple ; ainsi, en ne changeant que peu le système politique,
il risque de moins perturber les sujets et éviter toute contestation ou
révolte.
Cependant, si un prince avait déjà régné auparavant, ses habitants
devraient accueillir un conquérant sans trop de remous si la lignée du
prince est totalement éradiquée (comme Machiavel l’expliquait
antérieurement dans le chapitre 2, avec l’exemple des principautés
héréditaires).
VI.
Des principautés nouvelles que l’on acquiert avec ses propres
armes et sa valeur
Un homme qui ne prend pas le pouvoir par la conquête « est un homme
habile ou bien secondé par la fortune », certes, mais est un homme qui
devient redevable à la fortune.
La voie la plus sûre pour accéder au
pouvoir est donc celle de « ceux qui sont devenus princes par leur valeur
et non par fortune », comme les figures antiques et quasi-mythiques de
Moïse, Cyrus, Romulus et Thésée.
Ces derniers sont devenus « princes » par leurs capacités ; le hasard et la
fortune se sont seulement manifestés quant à l’occasion de prendre le
pouvoir, comme on peut le voir avec l’exemple de Cyrus dont la conquête
a réussi en grande partie par des conjonctures lui étant extérieures.
Ils
font cependant quand même face à des difficultés, notamment quand il
s’agit de la mise en place d’institutions : le prince devra faire face à ceux
qui profitaient de l’ancien ordre, alors que les autres ne seront que de «
tièdes défenseurs » tant que les institutions n’auront pas encore eu
d’effets réels.
VII.
Des principautés nouvelles que l’on acquiert avec les armes et la
fortune d’autrui
Les princes partis de peu font donc face à de nombreuses exigences : il
leur faut « assez d’habileté pour savoir se préparer sur-le-champ à
conserver ce que la fortune a mis dans leurs mains, et pour fonder, après
l’élévation de leur puissance, les bases qui auraient dû être établies
auparavant ».
Machiavel choisit l'exemple de César Borgia, car il en fut
prince que par la fortune ; or, dès que la fortune l’abandonna, il perdit le
contrôle sur sa principauté et ses sujets, même en ayant mis en place des
stratégies de règne avisées.
La fortune, qui semble pourtant avoir appuyé
tant de grands, apparaît alors comme une force assez volatile.
VIII.
De ceux qui sont devenus princes par scélératesse
On peut aussi devenir prince par la scélératesse, ce dont Machiavel donne
deux exemples : celui d’Agathocle de Syracuse qui, après avoir été
déclaré prince par rapport à son mérite militaire, a fait convoqué et
assassiné tous ses opposants potentiels ; et celui d’Oliverotto da Fermo
qui fit assassiner son oncle et ses convives en introduisant ses hommes
dans la ville, afin de lui aussi garder le pouvoir pour lui-même.
Machiavel oscille entre la désapprobation d’un point de vue morale et
l’approbation politique de ses actions.
Il qualifie ainsi Agathocle de
courageux, loue sa « force d'âme », mais met aussi l’accent sur de « ses
nombreuses scélératesses ».
Il se demande comment la cruauté du
prince, qui en général est l’objet des révoltes populaires et qui met à mal
bien des projets politiques, peut être exercée en même temps qu’un
pouvoir sans faille, quasiment absolu.
Il déduit par la suite qu’il faut que
toutes les cruautés et injustices soient faites en même temps pour que le
ressentiment du peuple ne soit que temporaire et ne s’étale par sur des
années de règnes....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Explication de texte: Machiavel, Le Prince: savoir simuler et dissimuler
- MACHIAVEL: «...Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir n'être pas bon, et d'en user et n'user pas selon la nécessité.»
- Machiavel: La vertu du prince
- Machiavel, Le Prince, Chap. VII, rédigé en 1513, publié en 1532, trad. J. Anglade, Livre de poche, pp. 37-38
- MACHIAVEL: Un prince doit s'efforcer de se faire une réputation de bonté