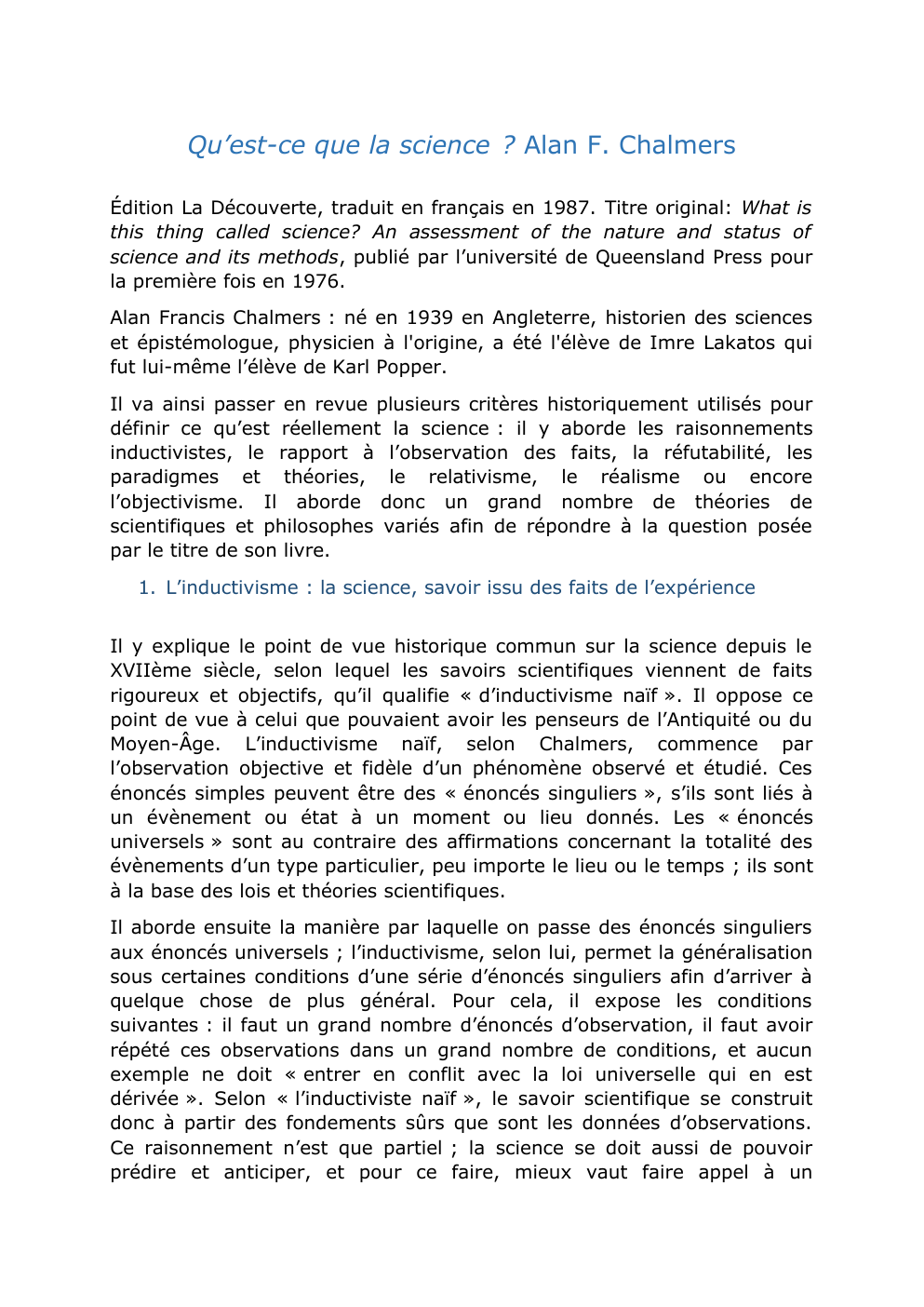Résumé par chapitre de "Qu'est ce que la science ?" d'Alan Chalmers
Publié le 23/04/2025
Extrait du document
«
Qu’est-ce que la science ? Alan F.
Chalmers
Édition La Découverte, traduit en français en 1987.
Titre original: What is
this thing called science? An assessment of the nature and status of
science and its methods, publié par l’université de Queensland Press pour
la première fois en 1976.
Alan Francis Chalmers : né en 1939 en Angleterre, historien des sciences
et épistémologue, physicien à l'origine, a été l'élève de Imre Lakatos qui
fut lui-même l’élève de Karl Popper.
Il va ainsi passer en revue plusieurs critères historiquement utilisés pour
définir ce qu’est réellement la science : il y aborde les raisonnements
inductivistes, le rapport à l’observation des faits, la réfutabilité, les
paradigmes et théories, le relativisme, le réalisme ou encore
l’objectivisme.
Il aborde donc un grand nombre de théories de
scientifiques et philosophes variés afin de répondre à la question posée
par le titre de son livre.
1.
L’inductivisme : la science, savoir issu des faits de l’expérience
Il y explique le point de vue historique commun sur la science depuis le
XVIIème siècle, selon lequel les savoirs scientifiques viennent de faits
rigoureux et objectifs, qu’il qualifie « d’inductivisme naïf ».
Il oppose ce
point de vue à celui que pouvaient avoir les penseurs de l’Antiquité ou du
Moyen-Âge.
L’inductivisme naïf, selon Chalmers, commence par
l’observation objective et fidèle d’un phénomène observé et étudié.
Ces
énoncés simples peuvent être des « énoncés singuliers », s’ils sont liés à
un évènement ou état à un moment ou lieu donnés.
Les « énoncés
universels » sont au contraire des affirmations concernant la totalité des
évènements d’un type particulier, peu importe le lieu ou le temps ; ils sont
à la base des lois et théories scientifiques.
Il aborde ensuite la manière par laquelle on passe des énoncés singuliers
aux énoncés universels ; l’inductivisme, selon lui, permet la généralisation
sous certaines conditions d’une série d’énoncés singuliers afin d’arriver à
quelque chose de plus général.
Pour cela, il expose les conditions
suivantes : il faut un grand nombre d’énoncés d’observation, il faut avoir
répété ces observations dans un grand nombre de conditions, et aucun
exemple ne doit « entrer en conflit avec la loi universelle qui en est
dérivée ».
Selon « l’inductiviste naïf », le savoir scientifique se construit
donc à partir des fondements sûrs que sont les données d’observations.
Ce raisonnement n’est que partiel ; la science se doit aussi de pouvoir
prédire et anticiper, et pour ce faire, mieux vaut faire appel à un
raisonnement déductif, raisonnement qui, selon Chalmers, est le seul à
constituer la logique.
Une déduction logiquement valide implique une
correspondance entre les prémisses (A=B, B=C) et la conclusion (A=C).
Il
explique également que la déduction peut être valide sans être vraie
(« Tous les chats ont 5 pattes » « Gromatou est mon chat » « Gromatou a
cinq pattes »), et ne représente donc pas une source unique d’énoncés
vrais sur le monde.
Il explique ensuite l’attrait global et reconnu du point
de vue inductivisme, en nous mettant en garde contre son caractère
trompeur et faux.
2.
Le problème de l’induction
Chalmers explique ensuite qu’il discerne deux manières de justifier le
principe de l’induction d’après les inductivistes naïfs ; la logique et
l’expérience.
Quand il parle de la logique, il fait référence à un problème
évoqué précédemment : un raisonnement inductiviste peut être logique
sans être vrai.
Cependant, la logique ne garantit pas que ce qu’on a
considéré comme vrai à un certain moment par induction ne peut pas être
faux le moment suivant.
Il n’y a également pas de contradiction à affirmer
que tous les corbeaux observés sont noirs mais que tous les corbeaux ne
sont pas noirs.
Il illustre ce paradoxe logique en faisant référence à la dinde inductiviste
de Bertrand Russell, dont l’histoire est assez connue.
Il continue ensuite
en expliquant qu’un inductiviste peut défendre ce point de vue en
invoquant le nombre de loi et théories scientifiques ayant pour base
l’induction et fonctionnant sans problème à ce jour.
Cependant, en faisant
référence au philosophe David Hume, il montre que ce point de vue n’est
pas acceptable car il utilise le même type de fonctionnement que les
raisonnements que l’on a prouvés.
Chalmers examine ensuite la question
de la probabilité en science : les généralisations obtenues par induction ne
sont pas des vérités garanties, mais elles sont probablement vraies.
Cependant, introduire la question de la probabilité ne résout toujours pas
le problème inhérent de l’induction quant au caractère vrai que la
conclusion établit.
Il faut en effet prendre en compte la question du degré
de probabilité, qui remet donc encore une fois en cause la thèse
inductiviste.
L’auteur va ensuite énumérer plusieurs attitudes qu’il est
possible d’adopter face à ces conclusions : le scepticisme (point de vue
similaire à celui de Hume), admettre qu’il faut une argumentation plus
sophistiquée que la simple évidence inductiviste, ou le déni du fait que la
science soit basée sur l’induction (idée du falsificationisme et de Karl
Popper).
3.
La dépendance de l’observation par rapport à la théorie
Chalmers commence par exposer un point de vue commun sur le rapport
à l’observation en science, point de vue qu’il assimile à celui d’un
inductiviste naïf.
Il se base pour se faire sur le sens de la vue, en assurant
que son raisonnement devrait pouvoir s’appliquer aux autres sens
également.
Il explique donc que même si deux individus voient « le même
objet du même endroit dans les mêmes conditions physiques », c’est-àdire que leurs rétines capteront deux images identiques ; cependant, leur
perception de cette dernière peut changer.
C’est l’exemple d’une illusion
d’optique : l’image sur la rétine reste la même, mais notre perception de
cette dernière peut changer et nous faire deviner des images différentes.
Ainsi, se baser sur l’observation comme base de toute la science semble
déjà présenter une forme de faiblesse.
Il cite N.
R.
Hanson, un
universitaire de Cambridge, pour appuyer sa démonstration.
L’expérience
visuelle globale d’un individu qui voit un objet dépend en effet de l’image
sur la rétine, mais aussi de ses attentes, de ses expériences passées et de
ses connaissances.
Il aborde ensuite les énoncés d’observations ainsi justifiés par ce que les
individus perçoivent.
Les énoncés d’observation sont des paroles
partagées, formulées dans un langage commun, et qui contiennent
diverses théories plus ou moins variées.
Or, Chalmers démontre qu’il est
bien préférable que des théories, des concepts précèdent et expliquent les
observations : on ne dit pas de quelque chose qu’il est rouge car on l’a
observé, mais car on connaît le concept de ‘rouge’.
Il explique ensuite que
chaque énoncé entraîne avec lui une série de différents présupposés à
démontrer, et que même si on fait un certain nombre d’expériences
d’observation, on n’arrivera pas à une certitude absolue.
Cela démontre
une forme d’aporie ainsi liée à l’inductivisme.
Ainsi, les expériences et les observations ne sont pertinentes en science
que lorsqu’elles viennent après une théorie, pour la tester et la mettre en
lumière ; même si la théorie parait erronée, il faut corriger cette erreur en
améliorant cette dernière et non en accumulant trop d’observations.
Il
conclut enfin ses différentes critiques sur l’inductivisme en ajoutant que
selon lui, ce dernier a échoué à éclairer la nature précise de la science et
paraît presque ‘obsolète’, alors que d’autres visions de la science sont bien
plus intéressantes et pertinentes.
4.
Introduction au falsificationisme
Chalmers différencie immédiatement le falsificationiste de l’inductiviste,
car le premier n’a pas de mal à accepter la conclusion précédente, soit
celle que l’observation est guidée par la théorie.
Il explique ensuite que
selon l’idée du falsificationisme, on peut démontrer que certaines théories
sont fausses grâce à des résultats d’observation et d’expérience ; ainsi,
c’est une théorie qui va exploiter au maximum le fait que le caractère faux
d’un énoncé universel relève d’un seul énoncé singulier ne suivant pas ce
premier énoncé.
Pour le falsificationisme, la science est un ensemble d’hypothèses visant à
décrire ou à expliquer précisément le fonctionnement d’une partie du
monde ou de l’univers.
Cependant, pour faire partie de la science, une
hypothèse se doit d’être falsifiable ; elle l’est quand la logique autorise
l’existence d’un ou plusieurs énoncés d’observation contradictoires, qui la
falsifieraient s’ils étaient vrais.
Est falsifiable « il ne pleut jamais le
mercredi », ne l’est pas « soit il pleut soit il ne pleut pas », par exemple.
Si la science n’était faite que d’énoncés infalsifiables, le monde pourrait
avoir n’importe quelle propriété sans que rien n’entre jamais en conflit
avec lui ; or, on attend de la science et des théories des informations
précises sur le comportement du monde.
Il évoque ensuite les critiques historiques de Popper quant à la
psychanalyse freudienne ou le matérialisme historique de Marx, qui
démontrait que ces théories étaient infalsifiables et donc peu rigoureuses
selon lui.
Ainsi, plus une théorie serait falsifiable, meilleure elle serait car
ses assertions sur le monde seraient très définies et très précises.
Il utilise
l’exemple de la théorie de Newton, qui résista bien au....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre 11. Axe 1. Comment définir et mesurer la mobilité sociale ?
- Le rouge et le noir (résumé & analyse)
- chapitre génétique
- Stratification sociale: Chapitre 4 Comment est structurée la société française actuelle ?
- Patience dans l'azur d'Hubert Reeves (résumé)