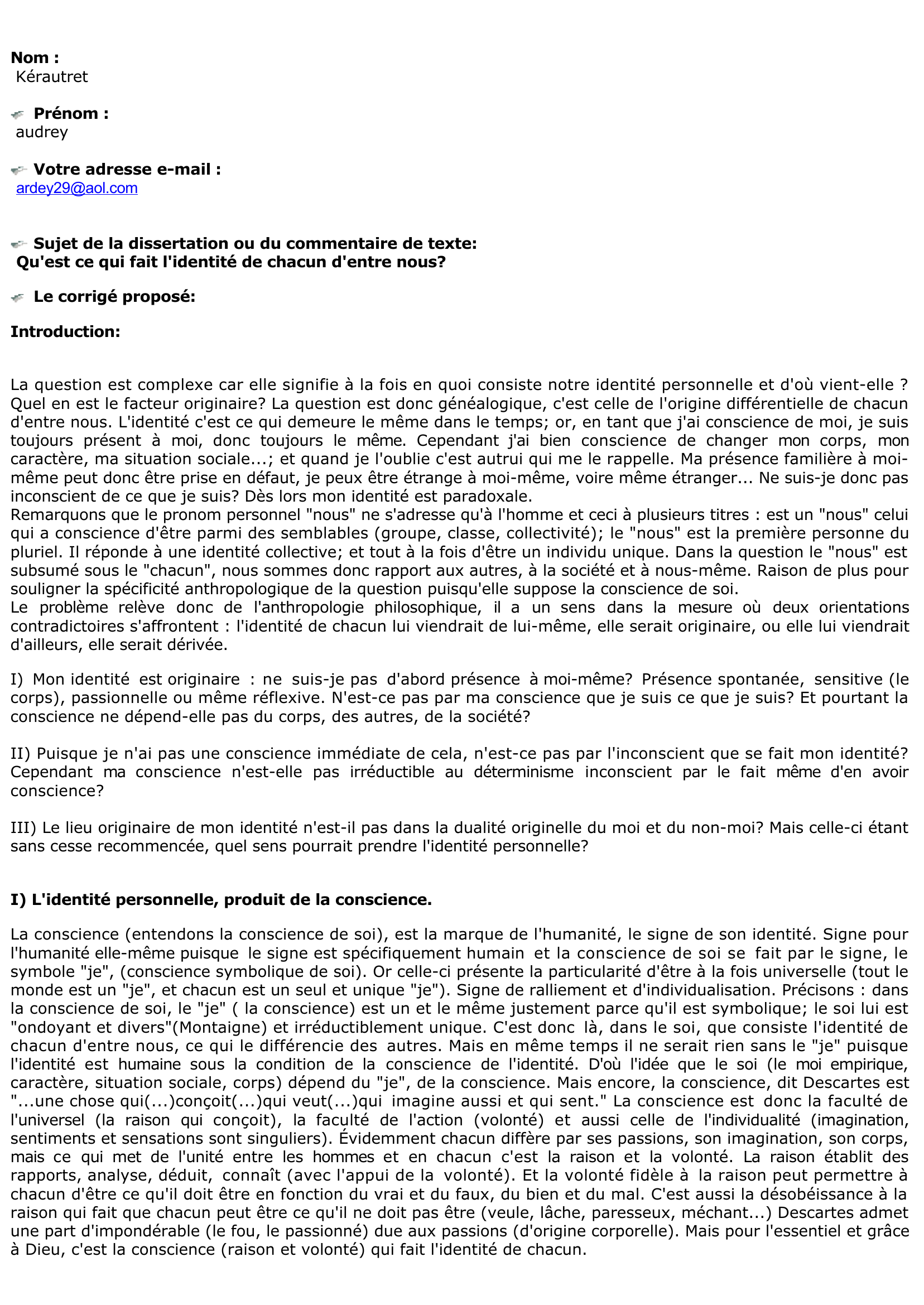Qu'est ce qui fait l'identité de chacun d'entre nous ?
Extrait du document
«
Nom :
Kérautret
Prénom :
audrey
Votre adresse e-mail :
[email protected]
Sujet de la dissertation ou du commentaire de texte:
Qu'est ce qui fait l'identité de chacun d'entre nous?
Le corrigé proposé:
Introduction:
La question est complexe car elle signifie à la fois en quoi consiste notre identité personnelle et d'où vient-elle ?
Quel en est le facteur originaire? La question est donc généalogique, c'est celle de l'origine différentielle de chacun
d'entre nous.
L'identité c'est ce qui demeure le même dans le temps; or, en tant que j'ai conscience de moi, je suis
toujours présent à moi, donc toujours le même.
Cependant j'ai bien conscience de changer mon corps, mon
caractère, ma situation sociale...; et quand je l'oublie c'est autrui qui me le rappelle.
Ma présence familière à moimême peut donc être prise en défaut, je peux être étrange à moi-même, voire même étranger...
Ne suis-je donc pas
inconscient de ce que je suis? Dès lors mon identité est paradoxale.
Remarquons que le pronom personnel "nous" ne s'adresse qu'à l'homme et ceci à plusieurs titres : est un "nous" celui
qui a conscience d'être parmi des semblables (groupe, classe, collectivité); le "nous" est la première personne du
pluriel.
Il réponde à une identité collective; et tout à la fois d'être un individu unique.
Dans la question le "nous" est
subsumé sous le "chacun", nous sommes donc rapport aux autres, à la société et à nous-même.
Raison de plus pour
souligner la spécificité anthropologique de la question puisqu'elle suppose la conscience de soi.
Le problème relève donc de l'anthropologie philosophique, il a un sens dans la mesure où deux orientations
contradictoires s'affrontent : l'identité de chacun lui viendrait de lui-même, elle serait originaire, ou elle lui viendrait
d'ailleurs, elle serait dérivée.
I) Mon identité est originaire : ne suis-je pas d'abord présence à moi-même? Présence spontanée, sensitive (le
corps), passionnelle ou même réflexive.
N'est-ce pas par ma conscience que je suis ce que je suis? Et pourtant la
conscience ne dépend-elle pas du corps, des autres, de la société?
II) Puisque je n'ai pas une conscience immédiate de cela, n'est-ce pas par l'inconscient que se fait mon identité?
Cependant ma conscience n'est-elle pas irréductible au déterminisme inconscient par le fait même d'en avoir
conscience?
III) Le lieu originaire de mon identité n'est-il pas dans la dualité originelle du moi et du non-moi? Mais celle-ci étant
sans cesse recommencée, quel sens pourrait prendre l'identité personnelle?
I) L'identité personnelle, produit de la conscience.
La conscience (entendons la conscience de soi), est la marque de l'humanité, le signe de son identité.
Signe pour
l'humanité elle-même puisque le signe est spécifiquement humain et la conscience de soi se fait par le signe, le
symbole "je", (conscience symbolique de soi).
Or celle-ci présente la particularité d'être à la fois universelle (tout le
monde est un "je", et chacun est un seul et unique "je").
Signe de ralliement et d'individualisation.
Précisons : dans
la conscience de soi, le "je" ( la conscience) est un et le même justement parce qu'il est symbolique; le soi lui est
"ondoyant et divers"(Montaigne) et irréductiblement unique.
C'est donc là, dans le soi, que consiste l'identité de
chacun d'entre nous, ce qui le différencie des autres.
Mais en même temps il ne serait rien sans le "je" puisque
l'identité est humaine sous la condition de la conscience de l'identité.
D'où l'idée que le soi (le moi empirique,
caractère, situation sociale, corps) dépend du "je", de la conscience.
Mais encore, la conscience, dit Descartes est
"...une chose qui(...)conçoit(...)qui veut(...)qui imagine aussi et qui sent." La conscience est donc la faculté de
l'universel (la raison qui conçoit), la faculté de l'action (volonté) et aussi celle de l'individualité (imagination,
sentiments et sensations sont singuliers).
Évidemment chacun diffère par ses passions, son imagination, son corps,
mais ce qui met de l'unité entre les hommes et en chacun c'est la raison et la volonté.
La raison établit des
rapports, analyse, déduit, connaît (avec l'appui de la volonté).
Et la volonté fidèle à la raison peut permettre à
chacun d'être ce qu'il doit être en fonction du vrai et du faux, du bien et du mal.
C'est aussi la désobéissance à la
raison qui fait que chacun peut être ce qu'il ne doit pas être (veule, lâche, paresseux, méchant...) Descartes admet
une part d'impondérable (le fou, le passionné) due aux passions (d'origine corporelle).
Mais pour l'essentiel et grâce
à Dieu, c'est la conscience (raison et volonté) qui fait l'identité de chacun..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Synthèse – Fiche d’identité de l’œuvre – Les Cahiers de Douai – Arthur Rimbaud
- Traité sur la nature humaine - Hume: le moi et l'identité personnelle
- L'usurpation d'identité
- Expliquer et discuter cette formule d'un philosophe : « Il n'y a que deux choses qui établissent en fait notre identité à nos propres yeux : la permanence de notre caractère et l'enchaînement de nos souvenirs »
- « Cela montre encore en quoi consiste l'identité du même homme, savoir, en cela seul qu'il jouit de la même vie, continuée par des particules de matière qui sont dans un flux perpétuel, mais qui dans cette succession sont vitalement unies au même corps o