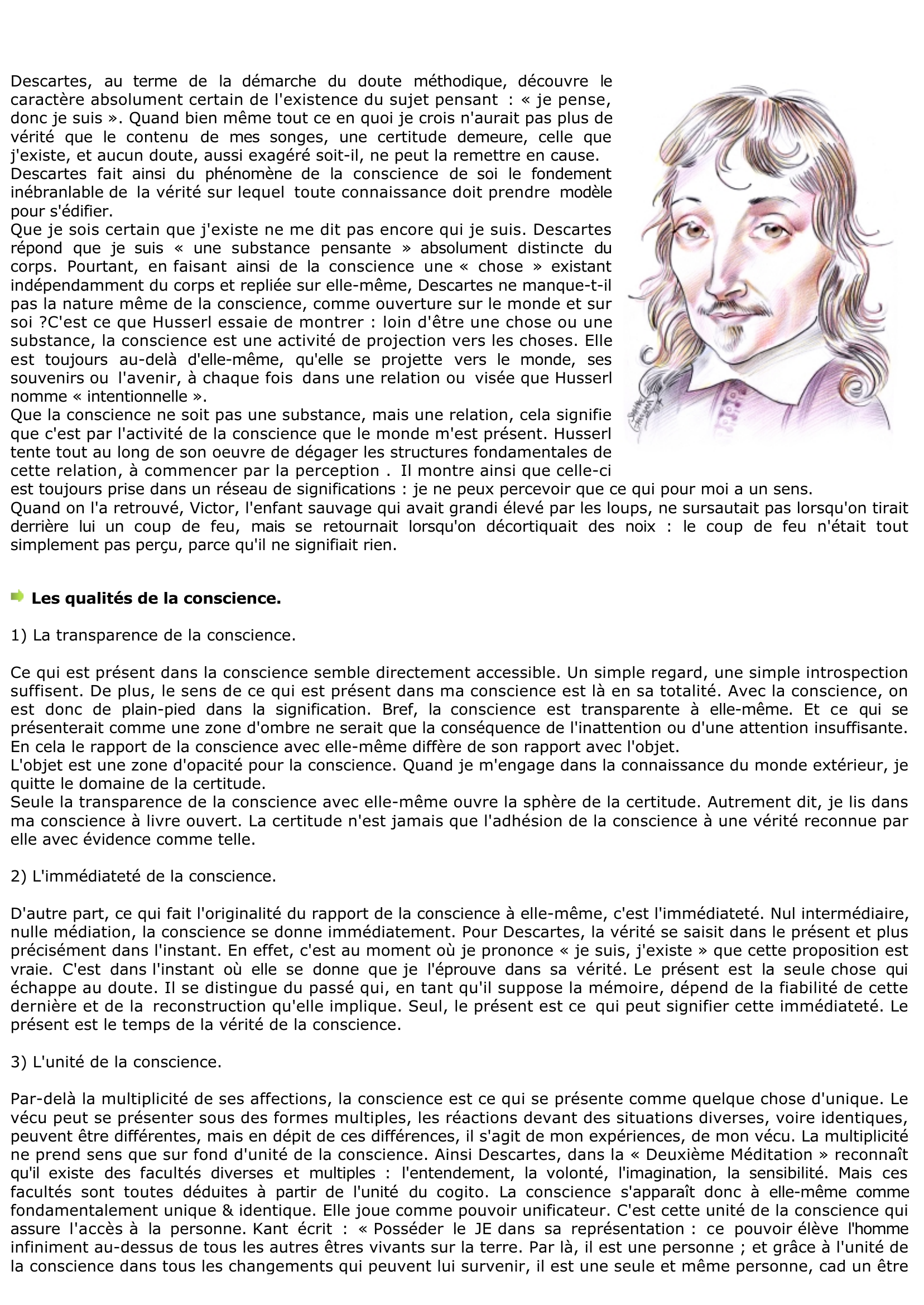Qu'est-ce que l'intentionnalité de la conscience ?
Extrait du document
«
Descartes, au terme de la démarche du doute méthodique, découvre le
caractère absolument certain de l'existence du sujet pensant : « je pense,
donc je suis ».
Quand bien même tout ce en quoi je crois n'aurait pas plus de
vérité que le contenu de mes songes, une certitude demeure, celle que
j'existe, et aucun doute, aussi exagéré soit-il, ne peut la remettre en cause.
Descartes fait ainsi du phénomène de la conscience de soi le fondement
inébranlable de la vérité sur lequel toute connaissance doit prendre modèle
pour s'édifier.
Que je sois certain que j'existe ne me dit pas encore qui je suis.
Descartes
répond que je suis « une substance pensante » absolument distincte du
corps.
Pourtant, en faisant ainsi de la conscience une « chose » existant
indépendamment du corps et repliée sur elle-même, Descartes ne manque-t-il
pas la nature même de la conscience, comme ouverture sur le monde et sur
soi ?C'est ce que Husserl essaie de montrer : loin d'être une chose ou une
substance, la conscience est une activité de projection vers les choses.
Elle
est toujours au-delà d'elle-même, qu'elle se projette vers le monde, ses
souvenirs ou l'avenir, à chaque fois dans une relation ou visée que Husserl
nomme « intentionnelle ».
Que la conscience ne soit pas une substance, mais une relation, cela signifie
que c'est par l'activité de la conscience que le monde m'est présent.
Husserl
tente tout au long de son oeuvre de dégager les structures fondamentales de
cette relation, à commencer par la perception .
Il montre ainsi que celle-ci
est toujours prise dans un réseau de significations : je ne peux percevoir que ce qui pour moi a un sens.
Quand on l'a retrouvé, Victor, l'enfant sauvage qui avait grandi élevé par les loups, ne sursautait pas lorsqu'on tirait
derrière lui un coup de feu, mais se retournait lorsqu'on décortiquait des noix : le coup de feu n'était tout
simplement pas perçu, parce qu'il ne signifiait rien.
Les qualités de la conscience.
1) La transparence de la conscience.
Ce qui est présent dans la conscience semble directement accessible.
Un simple regard, une simple introspection
suffisent.
De plus, le sens de ce qui est présent dans ma conscience est là en sa totalité.
Avec la conscience, on
est donc de plain-pied dans la signification.
Bref, la conscience est transparente à elle-même.
Et ce qui se
présenterait comme une zone d'ombre ne serait que la conséquence de l'inattention ou d'une attention insuffisante.
En cela le rapport de la conscience avec elle-même diffère de son rapport avec l'objet.
L'objet est une zone d'opacité pour la conscience.
Quand je m'engage dans la connaissance du monde extérieur, je
quitte le domaine de la certitude.
Seule la transparence de la conscience avec elle-même ouvre la sphère de la certitude.
Autrement dit, je lis dans
ma conscience à livre ouvert.
La certitude n'est jamais que l'adhésion de la conscience à une vérité reconnue par
elle avec évidence comme telle.
2) L'immédiateté de la conscience.
D'autre part, ce qui fait l'originalité du rapport de la conscience à elle-même, c'est l'immédiateté.
Nul intermédiaire,
nulle médiation, la conscience se donne immédiatement.
Pour Descartes, la vérité se saisit dans le présent et plus
précisément dans l'instant.
En effet, c'est au moment où je prononce « je suis, j'existe » que cette proposition est
vraie.
C'est dans l'instant où elle se donne que je l'éprouve dans sa vérité.
Le présent est la seule chose qui
échappe au doute.
Il se distingue du passé qui, en tant qu'il suppose la mémoire, dépend de la fiabilité de cette
dernière et de la reconstruction qu'elle implique.
Seul, le présent est ce qui peut signifier cette immédiateté.
Le
présent est le temps de la vérité de la conscience.
3) L'unité de la conscience.
Par-delà la multiplicité de ses affections, la conscience est ce qui se présente comme quelque chose d'unique.
Le
vécu peut se présenter sous des formes multiples, les réactions devant des situations diverses, voire identiques,
peuvent être différentes, mais en dépit de ces différences, il s'agit de mon expériences, de mon vécu.
La multiplicité
ne prend sens que sur fond d'unité de la conscience.
Ainsi Descartes, dans la « Deuxième Méditation » reconnaît
qu'il existe des facultés diverses et multiples : l'entendement, la volonté, l'imagination, la sensibilité.
Mais ces
facultés sont toutes déduites à partir de l'unité du cogito.
La conscience s'apparaît donc à elle-même comme
fondamentalement unique & identique.
Elle joue comme pouvoir unificateur.
C'est cette unité de la conscience qui
assure l'accès à la personne.
Kant écrit : « Posséder le JE dans sa représentation : ce pouvoir élève l'homme
infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre.
Par là, il est une personne ; et grâce à l'unité de
la conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne, cad un être.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philosophie : Conscience/ Inconscient
- la conscience nous condamne a l'inquiétude ?
- Montrez les différents éléments de l’argumentation qui permettent d’établir que Kant a une conception de la conscience qui se trouve être encore ici d’inspiration cartésienne
- la conscience peut-elle faire obstacle au bonheur ?
- Dissertation philosophie Bertrand Russell in Science et Religion: la conscience