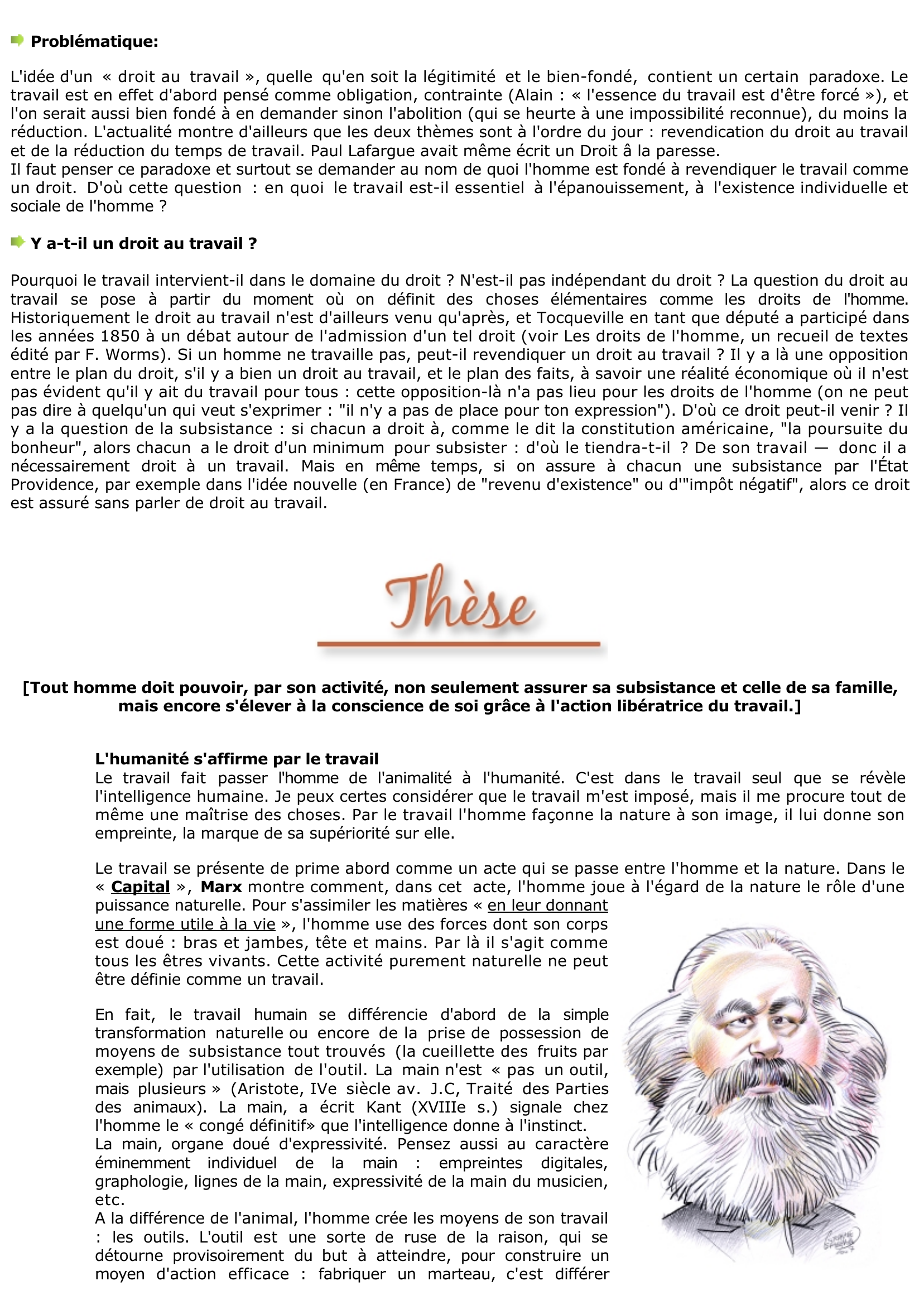Pourquoi parler du travail comme d'un droit ?
Extrait du document
«
Problématique:
L'idée d'un « droit au travail », quelle qu'en soit la légitimité et le bien-fondé, contient un certain paradoxe.
Le
travail est en effet d'abord pensé comme obligation, contrainte (Alain : « l'essence du travail est d'être forcé »), et
l'on serait aussi bien fondé à en demander sinon l'abolition (qui se heurte à une impossibilité reconnue), du moins la
réduction.
L'actualité montre d'ailleurs que les deux thèmes sont à l'ordre du jour : revendication du droit au travail
et de la réduction du temps de travail.
Paul Lafargue avait même écrit un Droit â la paresse.
Il faut penser ce paradoxe et surtout se demander au nom de quoi l'homme est fondé à revendiquer le travail comme
un droit.
D'où cette question : en quoi le travail est-il essentiel à l'épanouissement, à l'existence individuelle et
sociale de l'homme ?
Y a-t-il un droit au travail ?
Pourquoi le travail intervient-il dans le domaine du droit ? N'est-il pas indépendant du droit ? La question du droit au
travail se pose à partir du moment où on définit des choses élémentaires comme les droits de l'homme.
Historiquement le droit au travail n'est d'ailleurs venu qu'après, et Tocqueville en tant que député a participé dans
les années 1850 à un débat autour de l'admission d'un tel droit (voir Les droits de l'homme, un recueil de textes
édité par F.
Worms).
Si un homme ne travaille pas, peut-il revendiquer un droit au travail ? Il y a là une opposition
entre le plan du droit, s'il y a bien un droit au travail, et le plan des faits, à savoir une réalité économique où il n'est
pas évident qu'il y ait du travail pour tous : cette opposition-là n'a pas lieu pour les droits de l'homme (on ne peut
pas dire à quelqu'un qui veut s'exprimer : "il n'y a pas de place pour ton expression").
D'où ce droit peut-il venir ? Il
y a la question de la subsistance : si chacun a droit à, comme le dit la constitution américaine, "la poursuite du
bonheur", alors chacun a le droit d'un minimum pour subsister : d'où le tiendra-t-il ? De son travail — donc il a
nécessairement droit à un travail.
Mais en même temps, si on assure à chacun une subsistance par l'État
Providence, par exemple dans l'idée nouvelle (en France) de "revenu d'existence" ou d'"impôt négatif", alors ce droit
est assuré sans parler de droit au travail.
[Tout homme doit pouvoir, par son activité, non seulement assurer sa subsistance et celle de sa famille,
mais encore s'élever à la conscience de soi grâce à l'action libératrice du travail.]
L'humanité s'affirme par le travail
Le travail fait passer l'homme de l'animalité à l'humanité.
C'est dans le travail seul que se révèle
l'intelligence humaine.
Je peux certes considérer que le travail m'est imposé, mais il me procure tout de
même une maîtrise des choses.
Par le travail l'homme façonne la nature à son image, il lui donne son
empreinte, la marque de sa supériorité sur elle.
Le travail se présente de prime abord comme un acte qui se passe entre l'homme et la nature.
Dans le
« Capital », Marx montre comment, dans cet acte, l'homme joue à l'égard de la nature le rôle d'une
puissance naturelle.
Pour s'assimiler les matières « en leur donnant
une forme utile à la vie », l'homme use des forces dont son corps
est doué : bras et jambes, tête et mains.
Par là il s'agit comme
tous les êtres vivants.
Cette activité purement naturelle ne peut
être définie comme un travail.
En fait, le travail humain se différencie d'abord de la simple
transformation naturelle ou encore de la prise de possession de
moyens de subsistance tout trouvés (la cueillette des fruits par
exemple) par l'utilisation de l'outil.
La main n'est « pas un outil,
mais plusieurs » (Aristote, IVe siècle av.
J.C, Traité des Parties
des animaux).
La main, a écrit Kant (XVIIIe s.) signale chez
l'homme le « congé définitif» que l'intelligence donne à l'instinct.
La main, organe doué d'expressivité.
Pensez aussi au caractère
éminemment individuel de la main : empreintes digitales,
graphologie, lignes de la main, expressivité de la main du musicien,
etc.
A la différence de l'animal, l'homme crée les moyens de son travail
: les outils.
L'outil est une sorte de ruse de la raison, qui se
détourne provisoirement du but à atteindre, pour construire un
moyen d'action efficace : fabriquer un marteau, c'est différer.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Méda: Peut-on parler d'un droit au travail ?
- Le droit de propriété se fonde-t-il sur le travail ?
- Y a-t-il un droit au travail ?
- Peut-on considérer le travail comme un droit ?
- Le travail est-il une obligation, une contrainte ou un droit ?