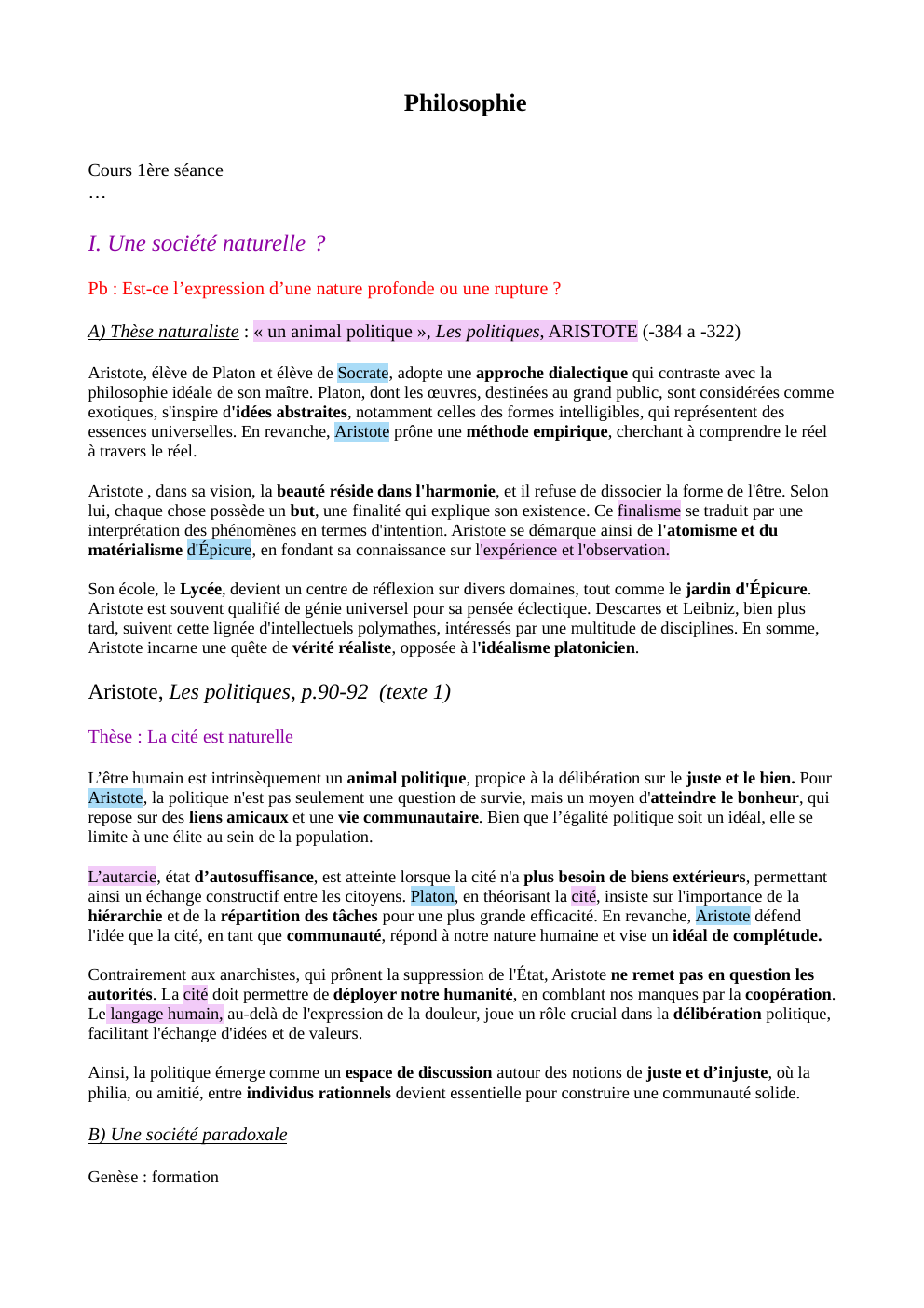Philosophie Cours 1ère séance … I. Une société naturelle ?
Publié le 16/03/2025
Extrait du document
«
Philosophie
Cours 1ère séance
…
I.
Une société naturelle ?
Pb : Est-ce l’expression d’une nature profonde ou une rupture ?
A) Thèse naturaliste : « un animal politique », Les politiques, ARISTOTE (-384 a -322)
Aristote, élève de Platon et élève de Socrate, adopte une approche dialectique qui contraste avec la
philosophie idéale de son maître.
Platon, dont les œuvres, destinées au grand public, sont considérées comme
exotiques, s'inspire d'idées abstraites, notamment celles des formes intelligibles, qui représentent des
essences universelles.
En revanche, Aristote prône une méthode empirique, cherchant à comprendre le réel
à travers le réel.
Aristote , dans sa vision, la beauté réside dans l'harmonie, et il refuse de dissocier la forme de l'être.
Selon
lui, chaque chose possède un but, une finalité qui explique son existence.
Ce finalisme se traduit par une
interprétation des phénomènes en termes d'intention.
Aristote se démarque ainsi de l'atomisme et du
matérialisme d'Épicure, en fondant sa connaissance sur l'expérience et l'observation.
Son école, le Lycée, devient un centre de réflexion sur divers domaines, tout comme le jardin d'Épicure.
Aristote est souvent qualifié de génie universel pour sa pensée éclectique.
Descartes et Leibniz, bien plus
tard, suivent cette lignée d'intellectuels polymathes, intéressés par une multitude de disciplines.
En somme,
Aristote incarne une quête de vérité réaliste, opposée à l'idéalisme platonicien.
Aristote, Les politiques, p.90-92 (texte 1)
Thèse : La cité est naturelle
L’être humain est intrinsèquement un animal politique, propice à la délibération sur le juste et le bien.
Pour
Aristote, la politique n'est pas seulement une question de survie, mais un moyen d'atteindre le bonheur, qui
repose sur des liens amicaux et une vie communautaire.
Bien que l’égalité politique soit un idéal, elle se
limite à une élite au sein de la population.
L’autarcie, état d’autosuffisance, est atteinte lorsque la cité n'a plus besoin de biens extérieurs, permettant
ainsi un échange constructif entre les citoyens.
Platon, en théorisant la cité, insiste sur l'importance de la
hiérarchie et de la répartition des tâches pour une plus grande efficacité.
En revanche, Aristote défend
l'idée que la cité, en tant que communauté, répond à notre nature humaine et vise un idéal de complétude.
Contrairement aux anarchistes, qui prônent la suppression de l'État, Aristote ne remet pas en question les
autorités.
La cité doit permettre de déployer notre humanité, en comblant nos manques par la coopération.
Le langage humain, au-delà de l'expression de la douleur, joue un rôle crucial dans la délibération politique,
facilitant l'échange d'idées et de valeurs.
Ainsi, la politique émerge comme un espace de discussion autour des notions de juste et d’injuste, où la
philia, ou amitié, entre individus rationnels devient essentielle pour construire une communauté solide.
B) Une société paradoxale
Genèse : formation
Kant, grand auteur des Lumières, explore l’idée de la nature humaine et les tendances qui nous rendent
insociables dans son concept d'« insociables insociabilité ».
Il reconnaît que notre égoïsme et notre
agressivité entravent nos relations, mais il propose un idéal d’autonomie (autos nomos) qui vise à
transcender ces défauts.
Kant, prof d'université, élabore l’impératif catégorique, une règle morale universelle, et se montre optimiste
quant à l'amélioration du sort de l’humanité.
Dans son essai ‘Idée d’une histoire universelle au point de vue
cosmopolitique’ (1784), il évoque un finalisme implicite, où l’évolution de la société se réalise à travers les
conflits.
Selon Kant, nos passions égoïstes, bien qu'elles nourrissent notre désir de domination, sont paradoxalement
des moteurs de progrès.
Ces inclinations, loin d’être uniquement négatives, poussent l’individu à
développer des qualités morales nécessaires à la vie en société.
Les actes moraux, selon Kant, reposent sur
un jugement affiné, une évaluation des conséquences et une attention portée aux autres.
Kant établit 2 paradoxes fondamentaux : d'une part, les passions égoïstes peuvent mener à l’avènement d’un
ordre légal et moral ; d’autre part, la nature, en favorisant ces passions, prépare en réalité le chemin vers la
liberté.
Pour Kant, la véritable liberté réside dans l’autonomie, c’est-à-dire l'obéissance à des lois que l'on
s'est soi-même données, en s’affranchissant des inclinations sensibles.
En somme, Kant affirme que la nature humaine, bien qu’elle contienne des tendances vers le mal, peut
paradoxalement favoriser le développement d'une moralité authentique, ouvrant la voie à un règne de la
liberté.
II.
La régulation des pulsions
1.
L’intériorisation des règles culturelles
enjeux d’un texte ou œuvre ; la finalité derrière, qu’est ce qui change pour nous si on accepte se que
a dit l’auteur.
Freud, médecin et fondateur de la psychanalyse, propose une vision pessimiste de la nature humaine,
centrée sur l'inconscient et les pulsions refoulées.
Selon lui, notre psychisme est le lieu d'un contact
permanent entre le corps (somatique) et l'esprit (psychique), où des désirs et des émotions refoulés agissent
sur notre comportement.
Freud estime que nous ne sommes pas pleinement maîtres de nous-mêmes, car nos
actions sont souvent déterminées par des causes inconscientes, un concept qu'il appelle le déterminisme
psychique.
Pour explorer l'inconscient, Freud utilise plusieurs méthodes.
La première est l'hypnose, et la seconde, la
libre association, qui consiste à laisser le patient exprimer librement ses pensées.
Il propose que les
ruptures dans le discours du patient révèlent des conflits psychiques sous-jacents.
Les rêves, les
symptômes névrotiques et les actes manqués, tels que les lapsus, sont autant de manifestations de cet
inconscient.
L'une des idées centrales de Freud est que le moi n'est pas maître, remettant en question l'idée de l'individu
autonome.
Cette vision rejoint celle de Paul Ricoeur, qui le désigne comme un "maître du soupçon", en le
plaçant aux côtés de Marx et Nietzsche dans la critique des illusions de l'homme.
Malgré sa théorie de
l'inconscient, Freud insiste sur le fait que cette réalité ne doit pas annuler la responsabilité personnelle,
soulignant l'importance de consulter un thérapeute.
Freud évoque également la culture comme instance de régulation sociale, inculquant des normes et des
obligations qui aident à éviter la désagrégation de la société.
Les pulsions humaines peuvent être canalisées
et sublimées vers d'autres objectifs, tels que le sport, permettant ainsi une forme de catharsis, un procédé de
purification psychique.
III.
La normativité du sociale
norme sociale : règles
expérience d’Asch : mesure du degres de comformise qu’un individus adopte face au groupe
1.
Étudier le fait sociale comme une chose ( Durkheim )
Émile Durkheim, « Les règles de la méthode sociologique » (1895).
Il pose 2 conditions essentielles : définir
un sujet d'étude et adopter une méthode adéquate.
Au cœur de sa réflexion se trouve le concept de "fait
social", qui se distingue des faits biologiques ou psychologiques.
Contrairement à ces derniers, les faits
sociaux émergent de représentations collectives et s'imposent aux individus de manière extérieure.
Pour Durkheim, l'explication des comportements individuels doit se faire à partir de cette dimension
collective, adoptant ainsi une approche holiste plutôt qu'individualiste.
Il définit le fait social comme des
manières d'agir, de penser et de sentir qui exercent une coercition sur l'individu, c'est-à-dire une contrainte
qui s'impose à lui.
La méthode sociologique de Durkheim repose sur le postulat que les faits sociaux doivent être traités
comme des choses, en s'appuyant sur des méthodes quantitatives et statistiques.
Par exemple, l'étude des
suicides révèle des régularités statistiques qui montrent que ce phénomène, souvent perçu comme individuel,
est en réalité influencé par des facteurs sociaux.
Durkheim introduit également le concept d'anomie, qui désigne l'absence de régulation des désirs au sein
de la société.
Selon lui, les causes des faits sociaux doivent être recherchées dans le milieu social, et non
dans des considérations individuelles.
Sa démarche se caractérise par son objectivité, écartant préjugés et notions préconçues pour expliquer les
phénomènes sociaux de manière causale.
De plus, il insiste sur le fait qu'un fait social ne peut être expliqué
que par un autre fait social, ce qui suscite des critiques pour sa tendance à généraliser et à négliger les
stratégies individuelles.
Toutefois, Durkheim affirme que la méthode sociologique est indépendante de toute
philosophie ou métaphysique et ne se prononce pas sur des questions de libre arbitre.
En somme, il cherche à
démontrer que les phénomènes sociaux sont soumis à des régularités et à des lois causales similaires à
celles observées dans les sciences naturelles.
2.
Champs et illusio
Chez Pierre Bourdieu, l'habitus désigne un ensemble de dispositions acquises, intégrées à travers des
expériences sociales variées.
Ces dispositions, souvent inconscientes, prédisposent les individus à agir,
penser et percevoir d'une manière qui reflète leur histoire sociale.
L'habitus n'est pas uniquement familial ; il
peut également être façonné par l'éducation et d'autres environnements sociaux.
En conséquence, il est
multiple et se manifeste différemment selon les contextes.
Le concept de champ fait référence à un espace structuré et hiérarchisé où les individus occupent des
positions selon leurs habitus.
Chaque champ, qu'il soit littéraire, artistique ou politique, est caractérisé par
des règles et des enjeux communs, entraînant une forme de compétition et de conflit symbolique pour la
reconnaissance.
Par exemple, le champ littéraire est un lieu de lutte pour la domination symbolique.
Le "champ des....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- LA SOCIÉTÉ (cours de philosophie) ?
- La philosophie contemporaine (cours)
- Le langage (cours de philosophie) - version finale
- Cours maths équations et inéquations du second degré 1ère
- Philosophie : une société du spectacle ? Sujet: En quoi peut-on dire que les productions culturelles sont devenues des marchandises industrielles ?