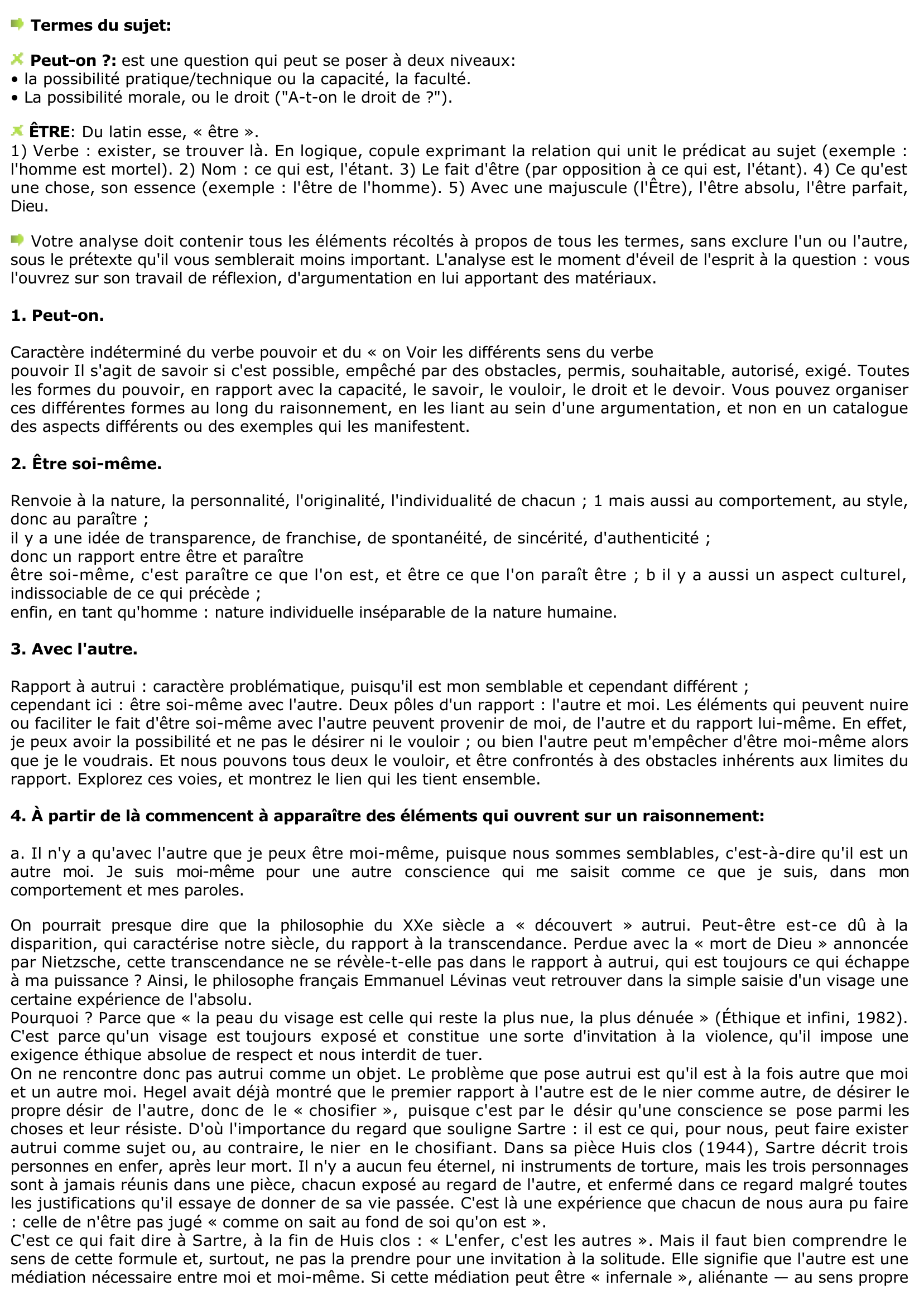Peut-on être soi-même avec l'autre ?
Extrait du document
«
Termes du sujet:
Peut-on ?: est une question qui peut se poser à deux niveaux:
• la possibilité pratique/technique ou la capacité, la faculté.
• La possibilité morale, ou le droit ("A-t-on le droit de ?").
ÊTRE: Du latin esse, « être ».
1) Verbe : exister, se trouver là.
En logique, copule exprimant la relation qui unit le prédicat au sujet (exemple :
l'homme est mortel).
2) Nom : ce qui est, l'étant.
3) Le fait d'être (par opposition à ce qui est, l'étant).
4) Ce qu'est
une chose, son essence (exemple : l'être de l'homme).
5) Avec une majuscule (l'Être), l'être absolu, l'être parfait,
Dieu.
Votre analyse doit contenir tous les éléments récoltés à propos de tous les termes, sans exclure l'un ou l'autre,
sous le prétexte qu'il vous semblerait moins important.
L'analyse est le moment d'éveil de l'esprit à la question : vous
l'ouvrez sur son travail de réflexion, d'argumentation en lui apportant des matériaux.
1.
Peut-on.
Caractère indéterminé du verbe pouvoir et du « on Voir les différents sens du verbe
pouvoir Il s'agit de savoir si c'est possible, empêché par des obstacles, permis, souhaitable, autorisé, exigé.
Toutes
les formes du pouvoir, en rapport avec la capacité, le savoir, le vouloir, le droit et le devoir.
Vous pouvez organiser
ces différentes formes au long du raisonnement, en les liant au sein d'une argumentation, et non en un catalogue
des aspects différents ou des exemples qui les manifestent.
2.
Être soi-même.
Renvoie à la nature, la personnalité, l'originalité, l'individualité de chacun ; 1 mais aussi au comportement, au style,
donc au paraître ;
il y a une idée de transparence, de franchise, de spontanéité, de sincérité, d'authenticité ;
donc un rapport entre être et paraître
être soi-même, c'est paraître ce que l'on est, et être ce que l'on paraît être ; b il y a aussi un aspect culturel,
indissociable de ce qui précède ;
enfin, en tant qu'homme : nature individuelle inséparable de la nature humaine.
3.
Avec l'autre.
Rapport à autrui : caractère problématique, puisqu'il est mon semblable et cependant différent ;
cependant ici : être soi-même avec l'autre.
Deux pôles d'un rapport : l'autre et moi.
Les éléments qui peuvent nuire
ou faciliter le fait d'être soi-même avec l'autre peuvent provenir de moi, de l'autre et du rapport lui-même.
En effet,
je peux avoir la possibilité et ne pas le désirer ni le vouloir ; ou bien l'autre peut m'empêcher d'être moi-même alors
que je le voudrais.
Et nous pouvons tous deux le vouloir, et être confrontés à des obstacles inhérents aux limites du
rapport.
Explorez ces voies, et montrez le lien qui les tient ensemble.
4.
À partir de là commencent à apparaître des éléments qui ouvrent sur un raisonnement:
a.
Il n'y a qu'avec l'autre que je peux être moi-même, puisque nous sommes semblables, c'est-à-dire qu'il est un
autre moi.
Je suis moi-même pour une autre conscience qui me saisit comme ce que je suis, dans mon
comportement et mes paroles.
On pourrait presque dire que la philosophie du XXe siècle a « découvert » autrui.
Peut-être est-ce dû à la
disparition, qui caractérise notre siècle, du rapport à la transcendance.
Perdue avec la « mort de Dieu » annoncée
par Nietzsche, cette transcendance ne se révèle-t-elle pas dans le rapport à autrui, qui est toujours ce qui échappe
à ma puissance ? Ainsi, le philosophe français Emmanuel Lévinas veut retrouver dans la simple saisie d'un visage une
certaine expérience de l'absolu.
Pourquoi ? Parce que « la peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée » (Éthique et infini, 1982).
C'est parce qu'un visage est toujours exposé et constitue une sorte d'invitation à la violence, qu'il impose une
exigence éthique absolue de respect et nous interdit de tuer.
On ne rencontre donc pas autrui comme un objet.
Le problème que pose autrui est qu'il est à la fois autre que moi
et un autre moi.
Hegel avait déjà montré que le premier rapport à l'autre est de le nier comme autre, de désirer le
propre désir de l'autre, donc de le « chosifier », puisque c'est par le désir qu'une conscience se pose parmi les
choses et leur résiste.
D'où l'importance du regard que souligne Sartre : il est ce qui, pour nous, peut faire exister
autrui comme sujet ou, au contraire, le nier en le chosifiant.
Dans sa pièce Huis clos (1944), Sartre décrit trois
personnes en enfer, après leur mort.
Il n'y a aucun feu éternel, ni instruments de torture, mais les trois personnages
sont à jamais réunis dans une pièce, chacun exposé au regard de l'autre, et enfermé dans ce regard malgré toutes
les justifications qu'il essaye de donner de sa vie passée.
C'est là une expérience que chacun de nous aura pu faire
: celle de n'être pas jugé « comme on sait au fond de soi qu'on est ».
C'est ce qui fait dire à Sartre, à la fin de Huis clos : « L'enfer, c'est les autres ».
Mais il faut bien comprendre le
sens de cette formule et, surtout, ne pas la prendre pour une invitation à la solitude.
Elle signifie que l'autre est une
médiation nécessaire entre moi et moi-même.
Si cette médiation peut être « infernale », aliénante — au sens propre.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓