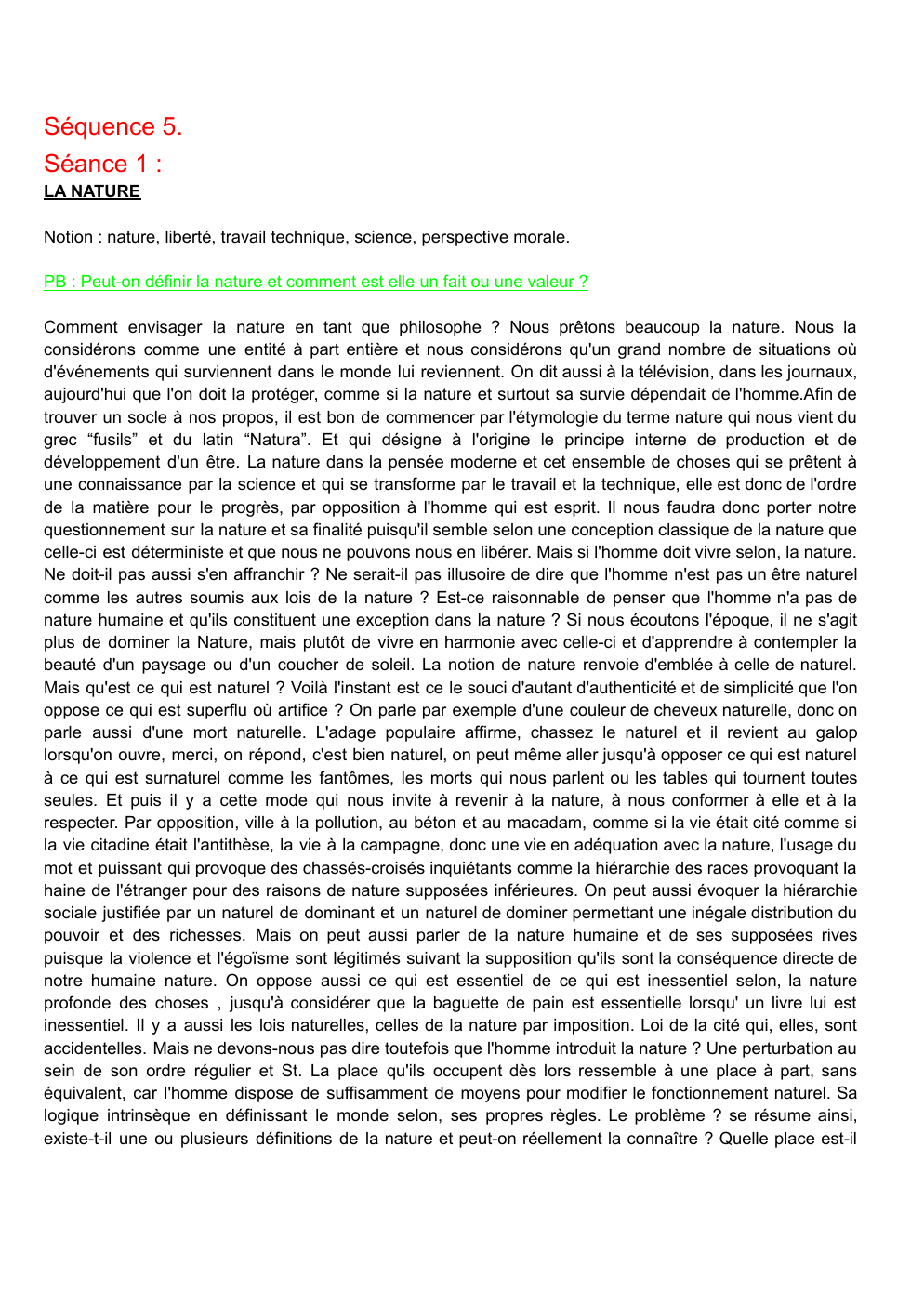Peut-on définir la nature et comment est elle un fait ou une valeur ?
Publié le 08/10/2022
Extrait du document
«
Séquence 5.
Séance 1 :
LA NATURE
Notion : nature, liberté, travail technique, science, perspective morale.
PB : Peut-on définir la nature et comment est elle un fait ou une valeur ?
Comment envisager la nature en tant que philosophe ? Nous prêtons beaucoup la nature.
Nous la
considérons comme une entité à part entière et nous considérons qu'un grand nombre de situations où
d'événements qui surviennent dans le monde lui reviennent.
On dit aussi à la télévision, dans les journaux,
aujourd'hui que l'on doit la protéger, comme si la nature et surtout sa survie dépendait de l'homme.Afin de
trouver un socle à nos propos, il est bon de commencer par l'étymologie du terme nature qui nous vient du
grec “fusils” et du latin “Natura”.
Et qui désigne à l'origine le principe interne de production et de
développement d'un être.
La nature dans la pensée moderne et cet ensemble de choses qui se prêtent à
une connaissance par la science et qui se transforme par le travail et la technique, elle est donc de l'ordre
de la matière pour le progrès, par opposition à l'homme qui est esprit.
Il nous faudra donc porter notre
questionnement sur la nature et sa finalité puisqu'il semble selon une conception classique de la nature que
celle-ci est déterministe et que nous ne pouvons nous en libérer.
Mais si l'homme doit vivre selon, la nature.
Ne doit-il pas aussi s'en affranchir ? Ne serait-il pas illusoire de dire que l'homme n'est pas un être naturel
comme les autres soumis aux lois de la nature ? Est-ce raisonnable de penser que l'homme n'a pas de
nature humaine et qu'ils constituent une exception dans la nature ? Si nous écoutons l'époque, il ne s'agit
plus de dominer la Nature, mais plutôt de vivre en harmonie avec celle-ci et d'apprendre à contempler la
beauté d'un paysage ou d'un coucher de soleil.
La notion de nature renvoie d'emblée à celle de naturel.
Mais qu'est ce qui est naturel ? Voilà l'instant est ce le souci d'autant d'authenticité et de simplicité que l'on
oppose ce qui est superflu où artifice ? On parle par exemple d'une couleur de cheveux naturelle, donc on
parle aussi d'une mort naturelle.
L'adage populaire affirme, chassez le naturel et il revient au galop
lorsqu'on ouvre, merci, on répond, c'est bien naturel, on peut même aller jusqu'à opposer ce qui est naturel
à ce qui est surnaturel comme les fantômes, les morts qui nous parlent ou les tables qui tournent toutes
seules.
Et puis il y a cette mode qui nous invite à revenir à la nature, à nous conformer à elle et à la
respecter.
Par opposition, ville à la pollution, au béton et au macadam, comme si la vie était cité comme si
la vie citadine était l'antithèse, la vie à la campagne, donc une vie en adéquation avec la nature, l'usage du
mot et puissant qui provoque des chassés-croisés inquiétants comme la hiérarchie des races provoquant la
haine de l'étranger pour des raisons de nature supposées inférieures.
On peut aussi évoquer la hiérarchie
sociale justifiée par un naturel de dominant et un naturel de dominer permettant une inégale distribution du
pouvoir et des richesses.
Mais on peut aussi parler de la nature humaine et de ses supposées rives
puisque la violence et l'égoïsme sont légitimés suivant la supposition qu'ils sont la conséquence directe de
notre humaine nature.
On oppose aussi ce qui est essentiel de ce qui est inessentiel selon, la nature
profonde des choses , jusqu'à considérer que la baguette de pain est essentielle lorsqu' un livre lui est
inessentiel.
Il y a aussi les lois naturelles, celles de la nature par imposition.
Loi de la cité qui, elles, sont
accidentelles.
Mais ne devons-nous pas dire toutefois que l'homme introduit la nature ? Une perturbation au
sein de son ordre régulier et St.
La place qu'ils occupent dès lors ressemble à une place à part, sans
équivalent, car l'homme dispose de suffisamment de moyens pour modifier le fonctionnement naturel.
Sa
logique intrinsèque en définissant le monde selon, ses propres règles.
Le problème ? se résume ainsi,
existe-t-il une ou plusieurs définitions de la nature et peut-on réellement la connaître ? Quelle place est-il
légitime d'accorder à l'homme dans la nature et est-il justifié de dire qu'il peut s'affranchir de ces lois en s'en
faisant comme maître et possesseur ?
Dans un premier temps.
Nous demanderons quelle définition nous pouvons donner à la nature et si celle-ci
est finaliste ou mécaniste.
Pour donner une réponse satisfaisante aux présupposés de l'homme comme un
être naturel disposant d'une place à part, nous mènerons une réflexion appuyée par Sartre dans son
existentialisme d'un humanisme.
Nous verrons alors comment le thème de nature humaine rejoint le sens
d'essence et de l'autre des notions qui lui sont opposés, comme celles de conditions.
La question enfin de
la valeur nous permettra à cet égard de nous questionner sur l'idée que nous nous faisons la nature et si
elle est digne d'être admirée ou respectée.
Séance 2 :
1 / peut-on définir la nature
A/ de quoi parle-t-on quand on parle de nature ?
Qu'est ce que la nature sinon prend le terme ? Il est polysémique, d'abord.
Il désigne la totalité des êtres et
des phénomènes indépendants de l'activité humaine.
Donc si l'on prend la question au premier degré, on
répondra par les propriétés de la nature.
On prend aussi la définition de la nature telle que nous la donne
Aristote dans sa métaphysique, dit, c'est avoir en soi le principe de son mouvement.
On peut donc dire,
comme le dit Aristote que je site, “la nature s'entend aussi des éléments des choses naturelles ainsi
s'exprime, et ceux qui admettent pour éléments ou le feu ou la terre ou l'air ou l'eau ou quelques principes
analogues, et ceux qui admettent plusieurs ces éléments, tous ces éléments à la fois.
Sous un autre point
de vue, enfin, la nature, c'est l'essence, les choses naturelles”.
On peut comprendre que la nature est un
mouvement qui s' auto engendre.
Et de manière plus pratique, plus prosaïque, on définit la nature en
parlant des montagnes, des océans, des fruits, des légumes mais aussi des animaux, bref, tout ce qui est
un ensemble mouvant, parfois vivant et doué de spontanéité.
Mais n'induit pas.
Alors selon, cette définition
que l'homme n'est pas un être de nature.
Ainsi, on constate que loin d'avoir répondu à la question, on l'a
plutôt creusée.
À cela s'ajoutent d'autres types de questions.
La nature est elle finie où infinie, ordonnée où
chaotique, unifiée où éclatée.
Est-t-elle toujours la même où connaît-elle des changements, et jusqu'à quel
point a-t-elle des caractéristiques qui seraient plus importantes que les autres et que l'on serait autorisé à
dire essentiel ? Si donc la définition de la nature entraîne irrémédiablement d'autres questions, notre
tentative de définition se complique dès lors que l'on considère la pluralité des approches et des objectifs de
ceux qui cherchent à identifier la nature.
Ce qui revient à penser que là simplicité d'un mot est trompeuse.
La question n'est donc pas seulement de savoir ce que c'est que la nature, mais aussi à quel discours nous
avons affaire.
Est-ce que c'est celui d'un savant ? À n'importe quelle époque
ou d'un poète ?
Ou d'un homme d'action qui nous parle ?
À qui son discours s'adresse t il que cherche t il à éclairer ?
Dès l'Antiquité la définition de la nature était vitaliste.
Notons que le vitalisme est une tradition philosophique
pour laquelle le vivant n'est pas réductible aux lois physico-chimiques.
Ce courant de pensée envisage la
vie comme de la matière, animée d'un principe où force vitale, en latin,vis vitalis.
Un qui s'ajoute pour les
êtres vivants aux lois de la matière selon cette conception, cette cette force vitale serait une cause
mystérieuse et unique sans s'y être capable d'insuffler la vie à la matière ou de former in vivo des
composés comme l'acide acétique et l'éthanol.
Dès la Renaissance le Vitalisme s'est opposé aux
mécanismes, voire au machinisme, qui réduit les êtres vivants à des composés de matières à l'instar d'une
machine ou d'un robot.
Aujourd'hui, d'ailleurs, le mécanisme et la vision dominante dans les sciences
physiques, on trouve le mécanisme dans un texte de Descartes qui s'intitule.
Traité du monde et de la
lumière (txt 2) Je continue d’expliquer donc à partir de ce texte.
Si Descartes connaît bien la tradition
néoplatonicienne, sa physique, en revanche, relève d'une toute autre démarche.
Il procède ainsi à une
matérialisation de la nature.
et celle-ci
ne recouvrant plus une figure allégorique ordonnant
téléologiquement la matière.
Elle est plutôt la matière elle-même en tant que celle-ci est profonde aux lois
que Descartes appelle loi de la nature, qui sont des lois claires pour l'esprit et qui sont imposées par Dieu à
la matière.
Et qui ne sont autres que les lois du mouvement et du choc.
Cette pensée mécaniste est une
philosophie de la nature selon laquelle l'univers est fini, et que tous phénomènes qui s'y produit peuvent et
doivent s'expliquer d'après les lois des mouvements matériels.
D'ailleurs à PLEMPIUS Descartes écrivait,
Vous savez qu'il y avait une très, très forte correspondance.
Descartes, je site ma philosophie, ne considère
que des grandeurs, des figures et des mouvements.
Comme la mécanique.
Constamment reprise dans son
siècle en tant que tout dans la nature, se fait par des figures et des mouvements.
Séance 3
B/ peut-on réellement connaître la nature ?
Toutefois, peut-on véritablement connaître la nature.
Héraclite, à ce propos, à une formule étonnante.
Je
site, “la nature aime à se dérober à nos yeux,”À sa suite Pascale dit “les secrets de la nature sont cachés
quoi qu'elles agissent toujours on ne découvre pas toujours ses effets? “ à cela il ajoute immédiatement
que”le temps les révèle d'âge en âge “, “Les hommes ensemble font dans les sens, dans les sciences, un
perpétuel progrès”.
Pourtant, Pascal ne se contredit pas, Pascal s'attache à distinguer 2 types de sciences.
Celle dont les objets sont je cite au-dessus de la nature et de la raison, La théologie, surtout celles qui, au
contraire, sont je.
Site, affaire d'expérience et de raisonnement.
Et celle que les prophètes.
Les poètes ou les philosophes nous ont.
Tous à leur manière, montrer, raconter.
Parlons de la nature en
proposant des descriptions ou des explications.
Il faut examiner leur proposition et la physique ne sera pas
autre chose que cet examen constamment réitérée donc pour comprendre cela je vous renvoie au texte 3
Cependant cette décision car il s'agit d'une décision n'est pas seulement celle de Blaise Pascal elle est
aussi l'affaire comme une de ces physiciens d'un genre nouveau comme Johannes Kepler et Galilée où
Isaac Newton elle est productive dès le 16è et 17è siècles d'enseignement scientifique.
À la partie 6 de son
discours de la méthode.
Descartes sera parmi les premiers à établir un lien entre la science et la technique
et entre la connaissance de la nature et les moyens pouvant être mis en œuvre par l'homme pour la
transformer.
Dans le texte 4 dans cet extrait en 737 que Descartes va nous exhorter de nous rendre comme
maîtres et possesseurs de la nature.
Donc phrase célèbre qui est probablement à l'origine des sciences
nouvelles, je, je vais justement.
Dans ce texte 4 Descartes proposent une sorte de remise en question de la
science, son temps et principalement de l'usage qui en était fait.
Cet ensemble de connaissances qu'il fallait
qualifier de je site philosophie spéculative, c'est à dire de savoir procédant d'idée en idée et orientée
uniquement vers la connaissance théorique et là satisfaction de la curiosité intellectuelle des savants.
Descartes veut la transformer en une philosophie beaucoup plus en phase avec l'expérience, avec les
réalités concrètes et matérielles.
Auxquelles les hommes sont confrontés dans leur vie pratique, c'est-à-dire
dans le cadre de l'action qu'ils exercent, qu'ils exercent sur le monde et sur la nature.
Il souhaite donc que
notre savoir nous conduise à une meilleure connaissance de la nature afin de nous permettre d' exercer
une action plus efficace sur celle-ci dans le but de rendre la vie des hommes meilleure, moins pénible et
donc plus propice au bonheur et à la sagesse.
Ainsi donc, la nature n'est pas seulement l'objet d'une
nouvelle physique.
Elle devient également une méthode pour penser et pour agir.
Cependant, si la thèse de
ce txt porte bien sa connaissance de la nature.
Nous pouvons être réduites désormais à une pure
spéculation intellectuelle gratuite et sans application pratique.
L'homme ayant besoin d'agir sur la nature
avec l'aide de la science afin de rendre plus aisée la vie de l'homme sur terre en se rendant comme maître
et possesseur de la nature.
Cette formule pose néanmoins un problème.
Car celle-ci ne signifie pas que
l'homme puisse disposer de la nature comme bon lui semble.
Descartes ne pense pas que l'homme puisse
agir librement et sans limite sur la nature qui est un ordre des choses au point d'en bouleverser au gré de
ses désirs, dans le simple but d'accéder au bien être ce qu'il dit précisément dans cet extrait, C'est que les
savants doivent agir en respectant ses lois immuables.
Car ces lois ont été établies par Dieu.
Qui est le seul
et véritable maître sur la nature.
Si donc.
On vient de voir que la nature est un ensemble de lois, qui sont
des relations nécessaires et constantes.
Mathématiquement exprimable entre des paramètres
fondamentaux, la vitesse et le temps.
Par exemple, il semble cependant qu'il y a un ordre de la nature qui
est partout le même, quelque soit les lieux et le temps, ce qui reviendrait à dire que le phénomène naturel
serait régis gouverner, soumis à des lois.
Comme le sont les sujets à une autorité politique ,elle s'inscrit au
cœur de la physique moderne.
Et relève d'une ambiguïté tenant au mélange ancien et complexe de la
Cosmologie et de la théologie.
C'est ainsi que Descartes rapproche les lois de la nature et les volontés de
Dieu.
Plus tard, on continuera de supposer.
Qu'il y a dans la nature des lois universelles.
Mais cela ne suffira pas à établir que tout ce qu'il s'y produit
relève de la légalité.
Est ce que cette nature que l'on suppose légale comprend les sociétés humaines
comme des réalités naturelles parmi d'autres ? Et quelle est la place de l'homme dans la nature ?
dispose-t-il d'une nature humaine ?
Séance 4 :
2 / Y a-t-il une nature humaine
A/ L'homme est-il une espèce naturelle comme les autres ?
Lorsqu'on parle de l'origine naturelle de l'homme, on évoque surtout le fruit de l'évolution naturelle des
espèces.
On ne peut nier que l'homme est un être vivant parmi les autres espèces qui, avant de connaître
la civilisation vivait dans un État de nature ou pouvait s'exprimer pleinement ses penchants naturels.
De
plus, tout au long de son existence, l'homme continue de faire l'expérience de sa corporalité demeurant
pour lui indépassable.
Enfin.
Si l'on étudie l'homme d'un point de vue strictement biologique, il est
indéniable qu'ils constituent un être vivant comme les autres, dont l'origine se situe seulement dans
l'évolution naturel des espèces dans cette perspective, il n'est pas exagéré de croire que les hommes
constituent une sorte d'animal Parmi les autres, surtout après les travaux de Darwin.
On n'osera plus dire
que l'homme occupe une place à part dans la création.
s'il est une espèce comme les autres au
fonctionnement biologique similaire à celui d'autres animaux partageant même 99% de son ADN avec les
chimpanzés ou les bonobos, ce n'est que sous l'effet de la contrainte sociale que l'homme réprime ses
instincts.
Peut-on alors parler de nature humaine ?
Pour les philosophes politiques modernes ?
Parmi les philosophes de la politique moderne, on trouve 2 philosophes opposés qui vont nous parler de la
nature humaine.
Évidemment, ces 2 philosophes, c'est Hobbes et Rousseau,
Textes 5 et 6.
D'une part.
La conception hobbesienne de l'État de nature, qui est celle d'un état de guerre de tous contre
tous, voilà le premier texte.
La compétition pour les ressources ainsi que là multitude de passions et de désirs égoïstes et conflictuels
pousse les hommes à se détruire et se subjuguer l'un l'autre ainsi.
S'ils n'ont pas un pouvoir capable de
tous les tenir en respect.
Les hommes restent dans un État de lutte permanente pour leur propre
conservation où règne la crainte et l'insécurité.
Rousseau va remettre en cause cependant cette vision
hobbesienne de la condition naturelle de l'homme.
(txt 6)
Il va d'abord pointer une faute qui est simple.
Il dit que Hobbes et d'autres ont commis la faute d'avoir
attribué à l'homme dans l'état de nature des attributs et des passions qui sont tout à fait propres à l'État
social.
Et qui ne peuvent donc naître que dans la société.
Sa conclusion est alors là suivante.
Lorsque
Hobbes ou les autres parlaient de l'homme sauvage, en réalité ils peignaient l'homme civil, la critique de
Hobbes porte sur l'état de nature qui possède chez lui, dans une certaine mesure, une réalité historique.
Selon Rousseau, cet État n'est pour lui qu'une pure fiction théorique.
Les raisonnements à propos de cet
État ne sont alors que hypothétiques et conditionnelles à tel point que Rousseau fait la remarque que les
peuples primitifs étaient déjà loin du premier État de nature ce qui montre combien il serait hâtif de conclure
que l'homme est naturellement cruel et qu'il a besoin de police pour....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on définir ce qu'est la nature ?
- Chapitre 11. Axe 1. Comment définir et mesurer la mobilité sociale ?
- « L’art imite la nature » ARISTOTE
- L'art n'est-il qu'une imitation de la nature? (corrigé)
- Richard Feynman: La Nature de la physique