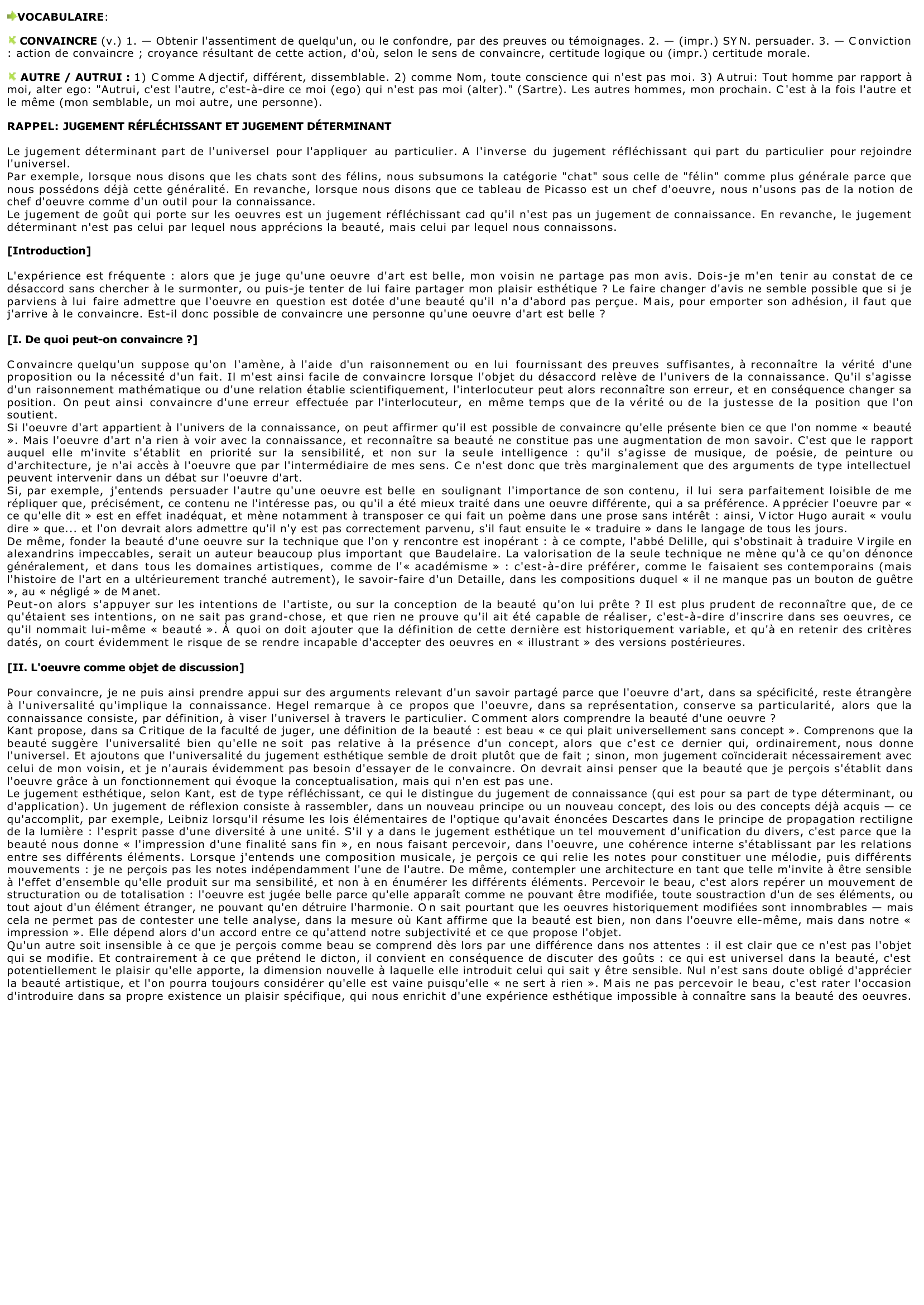Peut-on convaincre autrui qu'une oeuvre d'art est belle ?
Extrait du document
«
VOCABULAIRE:
CONVAINCRE (v.) 1.
— Obtenir l'assentiment de quelqu'un, ou le confondre, par des preuves ou témoignages.
2.
— (impr.) SY N.
persuader.
3.
— C onviction
: action de convaincre ; croyance résultant de cette action, d'où, selon le sens de convaincre, certitude logique ou (impr.) certitude morale.
AUTRE / AUTRUI : 1) C omme A djectif, différent, dissemblable.
2) comme Nom, toute conscience qui n'est pas moi.
3) A utrui: Tout homme par rapport à
moi, alter ego: "Autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire ce moi (ego) qui n'est pas moi (alter)." (Sartre).
Les autres hommes, mon prochain.
C 'est à la fois l'autre et
le même (mon semblable, un moi autre, une personne).
RAPPEL: JUGEMENT RÉFLÉCHISSANT ET JUGEMENT DÉTERMINANT
Le jugement déterminant part de l'universel pour l'appliquer au particulier.
A l'inverse du jugement réfléchissant qui part du particulier pour rejoindre
l'universel.
Par exemple, lorsque nous disons que les chats sont des félins, nous subsumons la catégorie "chat" sous celle de "félin" comme plus générale parce que
nous possédons déjà cette généralité.
En revanche, lorsque nous disons que ce tableau de Picasso est un chef d'oeuvre, nous n'usons pas de la notion de
chef d'oeuvre comme d'un outil pour la connaissance.
Le jugement de goût qui porte sur les oeuvres est un jugement réfléchissant cad qu'il n'est pas un jugement de connaissance.
En revanche, le jugement
déterminant n'est pas celui par lequel nous apprécions la beauté, mais celui par lequel nous connaissons.
[Introduction]
L'expérience est fréquente : alors que je juge qu'une oeuvre d'art est belle, mon voisin ne partage pas mon avis.
Dois-je m'en tenir au constat de ce
désaccord sans chercher à le surmonter, ou puis-je tenter de lui faire partager mon plaisir esthétique ? Le faire changer d'avis ne semble possible que si je
parviens à lui faire admettre que l'oeuvre en question est dotée d'une beauté qu'il n'a d'abord pas perçue.
M ais, pour emporter son adhésion, il faut que
j'arrive à le convaincre.
Est-il donc possible de convaincre une personne qu'une oeuvre d'art est belle ?
[I.
De quoi peut-on convaincre ?]
C onvaincre quelqu'un suppose qu'on l'amène, à l'aide d'un raisonnement ou en lui fournissant des preuves suffisantes, à reconnaître la vérité d'une
proposition ou la nécessité d'un fait.
Il m'est ainsi facile de convaincre lorsque l'objet du désaccord relève de l'univers de la connaissance.
Qu'il s'agisse
d'un raisonnement mathématique ou d'une relation établie scientifiquement, l'interlocuteur peut alors reconnaître son erreur, et en conséquence changer sa
position.
On peut ainsi convaincre d'une erreur effectuée par l'interlocuteur, en même temps que de la vérité ou de la justesse de la position que l'on
soutient.
Si l'oeuvre d'art appartient à l'univers de la connaissance, on peut affirmer qu'il est possible de convaincre qu'elle présente bien ce que l'on nomme « beauté
».
Mais l'oeuvre d'art n'a rien à voir avec la connaissance, et reconnaître sa beauté ne constitue pas une augmentation de mon savoir.
C'est que le rapport
auquel elle m'invite s'établit en priorité sur la sensibilité, et non sur la seule intelligence : qu'il s'agisse de musique, de poésie, de peinture ou
d'architecture, je n'ai accès à l'oeuvre que par l'intermédiaire de mes sens.
C e n'est donc que très marginalement que des arguments de type intellectuel
peuvent intervenir dans un débat sur l'oeuvre d'art.
Si, par exemple, j'entends persuader l'autre qu'une oeuvre est belle en soulignant l'importance de son contenu, il lui sera parfaitement loisible de me
répliquer que, précisément, ce contenu ne l'intéresse pas, ou qu'il a été mieux traité dans une oeuvre différente, qui a sa préférence.
A pprécier l'oeuvre par «
ce qu'elle dit » est en effet inadéquat, et mène notamment à transposer ce qui fait un poème dans une prose sans intérêt : ainsi, V ictor Hugo aurait « voulu
dire » que...
et l'on devrait alors admettre qu'il n'y est pas correctement parvenu, s'il faut ensuite le « traduire » dans le langage de tous les jours.
De même, fonder la beauté d'une oeuvre sur la technique que l'on y rencontre est inopérant : à ce compte, l'abbé Delille, qui s'obstinait à traduire V irgile en
alexandrins impeccables, serait un auteur beaucoup plus important que Baudelaire.
La valorisation de la seule technique ne mène qu'à ce qu'on dénonce
généralement, et dans tous les domaines artistiques, comme de l'« académisme » : c'est-à-dire préférer, comme le faisaient ses contemporains (mais
l'histoire de l'art en a ultérieurement tranché autrement), le savoir-faire d'un Detaille, dans les compositions duquel « il ne manque pas un bouton de guêtre
», au « négligé » de M anet.
Peut-on alors s'appuyer sur les intentions de l'artiste, ou sur la conception de la beauté qu'on lui prête ? Il est plus prudent de reconnaître que, de ce
qu'étaient ses intentions, on ne sait pas grand-chose, et que rien ne prouve qu'il ait été capable de réaliser, c'est-à-dire d'inscrire dans ses oeuvres, ce
qu'il nommait lui-même « beauté ».
À quoi on doit ajouter que la définition de cette dernière est historiquement variable, et qu'à en retenir des critères
datés, on court évidemment le risque de se rendre incapable d'accepter des oeuvres en « illustrant » des versions postérieures.
[II.
L'oeuvre comme objet de discussion]
Pour convaincre, je ne puis ainsi prendre appui sur des arguments relevant d'un savoir partagé parce que l'oeuvre d'art, dans sa spécificité, reste étrangère
à l'universalité qu'implique la connaissance.
Hegel remarque à ce propos que l'oeuvre, dans sa représentation, conserve sa particularité, alors que la
connaissance consiste, par définition, à viser l'universel à travers le particulier.
C omment alors comprendre la beauté d'une oeuvre ?
Kant propose, dans sa C ritique de la faculté de juger, une définition de la beauté : est beau « ce qui plait universellement sans concept ».
Comprenons que la
beauté suggère l'universalité bien qu'elle ne soit pas relative à la présence d'un concept, alors que c'est ce dernier qui, ordinairement, nous donne
l'universel.
Et ajoutons que l'universalité du jugement esthétique semble de droit plutôt que de fait ; sinon, mon jugement coïnciderait nécessairement avec
celui de mon voisin, et je n'aurais évidemment pas besoin d'essayer de le convaincre.
On devrait ainsi penser que la beauté que je perçois s'établit dans
l'oeuvre grâce à un fonctionnement qui évoque la conceptualisation, mais qui n'en est pas une.
Le jugement esthétique, selon Kant, est de type réfléchissant, ce qui le distingue du jugement de connaissance (qui est pour sa part de type déterminant, ou
d'application).
Un jugement de réflexion consiste à rassembler, dans un nouveau principe ou un nouveau concept, des lois ou des concepts déjà acquis — ce
qu'accomplit, par exemple, Leibniz lorsqu'il résume les lois élémentaires de l'optique qu'avait énoncées Descartes dans le principe de propagation rectiligne
de la lumière : l'esprit passe d'une diversité à une unité.
S'il y a dans le jugement esthétique un tel mouvement d'unification du divers, c'est parce que la
beauté nous donne « l'impression d'une finalité sans fin », en nous faisant percevoir, dans l'oeuvre, une cohérence interne s'établissant par les relations
entre ses différents éléments.
Lorsque j'entends une composition musicale, je perçois ce qui relie les notes pour constituer une mélodie, puis différents
mouvements : je ne perçois pas les notes indépendamment l'une de l'autre.
De même, contempler une architecture en tant que telle m'invite à être sensible
à l'effet d'ensemble qu'elle produit sur ma sensibilité, et non à en énumérer les différents éléments.
Percevoir le beau, c'est alors repérer un mouvement de
structuration ou de totalisation : l'oeuvre est jugée belle parce qu'elle apparaît comme ne pouvant être modifiée, toute soustraction d'un de ses éléments, ou
tout ajout d'un élément étranger, ne pouvant qu'en détruire l'harmonie.
O n sait pourtant que les oeuvres historiquement modifiées sont innombrables — mais
cela ne permet pas de contester une telle analyse, dans la mesure où Kant affirme que la beauté est bien, non dans l'oeuvre elle-même, mais dans notre «
impression ».
Elle dépend alors d'un accord entre ce qu'attend notre subjectivité et ce que propose l'objet.
Qu'un autre soit insensible à ce que je perçois comme beau se comprend dès lors par une différence dans nos attentes : il est clair que ce n'est pas l'objet
qui se modifie.
Et contrairement à ce que prétend le dicton, il convient en conséquence de discuter des goûts : ce qui est universel dans la beauté, c'est
potentiellement le plaisir qu'elle apporte, la dimension nouvelle à laquelle elle introduit celui qui sait y être sensible.
Nul n'est sans doute obligé d'apprécier
la beauté artistique, et l'on pourra toujours considérer qu'elle est vaine puisqu'elle « ne sert à rien ».
M ais ne pas percevoir le beau, c'est rater l'occasion
d'introduire dans sa propre existence un plaisir spécifique, qui nous enrichit d'une expérience esthétique impossible à connaître sans la beauté des oeuvres..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Peut-on convaincre autrui qu'une oeuvre d'art est belle?
- Peut-on convaincre autrui qu'une oeuvre d'art est belle ?
- Puis-je convaincre autrui de la beauté d'une oeuvre d'art à l'aide de concepts ?
- La copie d'une belle oeuvre d'art peut-elle être une belle oeuvre d'art ?
- Une oeuvre d'art peut-elle ne pas être belle ?