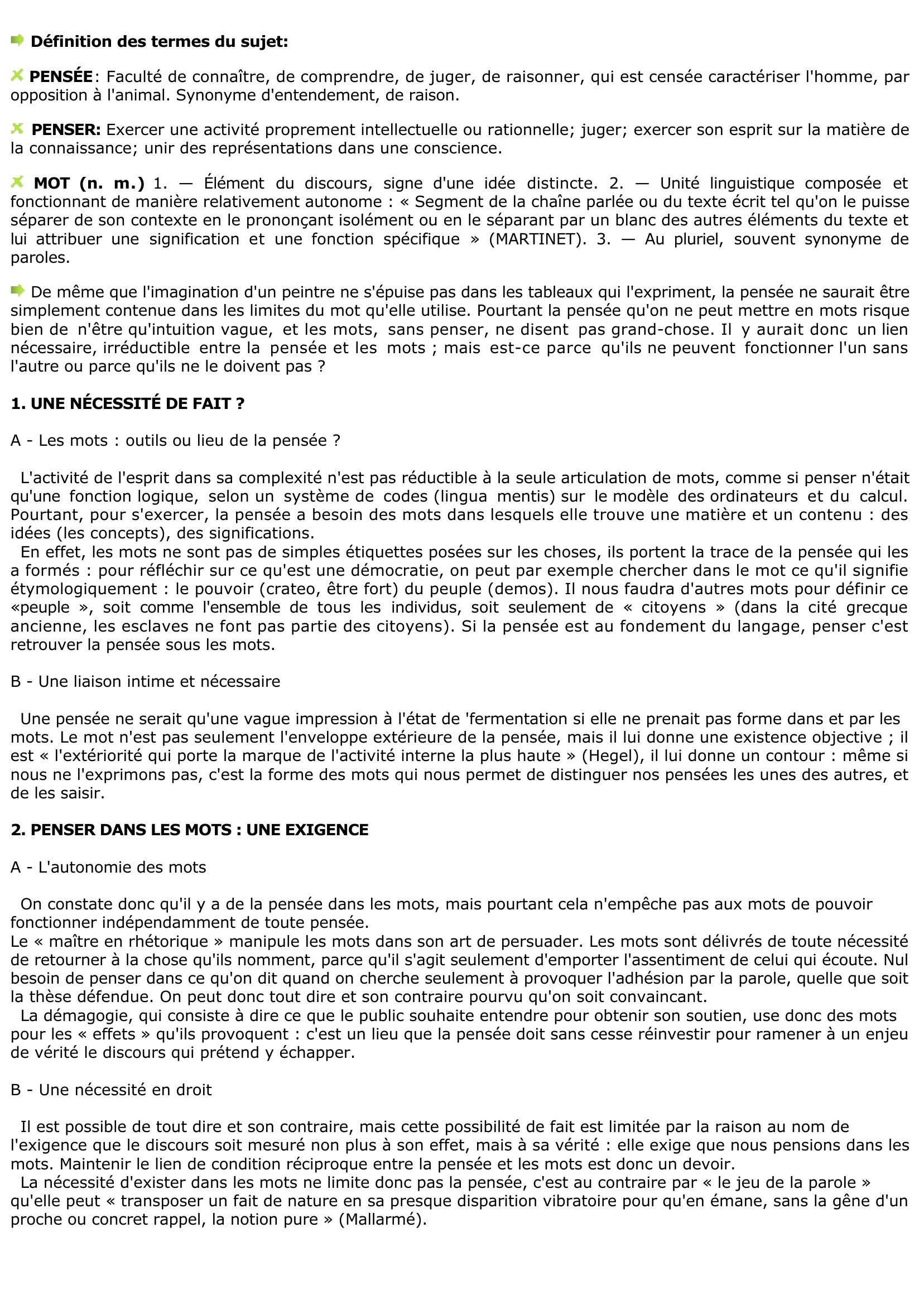Pensons-nous dans les mots ?
Extrait du document
«
Définition des termes du sujet:
PENSÉE: Faculté de connaître, de comprendre, de juger, de raisonner, qui est censée caractériser l'homme, par
opposition à l'animal.
Synonyme d'entendement, de raison.
PENSER: Exercer une activité proprement intellectuelle ou rationnelle; juger; exercer son esprit sur la matière de
la connaissance; unir des représentations dans une conscience.
MOT (n.
m.) 1.
— Élément du discours, signe d'une idée distincte.
2.
— Unité linguistique composée et
fonctionnant de manière relativement autonome : « Segment de la chaîne parlée ou du texte écrit tel qu'on le puisse
séparer de son contexte en le prononçant isolément ou en le séparant par un blanc des autres éléments du texte et
lui attribuer une signification et une fonction spécifique » (MARTINET).
3.
— Au pluriel, souvent synonyme de
paroles.
De même que l'imagination d'un peintre ne s'épuise pas dans les tableaux qui l'expriment, la pensée ne saurait être
simplement contenue dans les limites du mot qu'elle utilise.
Pourtant la pensée qu'on ne peut mettre en mots risque
bien de n'être qu'intuition vague, et les mots, sans penser, ne disent pas grand-chose.
Il y aurait donc un lien
nécessaire, irréductible entre la pensée et les mots ; mais est-ce parce qu'ils ne peuvent fonctionner l'un sans
l'autre ou parce qu'ils ne le doivent pas ?
1.
UNE NÉCESSITÉ DE FAIT ?
A - Les mots : outils ou lieu de la pensée ?
L'activité de l'esprit dans sa complexité n'est pas réductible à la seule articulation de mots, comme si penser n'était
qu'une fonction logique, selon un système de codes (lingua mentis) sur le modèle des ordinateurs et du calcul.
Pourtant, pour s'exercer, la pensée a besoin des mots dans lesquels elle trouve une matière et un contenu : des
idées (les concepts), des significations.
En effet, les mots ne sont pas de simples étiquettes posées sur les choses, ils portent la trace de la pensée qui les
a formés : pour réfléchir sur ce qu'est une démocratie, on peut par exemple chercher dans le mot ce qu'il signifie
étymologiquement : le pouvoir (crateo, être fort) du peuple (demos).
Il nous faudra d'autres mots pour définir ce
«peuple », soit comme l'ensemble de tous les individus, soit seulement de « citoyens » (dans la cité grecque
ancienne, les esclaves ne font pas partie des citoyens).
Si la pensée est au fondement du langage, penser c'est
retrouver la pensée sous les mots.
B - Une liaison intime et nécessaire
Une pensée ne serait qu'une vague impression à l'état de 'fermentation si elle ne prenait pas forme dans et par les
mots.
Le mot n'est pas seulement l'enveloppe extérieure de la pensée, mais il lui donne une existence objective ; il
est « l'extériorité qui porte la marque de l'activité interne la plus haute » (Hegel), il lui donne un contour : même si
nous ne l'exprimons pas, c'est la forme des mots qui nous permet de distinguer nos pensées les unes des autres, et
de les saisir.
2.
PENSER DANS LES MOTS : UNE EXIGENCE
A - L'autonomie des mots
On constate donc qu'il y a de la pensée dans les mots, mais pourtant cela n'empêche pas aux mots de pouvoir
fonctionner indépendamment de toute pensée.
Le « maître en rhétorique » manipule les mots dans son art de persuader.
Les mots sont délivrés de toute nécessité
de retourner à la chose qu'ils nomment, parce qu'il s'agit seulement d'emporter l'assentiment de celui qui écoute.
Nul
besoin de penser dans ce qu'on dit quand on cherche seulement à provoquer l'adhésion par la parole, quelle que soit
la thèse défendue.
On peut donc tout dire et son contraire pourvu qu'on soit convaincant.
La démagogie, qui consiste à dire ce que le public souhaite entendre pour obtenir son soutien, use donc des mots
pour les « effets » qu'ils provoquent : c'est un lieu que la pensée doit sans cesse réinvestir pour ramener à un enjeu
de vérité le discours qui prétend y échapper.
B - Une nécessité en droit
Il est possible de tout dire et son contraire, mais cette possibilité de fait est limitée par la raison au nom de
l'exigence que le discours soit mesuré non plus à son effet, mais à sa vérité : elle exige que nous pensions dans les
mots.
Maintenir le lien de condition réciproque entre la pensée et les mots est donc un devoir.
La nécessité d'exister dans les mots ne limite donc pas la pensée, c'est au contraire par « le jeu de la parole »
qu'elle peut « transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire pour qu'en émane, sans la gêne d'un
proche ou concret rappel, la notion pure » (Mallarmé)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Bergson, « Les mots sont des étiquettes »
- Platon: Les mots sont-ils institués par nature ou par convention ?
- Les mots nous séparent-ils des choses ?
- Le pouvoir des mots constitue-t-il seulement un abus de langage ?
- « Il faut considérer que nous pensons à quantités de choses à la fois, mais nous ne prenons garde qu'aux pensées qui sont les plus distinguées : et la chose ne saurait aller autrement, car, si nous prenions garde à tout, il faudrait penser avec attentio