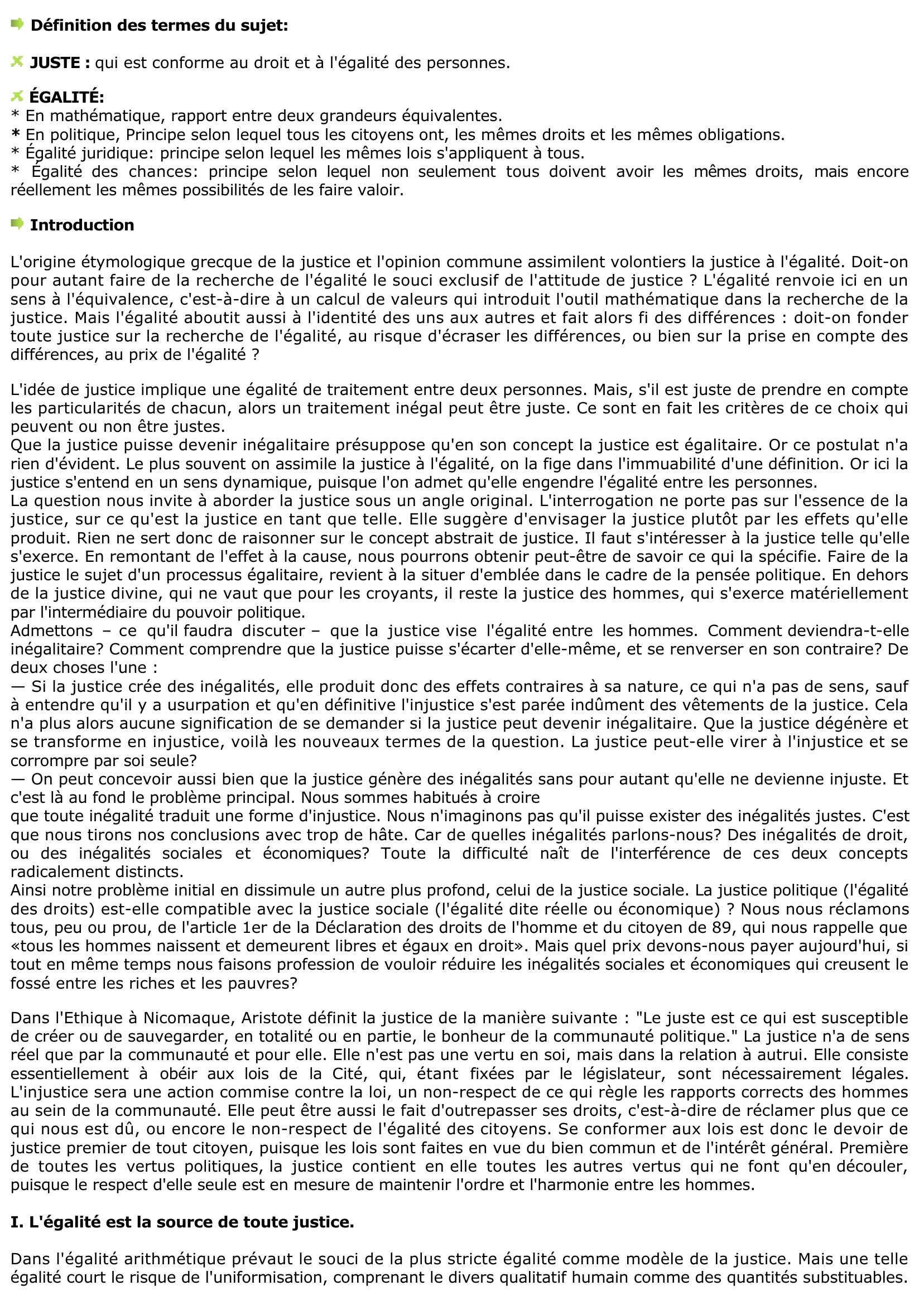N'y a-t-il que ce qui est égal qui est juste ?
Extrait du document
«
Définition des termes du sujet:
JUSTE : qui est conforme au droit et à l'égalité des personnes.
ÉGALITÉ:
* En mathématique, rapport entre deux grandeurs équivalentes.
* En politique, Principe selon lequel tous les citoyens ont, les mêmes droits et les mêmes obligations.
* Égalité juridique: principe selon lequel les mêmes lois s'appliquent à tous.
* Égalité des chances: principe selon lequel non seulement tous doivent avoir les mêmes droits, mais encore
réellement les mêmes possibilités de les faire valoir.
Introduction
L'origine étymologique grecque de la justice et l'opinion commune assimilent volontiers la justice à l'égalité.
Doit-on
pour autant faire de la recherche de l'égalité le souci exclusif de l'attitude de justice ? L'égalité renvoie ici en un
sens à l'équivalence, c'est-à-dire à un calcul de valeurs qui introduit l'outil mathématique dans la recherche de la
justice.
Mais l'égalité aboutit aussi à l'identité des uns aux autres et fait alors fi des différences : doit-on fonder
toute justice sur la recherche de l'égalité, au risque d'écraser les différences, ou bien sur la prise en compte des
différences, au prix de l'égalité ?
L'idée de justice implique une égalité de traitement entre deux personnes.
Mais, s'il est juste de prendre en compte
les particularités de chacun, alors un traitement inégal peut être juste.
Ce sont en fait les critères de ce choix qui
peuvent ou non être justes.
Que la justice puisse devenir inégalitaire présuppose qu'en son concept la justice est égalitaire.
Or ce postulat n'a
rien d'évident.
Le plus souvent on assimile la justice à l'égalité, on la fige dans l'immuabilité d'une définition.
Or ici la
justice s'entend en un sens dynamique, puisque l'on admet qu'elle engendre l'égalité entre les personnes.
La question nous invite à aborder la justice sous un angle original.
L'interrogation ne porte pas sur l'essence de la
justice, sur ce qu'est la justice en tant que telle.
Elle suggère d'envisager la justice plutôt par les effets qu'elle
produit.
Rien ne sert donc de raisonner sur le concept abstrait de justice.
Il faut s'intéresser à la justice telle qu'elle
s'exerce.
En remontant de l'effet à la cause, nous pourrons obtenir peut-être de savoir ce qui la spécifie.
Faire de la
justice le sujet d'un processus égalitaire, revient à la situer d'emblée dans le cadre de la pensée politique.
En dehors
de la justice divine, qui ne vaut que pour les croyants, il reste la justice des hommes, qui s'exerce matériellement
par l'intermédiaire du pouvoir politique.
Admettons – ce qu'il faudra discuter – que la justice vise l'égalité entre les hommes.
Comment deviendra-t-elle
inégalitaire? Comment comprendre que la justice puisse s'écarter d'elle-même, et se renverser en son contraire? De
deux choses l'une :
— Si la justice crée des inégalités, elle produit donc des effets contraires à sa nature, ce qui n'a pas de sens, sauf
à entendre qu'il y a usurpation et qu'en définitive l'injustice s'est parée indûment des vêtements de la justice.
Cela
n'a plus alors aucune signification de se demander si la justice peut devenir inégalitaire.
Que la justice dégénère et
se transforme en injustice, voilà les nouveaux termes de la question.
La justice peut-elle virer à l'injustice et se
corrompre par soi seule?
— On peut concevoir aussi bien que la justice génère des inégalités sans pour autant qu'elle ne devienne injuste.
Et
c'est là au fond le problème principal.
Nous sommes habitués à croire
que toute inégalité traduit une forme d'injustice.
Nous n'imaginons pas qu'il puisse exister des inégalités justes.
C'est
que nous tirons nos conclusions avec trop de hâte.
Car de quelles inégalités parlons-nous? Des inégalités de droit,
ou des inégalités sociales et économiques? Toute la difficulté naît de l'interférence de ces deux concepts
radicalement distincts.
Ainsi notre problème initial en dissimule un autre plus profond, celui de la justice sociale.
La justice politique (l'égalité
des droits) est-elle compatible avec la justice sociale (l'égalité dite réelle ou économique) ? Nous nous réclamons
tous, peu ou prou, de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, qui nous rappelle que
«tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit».
Mais quel prix devons-nous payer aujourd'hui, si
tout en même temps nous faisons profession de vouloir réduire les inégalités sociales et économiques qui creusent le
fossé entre les riches et les pauvres?
Dans l'Ethique à Nicomaque, Aristote définit la justice de la manière suivante : "Le juste est ce qui est susceptible
de créer ou de sauvegarder, en totalité ou en partie, le bonheur de la communauté politique." La justice n'a de sens
réel que par la communauté et pour elle.
Elle n'est pas une vertu en soi, mais dans la relation à autrui.
Elle consiste
essentiellement à obéir aux lois de la Cité, qui, étant fixées par le législateur, sont nécessairement légales.
L'injustice sera une action commise contre la loi, un non-respect de ce qui règle les rapports corrects des hommes
au sein de la communauté.
Elle peut être aussi le fait d'outrepasser ses droits, c'est-à-dire de réclamer plus que ce
qui nous est dû, ou encore le non-respect de l'égalité des citoyens.
Se conformer aux lois est donc le devoir de
justice premier de tout citoyen, puisque les lois sont faites en vue du bien commun et de l'intérêt général.
Première
de toutes les vertus politiques, la justice contient en elle toutes les autres vertus qui ne font qu'en découler,
puisque le respect d'elle seule est en mesure de maintenir l'ordre et l'harmonie entre les hommes.
I.
L'égalité est la source de toute justice.
Dans l'égalité arithmétique prévaut le souci de la plus stricte égalité comme modèle de la justice.
Mais une telle
égalité court le risque de l'uniformisation, comprenant le divers qualitatif humain comme des quantités substituables..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Toutes les personnes méritent-elles un égal respect ?
- Le commerce des choses est-il égal au commerce des idées ?
- Toutes les personnes ont-elles droit à un égal et même respect
- Toutes les personnes méritent-elle un égal respect ?