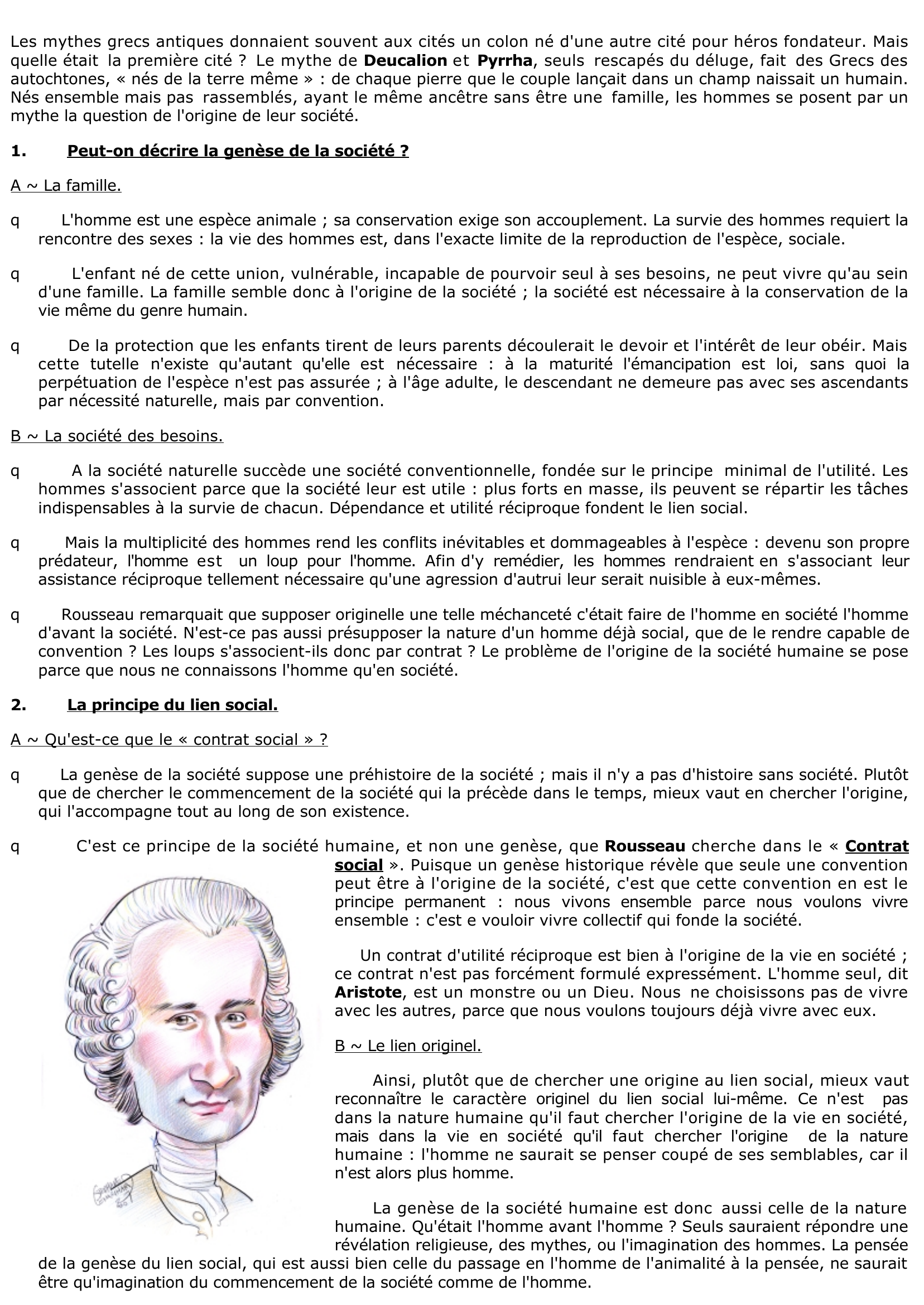N'aime-t-on jamais que soi-même ?
Extrait du document
«
Les mythes grecs antiques donnaient souvent aux cités un colon né d'une autre cité pour héros fondateur.
Mais
quelle était la première cité ? Le mythe de Deucalion et Pyrrha, seuls rescapés du déluge, fait des Grecs des
autochtones, « nés de la terre même » : de chaque pierre que le couple lançait dans un champ naissait un humain.
Nés ensemble mais pas rassemblés, ayant le même ancêtre sans être une famille, les hommes se posent par un
mythe la question de l'origine de leur société.
1.
Peut-on décrire la genèse de la société ?
A ~ La famille.
q
L'homme est une espèce animale ; sa conservation exige son accouplement.
La survie des hommes requiert la
rencontre des sexes : la vie des hommes est, dans l'exacte limite de la reproduction de l'espèce, sociale.
q
L'enfant né de cette union, vulnérable, incapable de pourvoir seul à ses besoins, ne peut vivre qu'au sein
d'une famille.
La famille semble donc à l'origine de la société ; la société est nécessaire à la conservation de la
vie même du genre humain.
q
De la protection que les enfants tirent de leurs parents découlerait le devoir et l'intérêt de leur obéir.
Mais
cette tutelle n'existe qu'autant qu'elle est nécessaire : à la maturité l'émancipation est loi, sans quoi la
perpétuation de l'espèce n'est pas assurée ; à l'âge adulte, le descendant ne demeure pas avec ses ascendants
par nécessité naturelle, mais par convention.
B ~ La société des besoins.
q
A la société naturelle succède une société conventionnelle, fondée sur le principe minimal de l'utilité.
Les
hommes s'associent parce que la société leur est utile : plus forts en masse, ils peuvent se répartir les tâches
indispensables à la survie de chacun.
Dépendance et utilité réciproque fondent le lien social.
q
Mais la multiplicité des hommes rend les conflits inévitables et dommageables à l'espèce : devenu son propre
prédateur, l'homme est un loup pour l'homme.
Afin d'y remédier, les hommes rendraient en s'associant leur
assistance réciproque tellement nécessaire qu'une agression d'autrui leur serait nuisible à eux-mêmes.
q
Rousseau remarquait que supposer originelle une telle méchanceté c'était faire de l'homme en société l'homme
d'avant la société.
N'est-ce pas aussi présupposer la nature d'un homme déjà social, que de le rendre capable de
convention ? Les loups s'associent-ils donc par contrat ? Le problème de l'origine de la société humaine se pose
parce que nous ne connaissons l'homme qu'en société.
2.
La principe du lien social.
A ~ Qu'est-ce que le « contrat social » ?
q
La genèse de la société suppose une préhistoire de la société ; mais il n'y a pas d'histoire sans société.
Plutôt
que de chercher le commencement de la société qui la précède dans le temps, mieux vaut en chercher l'origine,
qui l'accompagne tout au long de son existence.
q
C'est ce principe de la société humaine, et non une genèse, que Rousseau cherche dans le « Contrat
social ».
Puisque un genèse historique révèle que seule une convention
peut être à l'origine de la société, c'est que cette convention en est le
principe permanent : nous vivons ensemble parce nous voulons vivre
ensemble : c'est e vouloir vivre collectif qui fonde la société.
q
Un contrat d'utilité réciproque est bien à l'origine de la vie en société ;
ce contrat n'est pas forcément formulé expressément.
L'homme seul, dit
Aristote, est un monstre ou un Dieu.
Nous ne choisissons pas de vivre
avec les autres, parce que nous voulons toujours déjà vivre avec eux.
B ~ Le lien originel.
q
q
Ainsi, plutôt que de chercher une origine au lien social, mieux vaut
reconnaître le caractère originel du lien social lui-même.
Ce n'est pas
dans la nature humaine qu'il faut chercher l'origine de la vie en société,
mais dans la vie en société qu'il faut chercher l'origine de la nature
humaine : l'homme ne saurait se penser coupé de ses semblables, car il
n'est alors plus homme.
La genèse de la société humaine est donc aussi celle de la nature
humaine.
Qu'était l'homme avant l'homme ? Seuls sauraient répondre une
révélation religieuse, des mythes, ou l'imagination des hommes.
La pensée
de la genèse du lien social, qui est aussi bien celle du passage en l'homme de l'animalité à la pensée, ne saurait
être qu'imagination du commencement de la société comme de l'homme..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Expliquez, et s'il y a lieu discutez, cette pensée de Jean Guéhenno : «On ne juge jamais mieux qu'à vingt ans l'univers : on l'aime tel qu'il devrait être. Toute la sagesse, après, est à maintenir vivant en soi un tel amour. » (Journal d'un homme de quar
- Dans tout amour, n'aime-t-on jamais que soi-même ?
- Dans tout amour, n'aime-t-on jamais que soi?
- Que pensez-vous de cette affirmation de Nietzsche : « On n'aime jamais en définitive que ses penchants, et non ce vers quoi l'on penche. » ?
- « L’homme n’est jamais moins seul que lorsqu’il est seul » CICÉRON