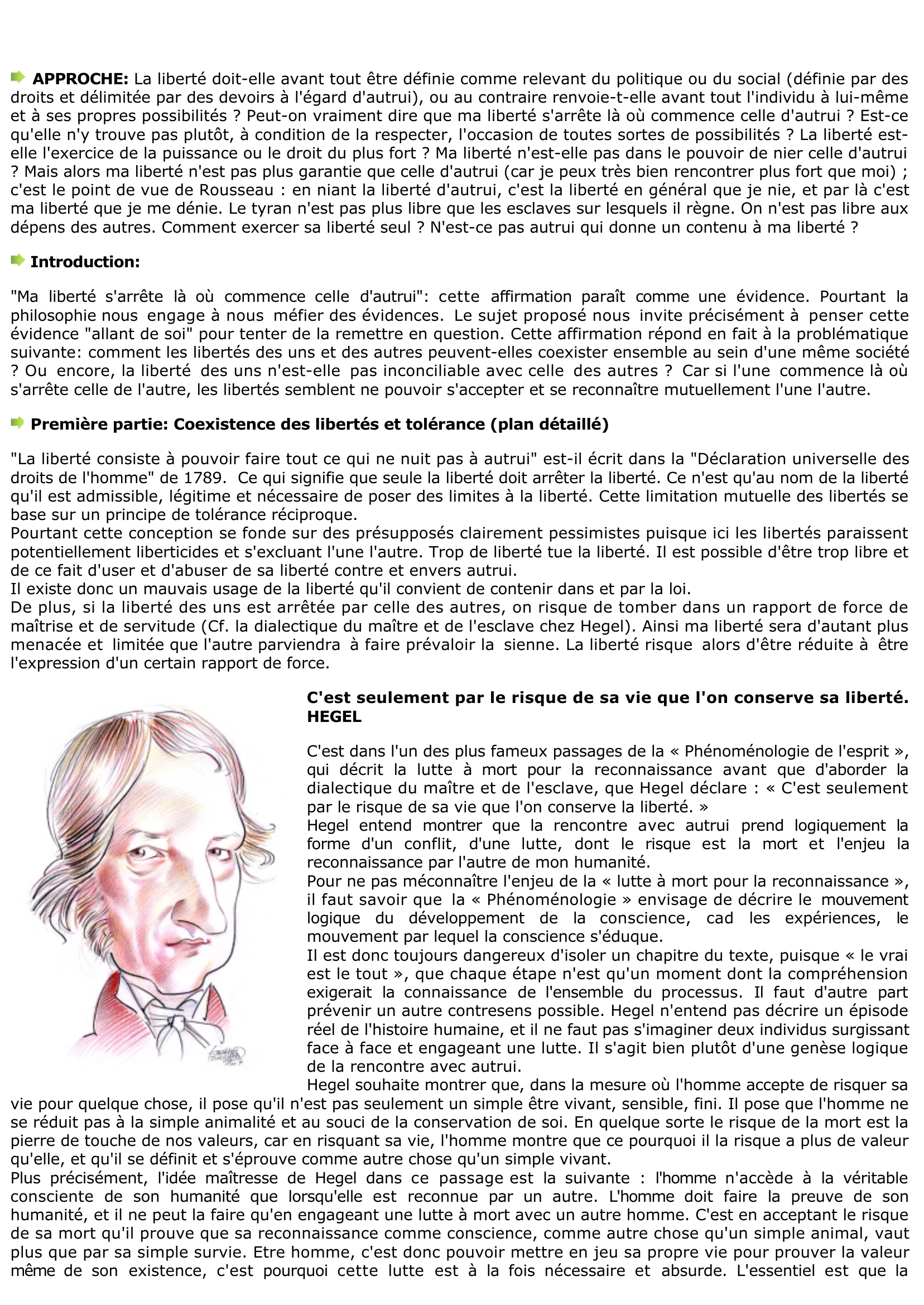Ma liberté s'arrête-t-elle où commence celle d'autrui ?
Extrait du document
«
APPROCHE: La liberté doit-elle avant tout être définie comme relevant du politique ou du social (définie par des
droits et délimitée par des devoirs à l'égard d'autrui), ou au contraire renvoie-t-elle avant tout l'individu à lui-même
et à ses propres possibilités ? Peut-on vraiment dire que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui ? Est-ce
qu'elle n'y trouve pas plutôt, à condition de la respecter, l'occasion de toutes sortes de possibilités ? La liberté estelle l'exercice de la puissance ou le droit du plus fort ? Ma liberté n'est-elle pas dans le pouvoir de nier celle d'autrui
? Mais alors ma liberté n'est pas plus garantie que celle d'autrui (car je peux très bien rencontrer plus fort que moi) ;
c'est le point de vue de Rousseau : en niant la liberté d'autrui, c'est la liberté en général que je nie, et par là c'est
ma liberté que je me dénie.
Le tyran n'est pas plus libre que les esclaves sur lesquels il règne.
On n'est pas libre aux
dépens des autres.
Comment exercer sa liberté seul ? N'est-ce pas autrui qui donne un contenu à ma liberté ?
Introduction:
"Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui": cette affirmation paraît comme une évidence.
Pourtant la
philosophie nous engage à nous méfier des évidences.
Le sujet proposé nous invite précisément à penser cette
évidence "allant de soi" pour tenter de la remettre en question.
Cette affirmation répond en fait à la problématique
suivante: comment les libertés des uns et des autres peuvent-elles coexister ensemble au sein d'une même société
? Ou encore, la liberté des uns n'est-elle pas inconciliable avec celle des autres ? Car si l'une commence là où
s'arrête celle de l'autre, les libertés semblent ne pouvoir s'accepter et se reconnaître mutuellement l'une l'autre.
Première partie: Coexistence des libertés et tolérance (plan détaillé)
"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" est-il écrit dans la "Déclaration universelle des
droits de l'homme" de 1789.
Ce qui signifie que seule la liberté doit arrêter la liberté.
Ce n'est qu'au nom de la liberté
qu'il est admissible, légitime et nécessaire de poser des limites à la liberté.
Cette limitation mutuelle des libertés se
base sur un principe de tolérance réciproque.
Pourtant cette conception se fonde sur des présupposés clairement pessimistes puisque ici les libertés paraissent
potentiellement liberticides et s'excluant l'une l'autre.
Trop de liberté tue la liberté.
Il est possible d'être trop libre et
de ce fait d'user et d'abuser de sa liberté contre et envers autrui.
Il existe donc un mauvais usage de la liberté qu'il convient de contenir dans et par la loi.
De plus, si la liberté des uns est arrêtée par celle des autres, on risque de tomber dans un rapport de force de
maîtrise et de servitude (Cf.
la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel).
Ainsi ma liberté sera d'autant plus
menacée et limitée que l'autre parviendra à faire prévaloir la sienne.
La liberté risque alors d'être réduite à être
l'expression d'un certain rapport de force.
C'est seulement par le risque de sa vie que l'on conserve sa liberté.
HEGEL
C'est dans l'un des plus fameux passages de la « Phénoménologie de l'esprit »,
qui décrit la lutte à mort pour la reconnaissance avant que d'aborder la
dialectique du maître et de l'esclave, que Hegel déclare : « C'est seulement
par le risque de sa vie que l'on conserve la liberté.
»
Hegel entend montrer que la rencontre avec autrui prend logiquement la
forme d'un conflit, d'une lutte, dont le risque est la mort et l'enjeu la
reconnaissance par l'autre de mon humanité.
Pour ne pas méconnaître l'enjeu de la « lutte à mort pour la reconnaissance »,
il faut savoir que la « Phénoménologie » envisage de décrire le mouvement
logique du développement de la conscience, cad les expériences, le
mouvement par lequel la conscience s'éduque.
Il est donc toujours dangereux d'isoler un chapitre du texte, puisque « le vrai
est le tout », que chaque étape n'est qu'un moment dont la compréhension
exigerait la connaissance de l'ensemble du processus.
Il faut d'autre part
prévenir un autre contresens possible.
Hegel n'entend pas décrire un épisode
réel de l'histoire humaine, et il ne faut pas s'imaginer deux individus surgissant
face à face et engageant une lutte.
Il s'agit bien plutôt d'une genèse logique
de la rencontre avec autrui.
Hegel souhaite montrer que, dans la mesure où l'homme accepte de risquer sa
vie pour quelque chose, il pose qu'il n'est pas seulement un simple être vivant, sensible, fini.
Il pose que l'homme ne
se réduit pas à la simple animalité et au souci de la conservation de soi.
En quelque sorte le risque de la mort est la
pierre de touche de nos valeurs, car en risquant sa vie, l'homme montre que ce pourquoi il la risque a plus de valeur
qu'elle, et qu'il se définit et s'éprouve comme autre chose qu'un simple vivant.
Plus précisément, l'idée maîtresse de Hegel dans ce passage est la suivante : l'homme n'accède à la véritable
consciente de son humanité que lorsqu'elle est reconnue par un autre.
L'homme doit faire la preuve de son
humanité, et il ne peut la faire qu'en engageant une lutte à mort avec un autre homme.
C'est en acceptant le risque
de sa mort qu'il prouve que sa reconnaissance comme conscience, comme autre chose qu'un simple animal, vaut
plus que par sa simple survie.
Etre homme, c'est donc pouvoir mettre en jeu sa propre vie pour prouver la valeur
même de son existence, c'est pourquoi cette lutte est à la fois nécessaire et absurde.
L'essentiel est que la.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La liberté de chacun s'arrête t elle où commence celle d'autrui?
- La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ?
- La liberté de chacun s'arrête-t-elle seulement là où commence celle d'autrui ?
- Ma liberté s'arrête-t-elle où commence celle d'autrui ?
- La liberté commence-t-elle en dehors du travail ?