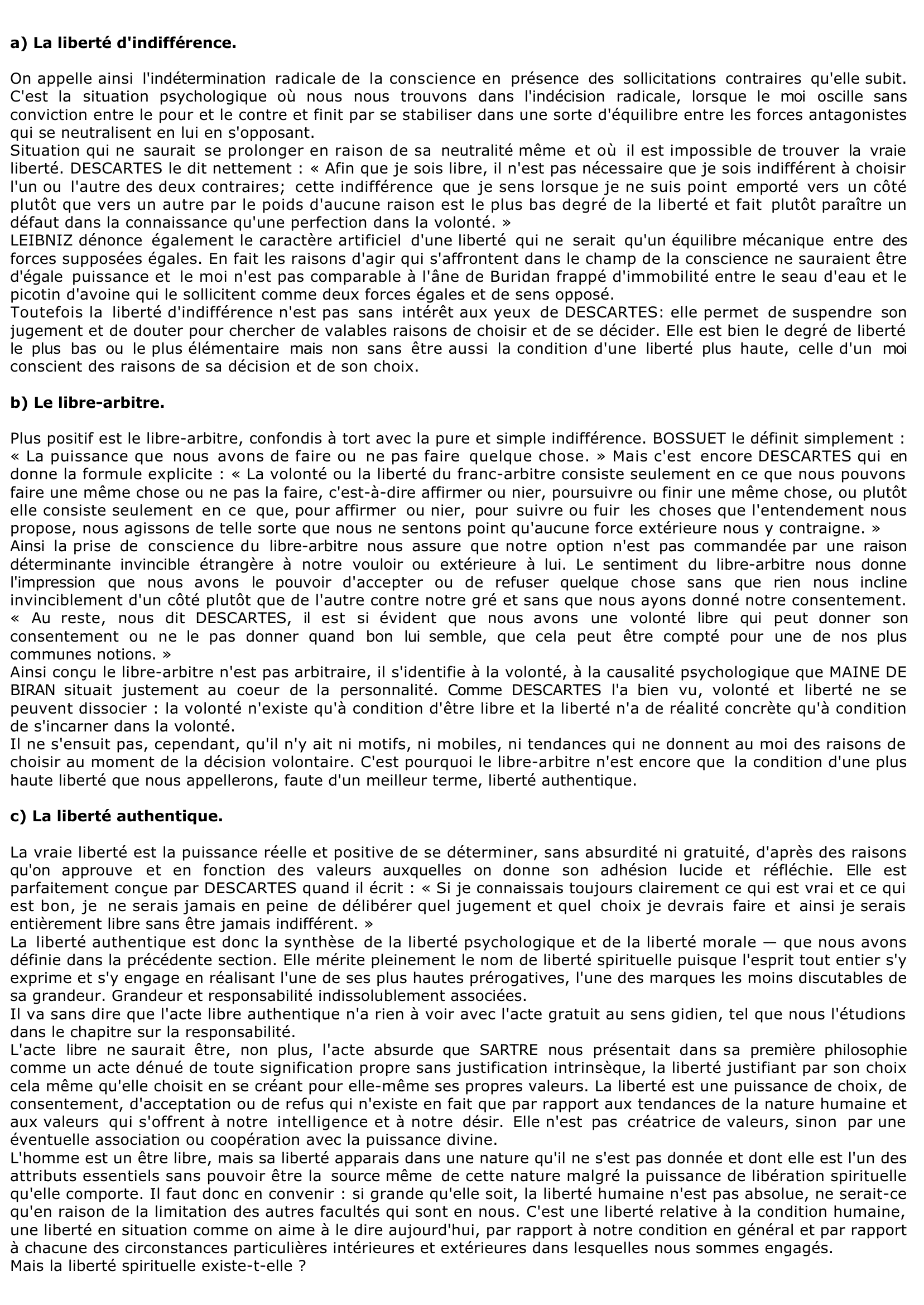Liberté d'indifférence, libre-arbitre et liberté rationnelle ?
Extrait du document
«
a) La liberté d'indifférence.
On appelle ainsi l'indétermination radicale de la conscience en présence des sollicitations contraires qu'elle subit.
C'est la situation psychologique où nous nous trouvons dans l'indécision radicale, lorsque le moi oscille sans
conviction entre le pour et le contre et finit par se stabiliser dans une sorte d'équilibre entre les forces antagonistes
qui se neutralisent en lui en s'opposant.
Situation qui ne saurait se prolonger en raison de sa neutralité même et où il est impossible de trouver la vraie
liberté.
DESCARTES le dit nettement : « Afin que je sois libre, il n'est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir
l'un ou l'autre des deux contraires; cette indifférence que je sens lorsque je ne suis point emporté vers un côté
plutôt que vers un autre par le poids d'aucune raison est le plus bas degré de la liberté et fait plutôt paraître un
défaut dans la connaissance qu'une perfection dans la volonté.
»
LEIBNIZ dénonce également le caractère artificiel d'une liberté qui ne serait qu'un équilibre mécanique entre des
forces supposées égales.
En fait les raisons d'agir qui s'affrontent dans le champ de la conscience ne sauraient être
d'égale puissance et le moi n'est pas comparable à l'âne de Buridan frappé d'immobilité entre le seau d'eau et le
picotin d'avoine qui le sollicitent comme deux forces égales et de sens opposé.
Toutefois la liberté d'indifférence n'est pas sans intérêt aux yeux de DESCARTES: elle permet de suspendre son
jugement et de douter pour chercher de valables raisons de choisir et de se décider.
Elle est bien le degré de liberté
le plus bas ou le plus élémentaire mais non sans être aussi la condition d'une liberté plus haute, celle d'un moi
conscient des raisons de sa décision et de son choix.
b) Le libre-arbitre.
Plus positif est le libre-arbitre, confondis à tort avec la pure et simple indifférence.
BOSSUET le définit simplement :
« La puissance que nous avons de faire ou ne pas faire quelque chose.
» Mais c'est encore DESCARTES qui en
donne la formule explicite : « La volonté ou la liberté du franc-arbitre consiste seulement en ce que nous pouvons
faire une même chose ou ne pas la faire, c'est-à-dire affirmer ou nier, poursuivre ou finir une même chose, ou plutôt
elle consiste seulement en ce que, pour affirmer ou nier, pour suivre ou fuir les choses que l'entendement nous
propose, nous agissons de telle sorte que nous ne sentons point qu'aucune force extérieure nous y contraigne.
»
Ainsi la prise de conscience du libre-arbitre nous assure que notre option n'est pas commandée par une raison
déterminante invincible étrangère à notre vouloir ou extérieure à lui.
Le sentiment du libre-arbitre nous donne
l'impression que nous avons le pouvoir d'accepter ou de refuser quelque chose sans que rien nous incline
invinciblement d'un côté plutôt que de l'autre contre notre gré et sans que nous ayons donné notre consentement.
« Au reste, nous dit DESCARTES, il est si évident que nous avons une volonté libre qui peut donner son
consentement ou ne le pas donner quand bon lui semble, que cela peut être compté pour une de nos plus
communes notions.
»
Ainsi conçu le libre-arbitre n'est pas arbitraire, il s'identifie à la volonté, à la causalité psychologique que MAINE DE
BIRAN situait justement au coeur de la personnalité.
Comme DESCARTES l'a bien vu, volonté et liberté ne se
peuvent dissocier : la volonté n'existe qu'à condition d'être libre et la liberté n'a de réalité concrète qu'à condition
de s'incarner dans la volonté.
Il ne s'ensuit pas, cependant, qu'il n'y ait ni motifs, ni mobiles, ni tendances qui ne donnent au moi des raisons de
choisir au moment de la décision volontaire.
C'est pourquoi le libre-arbitre n'est encore que la condition d'une plus
haute liberté que nous appellerons, faute d'un meilleur terme, liberté authentique.
c) La liberté authentique.
La vraie liberté est la puissance réelle et positive de se déterminer, sans absurdité ni gratuité, d'après des raisons
qu'on approuve et en fonction des valeurs auxquelles on donne son adhésion lucide et réfléchie.
Elle est
parfaitement conçue par DESCARTES quand il écrit : « Si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai et ce qui
est bon, je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement et quel choix je devrais faire et ainsi je serais
entièrement libre sans être jamais indifférent.
»
La liberté authentique est donc la synthèse de la liberté psychologique et de la liberté morale — que nous avons
définie dans la précédente section.
Elle mérite pleinement le nom de liberté spirituelle puisque l'esprit tout entier s'y
exprime et s'y engage en réalisant l'une de ses plus hautes prérogatives, l'une des marques les moins discutables de
sa grandeur.
Grandeur et responsabilité indissolublement associées.
Il va sans dire que l'acte libre authentique n'a rien à voir avec l'acte gratuit au sens gidien, tel que nous l'étudions
dans le chapitre sur la responsabilité.
L'acte libre ne saurait être, non plus, l'acte absurde que SARTRE nous présentait dans sa première philosophie
comme un acte dénué de toute signification propre sans justification intrinsèque, la liberté justifiant par son choix
cela même qu'elle choisit en se créant pour elle-même ses propres valeurs.
La liberté est une puissance de choix, de
consentement, d'acceptation ou de refus qui n'existe en fait que par rapport aux tendances de la nature humaine et
aux valeurs qui s'offrent à notre intelligence et à notre désir.
Elle n'est pas créatrice de valeurs, sinon par une
éventuelle association ou coopération avec la puissance divine.
L'homme est un être libre, mais sa liberté apparais dans une nature qu'il ne s'est pas donnée et dont elle est l'un des
attributs essentiels sans pouvoir être la source même de cette nature malgré la puissance de libération spirituelle
qu'elle comporte.
Il faut donc en convenir : si grande qu'elle soit, la liberté humaine n'est pas absolue, ne serait-ce
qu'en raison de la limitation des autres facultés qui sont en nous.
C'est une liberté relative à la condition humaine,
une liberté en situation comme on aime à le dire aujourd'hui, par rapport à notre condition en général et par rapport
à chacune des circonstances particulières intérieures et extérieures dans lesquelles nous sommes engagés.
Mais la liberté spirituelle existe-t-elle ?.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Quels sont les problèmes moraux, métaphysiques et psychologiques engagés dans la question de la liberté ou libre arbitre et du déterminisme ?
- LEIBNIZ: Libre(arbitre et indifférence
- La liberté et le libre arbitre ?
- Le libre arbitre et le sentiment immédiat de la liberté ?
- Explication d'un extrait d'Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer