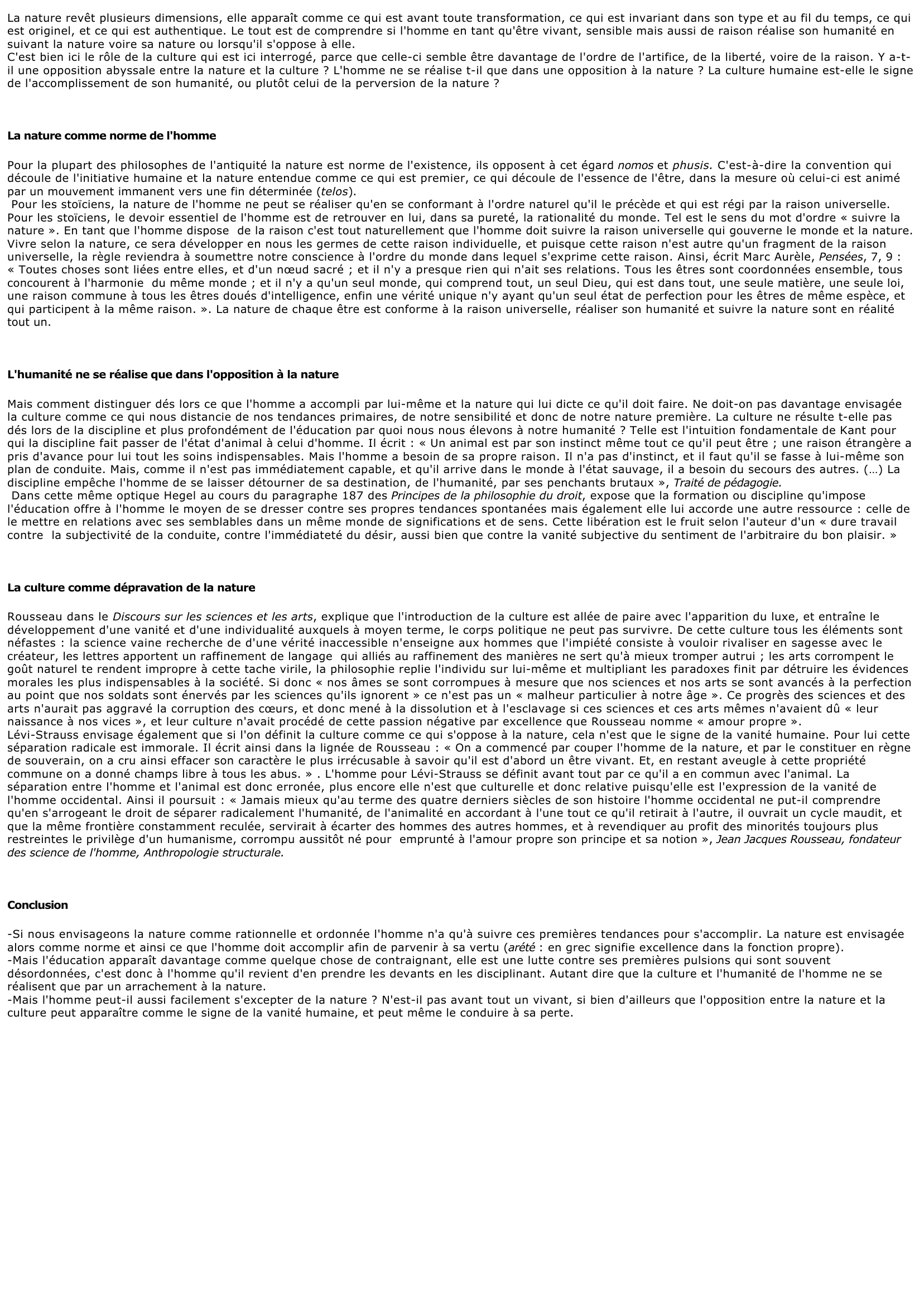l'homme est-il face ou dans la nature ?
Extrait du document
«
La nature revêt plusieurs dimensions, elle apparaît comme ce qui est avant toute transformation, ce qui est invariant dans son type et au fil du temps, ce qui
est originel, et ce qui est authentique.
Le tout est de comprendre si l'homme en tant qu'être vivant, sensible mais aussi de raison réalise son humanité en
suivant la nature voire sa nature ou lorsqu'il s'oppose à elle.
C'est bien ici le rôle de la culture qui est ici interrogé, parce que celle-ci semble être davantage de l'ordre de l'artifice, de la liberté, voire de la raison.
Y a-til une opposition abyssale entre la nature et la culture ? L'homme ne se réalise t-il que dans une opposition à la nature ? La culture humaine est-elle le signe
de l'accomplissement de son humanité, ou plutôt celui de la perversion de la nature ?
La nature comme norme de l'homme
Pour la plupart des philosophes de l'antiquité la nature est norme de l'existence, ils opposent à cet égard nomos et phusis.
C'est-à-dire la convention qui
découle de l'initiative humaine et la nature entendue comme ce qui est premier, ce qui découle de l'essence de l'être, dans la mesure où celui-ci est animé
par un mouvement immanent vers une fin déterminée (telos).
Pour les stoïciens, la nature de l'homme ne peut se réaliser qu'en se conformant à l'ordre naturel qu'il le précède et qui est régi par la raison universelle.
Pour les stoïciens, le devoir essentiel de l'homme est de retrouver en lui, dans sa pureté, la rationalité du monde.
Tel est le sens du mot d'ordre « suivre la
nature ».
En tant que l'homme dispose de la raison c'est tout naturellement que l'homme doit suivre la raison universelle qui gouverne le monde et la nature.
Vivre selon la nature, ce sera développer en nous les germes de cette raison individuelle, et puisque cette raison n'est autre qu'un fragment de la raison
universelle, la règle reviendra à soumettre notre conscience à l'ordre du monde dans lequel s'exprime cette raison.
Ainsi, écrit Marc Aurèle, Pensées, 7, 9 :
« Toutes choses sont liées entre elles, et d'un nœud sacré ; et il n'y a presque rien qui n'ait ses relations.
Tous les êtres sont coordonnées ensemble, tous
concourent à l'harmonie du même monde ; et il n'y a qu'un seul monde, qui comprend tout, un seul Dieu, qui est dans tout, une seule matière, une seule loi,
une raison commune à tous les êtres doués d'intelligence, enfin une vérité unique n'y ayant qu'un seul état de perfection pour les êtres de même espèce, et
qui participent à la même raison.
».
La nature de chaque être est conforme à la raison universelle, réaliser son humanité et suivre la nature sont en réalité
tout un.
L'humanité ne se réalise que dans l'opposition à la nature
Mais comment distinguer dés lors ce que l'homme a accompli par lui-même et la nature qui lui dicte ce qu'il doit faire.
Ne doit-on pas davantage envisagée
la culture comme ce qui nous distancie de nos tendances primaires, de notre sensibilité et donc de notre nature première.
La culture ne résulte t-elle pas
dés lors de la discipline et plus profondément de l'éducation par quoi nous nous élevons à notre humanité ? Telle est l'intuition fondamentale de Kant pour
qui la discipline fait passer de l'état d'animal à celui d'homme.
Il écrit : « Un animal est par son instinct même tout ce qu'il peut être ; une raison étrangère a
pris d'avance pour lui tout les soins indispensables.
Mais l'homme a besoin de sa propre raison.
Il n'a pas d'instinct, et il faut qu'il se fasse à lui-même son
plan de conduite.
Mais, comme il n'est pas immédiatement capable, et qu'il arrive dans le monde à l'état sauvage, il a besoin du secours des autres.
(…) La
discipline empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de l'humanité, par ses penchants brutaux », Traité de pédagogie.
Dans cette même optique Hegel au cours du paragraphe 187 des Principes de la philosophie du droit, expose que la formation ou discipline qu'impose
l'éducation offre à l'homme le moyen de se dresser contre ses propres tendances spontanées mais également elle lui accorde une autre ressource : celle de
le mettre en relations avec ses semblables dans un même monde de significations et de sens.
Cette libération est le fruit selon l'auteur d'un « dure travail
contre la subjectivité de la conduite, contre l'immédiateté du désir, aussi bien que contre la vanité subjective du sentiment de l'arbitraire du bon plaisir.
»
La culture comme dépravation de la nature
Rousseau dans le Discours sur les sciences et les arts, explique que l'introduction de la culture est allée de paire avec l'apparition du luxe, et entraîne le
développement d'une vanité et d'une individualité auxquels à moyen terme, le corps politique ne peut pas survivre.
De cette culture tous les éléments sont
néfastes : la science vaine recherche de d'une vérité inaccessible n'enseigne aux hommes que l'impiété consiste à vouloir rivaliser en sagesse avec le
créateur, les lettres apportent un raffinement de langage qui alliés au raffinement des manières ne sert qu'à mieux tromper autrui ; les arts corrompent le
goût naturel te rendent impropre à cette tache virile, la philosophie replie l'individu sur lui-même et multipliant les paradoxes finit par détruire les évidences
morales les plus indispensables à la société.
Si donc « nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection
au point que nos soldats sont énervés par les sciences qu'ils ignorent » ce n'est pas un « malheur particulier à notre âge ».
Ce progrès des sciences et des
arts n'aurait pas aggravé la corruption des cœurs, et donc mené à la dissolution et à l'esclavage si ces sciences et ces arts mêmes n'avaient dû « leur
naissance à nos vices », et leur culture n'avait procédé de cette passion négative par excellence que Rousseau nomme « amour propre ».
Lévi-Strauss envisage également que si l'on définit la culture comme ce qui s'oppose à la nature, cela n'est que le signe de la vanité humaine.
Pour lui cette
séparation radicale est immorale.
Il écrit ainsi dans la lignée de Rousseau : « On a commencé par couper l'homme de la nature, et par le constituer en règne
de souverain, on a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable à savoir qu'il est d'abord un être vivant.
Et, en restant aveugle à cette propriété
commune on a donné champs libre à tous les abus.
» .
L'homme pour Lévi-Strauss se définit avant tout par ce qu'il a en commun avec l'animal.
La
séparation entre l'homme et l'animal est donc erronée, plus encore elle n'est que culturelle et donc relative puisqu'elle est l'expression de la vanité de
l'homme occidental.
Ainsi il poursuit : « Jamais mieux qu'au terme des quatre derniers siècles de son histoire l'homme occidental ne put-il comprendre
qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité, de l'animalité en accordant à l'une tout ce qu'il retirait à l'autre, il ouvrait un cycle maudit, et
que la même frontière constamment reculée, servirait à écarter des hommes des autres hommes, et à revendiquer au profit des minorités toujours plus
restreintes le privilège d'un humanisme, corrompu aussitôt né pour emprunté à l'amour propre son principe et sa notion », Jean Jacques Rousseau, fondateur
des science de l'homme, Anthropologie structurale.
Conclusion
-Si nous envisageons la nature comme rationnelle et ordonnée l'homme n'a qu'à suivre ces premières tendances pour s'accomplir.
La nature est envisagée
alors comme norme et ainsi ce que l'homme doit accomplir afin de parvenir à sa vertu (arété : en grec signifie excellence dans la fonction propre).
-Mais l'éducation apparaît davantage comme quelque chose de contraignant, elle est une lutte contre ses premières pulsions qui sont souvent
désordonnées, c'est donc à l'homme qu'il revient d'en prendre les devants en les disciplinant.
Autant dire que la culture et l'humanité de l'homme ne se
réalisent que par un arrachement à la nature.
-Mais l'homme peut-il aussi facilement s'excepter de la nature ? N'est-il pas avant tout un vivant, si bien d'ailleurs que l'opposition entre la nature et la
culture peut apparaître comme le signe de la vanité humaine, et peut même le conduire à sa perte..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La société de consommation ou le détournement de l’Homme vis-à-vis de la nature
- l'homme est il maitre de la nature
- Travail/Nature/technique: le travail est-il le propre de l'homme ?
- Pourquoi l'Homme transforme-t-il la nature ?
- Est-ce que l'homme est en symbiose avec la nature?