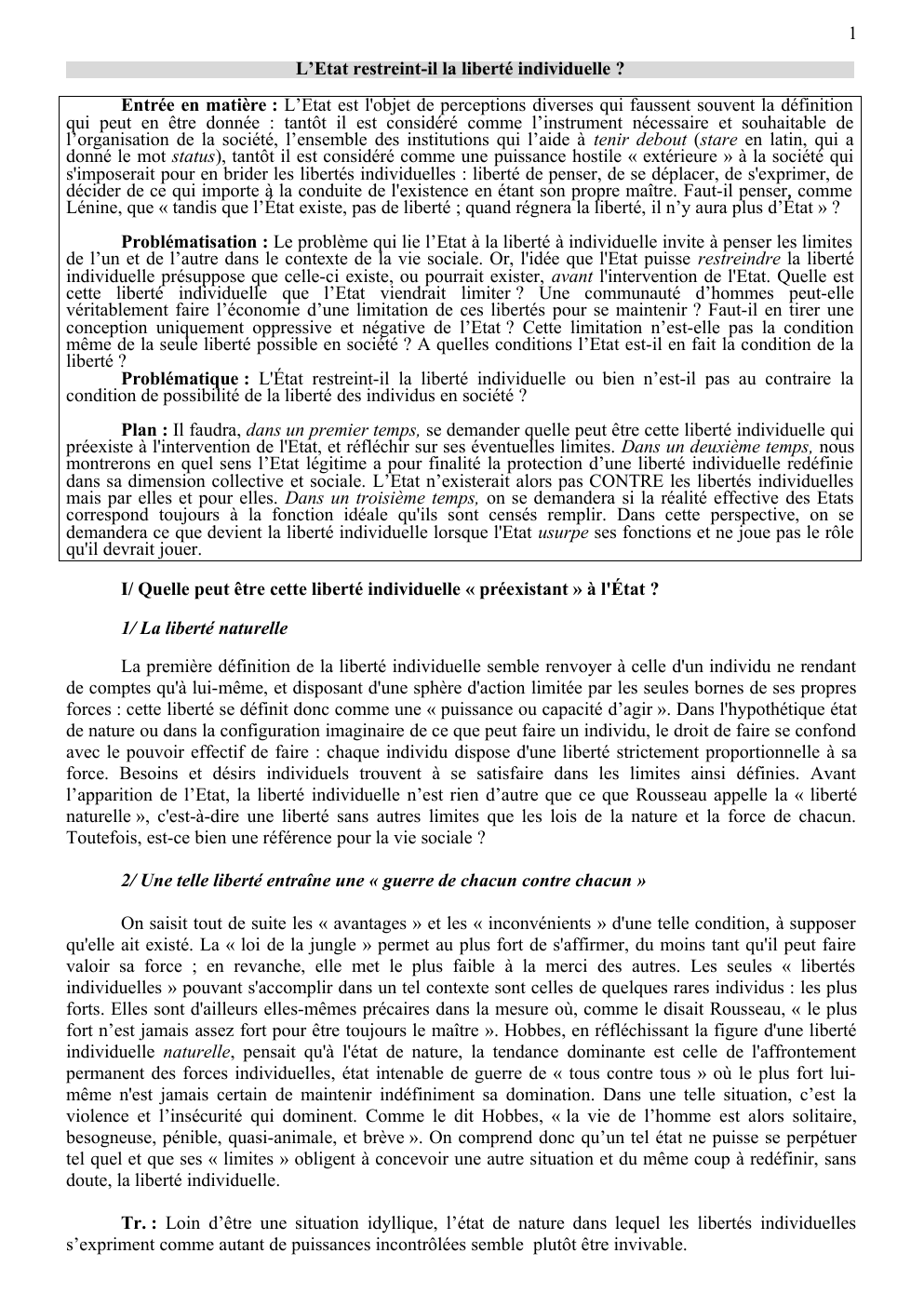l'État restreint-il la liberté individuelle ?
Publié le 11/04/2025
Extrait du document
«
1
L’Etat restreint-il la liberté individuelle ?
Entrée en matière : L’Etat est l'objet de perceptions diverses qui faussent souvent la définition
qui peut en être donnée : tantôt il est considéré comme l’instrument nécessaire et souhaitable de
l’organisation de la société, l’ensemble des institutions qui l’aide à tenir debout (stare en latin, qui a
donné le mot status), tantôt il est considéré comme une puissance hostile « extérieure » à la société qui
s'imposerait pour en brider les libertés individuelles : liberté de penser, de se déplacer, de s'exprimer, de
décider de ce qui importe à la conduite de l'existence en étant son propre maître.
Faut-il penser, comme
Lénine, que « tandis que l’État existe, pas de liberté ; quand régnera la liberté, il n’y aura plus d’État » ?
Problématisation : Le problème qui lie l’Etat à la liberté à individuelle invite à penser les limites
de l’un et de l’autre dans le contexte de la vie sociale.
Or, l'idée que l'Etat puisse restreindre la liberté
individuelle présuppose que celle-ci existe, ou pourrait exister, avant l'intervention de l'Etat.
Quelle est
cette liberté individuelle que l’Etat viendrait limiter ? Une communauté d’hommes peut-elle
véritablement faire l’économie d’une limitation de ces libertés pour se maintenir ? Faut-il en tirer une
conception uniquement oppressive et négative de l’Etat ? Cette limitation n’est-elle pas la condition
même de la seule liberté possible en société ? A quelles conditions l’Etat est-il en fait la condition de la
liberté ?
Problématique : L'État restreint-il la liberté individuelle ou bien n’est-il pas au contraire la
condition de possibilité de la liberté des individus en société ?
Plan : Il faudra, dans un premier temps, se demander quelle peut être cette liberté individuelle qui
préexiste à l'intervention de l'Etat, et réfléchir sur ses éventuelles limites.
Dans un deuxième temps, nous
montrerons en quel sens l’Etat légitime a pour finalité la protection d’une liberté individuelle redéfinie
dans sa dimension collective et sociale.
L’Etat n’existerait alors pas CONTRE les libertés individuelles
mais par elles et pour elles.
Dans un troisième temps, on se demandera si la réalité effective des Etats
correspond toujours à la fonction idéale qu'ils sont censés remplir.
Dans cette perspective, on se
demandera ce que devient la liberté individuelle lorsque l'Etat usurpe ses fonctions et ne joue pas le rôle
qu'il devrait jouer.
I/ Quelle peut être cette liberté individuelle « préexistant » à l'État ?
1/ La liberté naturelle
La première définition de la liberté individuelle semble renvoyer à celle d'un individu ne rendant
de comptes qu'à lui-même, et disposant d'une sphère d'action limitée par les seules bornes de ses propres
forces : cette liberté se définit donc comme une « puissance ou capacité d’agir ».
Dans l'hypothétique état
de nature ou dans la configuration imaginaire de ce que peut faire un individu, le droit de faire se confond
avec le pouvoir effectif de faire : chaque individu dispose d'une liberté strictement proportionnelle à sa
force.
Besoins et désirs individuels trouvent à se satisfaire dans les limites ainsi définies.
Avant
l’apparition de l’Etat, la liberté individuelle n’est rien d’autre que ce que Rousseau appelle la « liberté
naturelle », c'est-à-dire une liberté sans autres limites que les lois de la nature et la force de chacun.
Toutefois, est-ce bien une référence pour la vie sociale ?
2/ Une telle liberté entraîne une « guerre de chacun contre chacun »
On saisit tout de suite les « avantages » et les « inconvénients » d'une telle condition, à supposer
qu'elle ait existé.
La « loi de la jungle » permet au plus fort de s'affirmer, du moins tant qu'il peut faire
valoir sa force ; en revanche, elle met le plus faible à la merci des autres.
Les seules « libertés
individuelles » pouvant s'accomplir dans un tel contexte sont celles de quelques rares individus : les plus
forts.
Elles sont d'ailleurs elles-mêmes précaires dans la mesure où, comme le disait Rousseau, « le plus
fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître ».
Hobbes, en réfléchissant la figure d'une liberté
individuelle naturelle, pensait qu'à l'état de nature, la tendance dominante est celle de l'affrontement
permanent des forces individuelles, état intenable de guerre de « tous contre tous » où le plus fort luimême n'est jamais certain de maintenir indéfiniment sa domination.
Dans une telle situation, c’est la
violence et l’insécurité qui dominent.
Comme le dit Hobbes, « la vie de l’homme est alors solitaire,
besogneuse, pénible, quasi-animale, et brève ».
On comprend donc qu’un tel état ne puisse se perpétuer
tel quel et que ses « limites » obligent à concevoir une autre situation et du même coup à redéfinir, sans
doute, la liberté individuelle.
Tr.
: Loin d’être une situation idyllique, l’état de nature dans lequel les libertés individuelles
s’expriment comme autant de puissances incontrôlées semble plutôt être invivable.
2
3/ Aucune vie sociale n’est possible sans limitation de la liberté naturelle
La vie sociale n’est possible qu’à condition de renoncer à cette liberté naturelle et destructrice
dans la mesure où elle ne peut se réguler elle-même et semble condamner l’espèce humaine à sa
destruction ou, au mieux, à une vie « quasi-animale ».
Selon Hobbes, « aussi longtemps que les hommes
vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme
guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun.
» Seul un pouvoir suffisamment puissant peut
mettre fin à l’état de nature et aux conflits que les libertés individuelles non régulées ne cessent de
provoquer.
Ainsi, la paix civile semble conditionnée par une limitation de la liberté individuelle de
chacun.
Exiger l’ordre et l’organisation d’une communauté, c’est affirmer de fait la nécessité d’un
pouvoir qui pose des interdits et des sanctions : l’Etat.
Ainsi, l’Etat apparaît comme cette puissance qui rend possible la vie sociale en régulant par les
limites, des libertés individuelles qui, sinon s’entredétruiraient.
Il ne suffit donc pas de dire que l’Etat
restreint la liberté individuelle et d’en tirer une conception oppressive de l’Etat.
Il faut ajouter qu’une telle
liberté, si elle n’était pas restreinte, se nierait elle-même puisqu’elle entraîne violence et chaos.
Tr.
: loin d’être privative de liberté, l’apparition de l’Etat semble au contraire être la condition de
coexistence des libertés individuelles entre elles.
Toutefois, pour que cette fin soit atteinte, certaines
conditions doivent être remplies.
II/ L’Etat instaure une liberté politique plus avantageuse
1/ La création d’un état de droit n’est pas destructrice de la liberté
Reconnaître que seul un pouvoir commun puisse mettre fin à « la guerre de chacun contre
chacun » de l’état de nature, c'est-à-dire reconnaître la nécessité de l’Etat pour empêcher les libertés de
s’entredétruire ne signifie pas pour autant que toute forme d’Etat soit préférable à l’absence d’Etat.
En
effet, le but n’est pas de substituer l’oppression au chaos.
Pour que l’Etat ne soit pas perçu comme une
instance négatrice de la liberté individuelle, il faut qu’il soit au service de tous et de chacun.
Selon
Spinoza, « dans un État et sous un commandement pour lesquels la loi suprême est le salut de tout le
peuple », càd l’intérêt général, l’obéissance à la loi conduit à la liberté.
En effet, obéir à une loi qui sert
mon intérêt, c’est en fait obéir à moi-même, ce qui définit la liberté.
Renonçant à l’usage de sa liberté naturelle, les associés acceptent de se plier désormais aux
décisions communes en obéissant à des lois qui servent l’intérêt général.
Désormais, la liberté
individuelle ne peut plus être pensée indépendamment de sa dimension collective.
En quittant l’état de
nature pour l’état de droit par un contrat social, les hommes adoptent un nouveau statut, celui de citoyen,
et redéfinissent en même temps leur liberté puisqu’elle est désormais définie par la loi et non plus selon la
puissance ou la force.
Dans cette perspective, on peut alors appeler « Etat » l’ensemble des institutions
nécessaires pour organiser la vie de la société et réglementer cette nouvelle liberté : l’administration, la
justice, la police, l’armée, l’éducation.
L’apparition de l’État n'est alors nullement un facteur de restriction
des libertés individuelles, puisqu’il est au contraire le moyen par lequel est instauré un nouvel ordre –
l’état de droit – et une nouvelle liberté – la liberté civile ou politique –.
Tr.
: Loin d’être ce qui restreint la liberté, l’Etat est au contraire ce pouvoir qui l’instaure en la
reconnaissant sous la forme des droits du citoyen.
Instituée par le peuple et pour le peuple, cette liberté
politique vient se substituer à la liberté naturelle de l’état de nature.
L’instauration de ce nouvel ordre
modifie en même temps la définition de la liberté : elle ne doit plus être comprise comme indépendance,
mais comme autonomie et intègre dans son essence l’idée de limitation.
2/ De l’indépendance à l’autonomie : la création de l’Etat change la définition de la liberté
Par le contrat social, l’homme change de nature et devient un citoyen ; dans le même mouvement,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- l'Etat restreint-il la liberté individuelle ?
- L'ÉTAT RESTREINT-IL LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ?
- L'état restreint-il la liberté individuelle ?
- l'État restreint-il la liberté individuelle ?
- Smith: La liberté individuelle est-elle compatible avec la vie en société ?