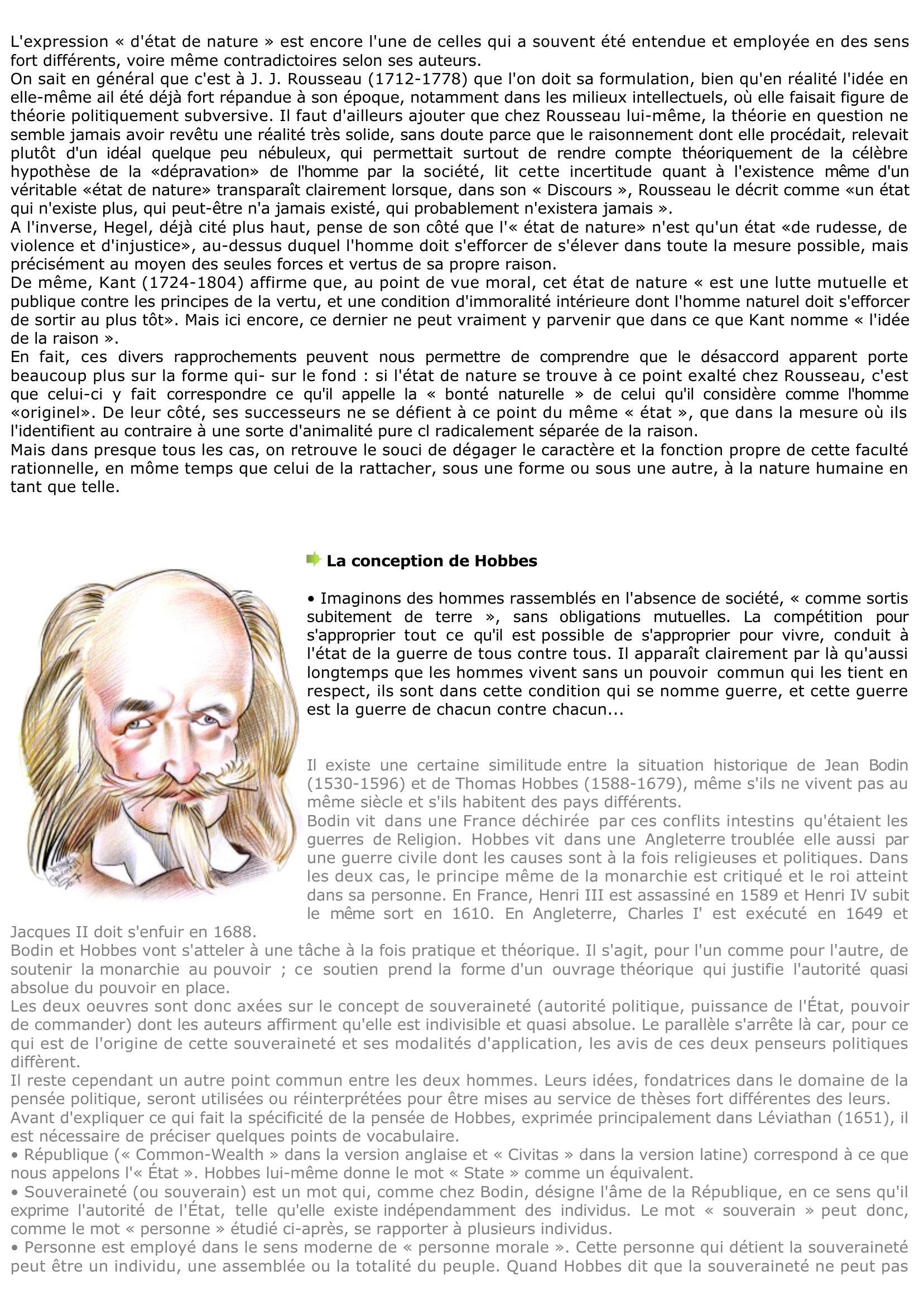L'état de nature ?
Extrait du document
«
L'expression « d'état de nature » est encore l'une de celles qui a souvent été entendue et employée en des sens
fort différents, voire même contradictoires selon ses auteurs.
On sait en général que c'est à J.
J.
Rousseau (1712-1778) que l'on doit sa formulation, bien qu'en réalité l'idée en
elle-même ail été déjà fort répandue à son époque, notamment dans les milieux intellectuels, où elle faisait figure de
théorie politiquement subversive.
Il faut d'ailleurs ajouter que chez Rousseau lui-même, la théorie en question ne
semble jamais avoir revêtu une réalité très solide, sans doute parce que le raisonnement dont elle procédait, relevait
plutôt d'un idéal quelque peu nébuleux, qui permettait surtout de rendre compte théoriquement de la célèbre
hypothèse de la «dépravation» de l'homme par la société, lit cette incertitude quant à l'existence même d'un
véritable «état de nature» transparaît clairement lorsque, dans son « Discours », Rousseau le décrit comme «un état
qui n'existe plus, qui peut-être n'a jamais existé, qui probablement n'existera jamais ».
A l'inverse, Hegel, déjà cité plus haut, pense de son côté que l'« état de nature» n'est qu'un état «de rudesse, de
violence et d'injustice», au-dessus duquel l'homme doit s'efforcer de s'élever dans toute la mesure possible, mais
précisément au moyen des seules forces et vertus de sa propre raison.
De même, Kant (1724-1804) affirme que, au point de vue moral, cet état de nature « est une lutte mutuelle et
publique contre les principes de la vertu, et une condition d'immoralité intérieure dont l'homme naturel doit s'efforcer
de sortir au plus tôt».
Mais ici encore, ce dernier ne peut vraiment y parvenir que dans ce que Kant nomme « l'idée
de la raison ».
En fait, ces divers rapprochements peuvent nous permettre de comprendre que le désaccord apparent porte
beaucoup plus sur la forme qui- sur le fond : si l'état de nature se trouve à ce point exalté chez Rousseau, c'est
que celui-ci y fait correspondre ce qu'il appelle la « bonté naturelle » de celui qu'il considère comme l'homme
«originel».
De leur côté, ses successeurs ne se défient à ce point du même « état », que dans la mesure où ils
l'identifient au contraire à une sorte d'animalité pure cl radicalement séparée de la raison.
Mais dans presque tous les cas, on retrouve le souci de dégager le caractère et la fonction propre de cette faculté
rationnelle, en môme temps que celui de la rattacher, sous une forme ou sous une autre, à la nature humaine en
tant que telle.
La conception de Hobbes
• Imaginons des hommes rassemblés en l'absence de société, « comme sortis
subitement de terre », sans obligations mutuelles.
La compétition pour
s'approprier tout ce qu'il est possible de s'approprier pour vivre, conduit à
l'état de la guerre de tous contre tous.
Il apparaît clairement par là qu'aussi
longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient en
respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre
est la guerre de chacun contre chacun...
Il existe une certaine similitude entre la situation historique de Jean Bodin
(1530-1596) et de Thomas Hobbes (1588-1679), même s'ils ne vivent pas au
même siècle et s'ils habitent des pays différents.
Bodin vit dans une France déchirée par ces conflits intestins qu'étaient les
guerres de Religion.
Hobbes vit dans une Angleterre troublée elle aussi par
une guerre civile dont les causes sont à la fois religieuses et politiques.
Dans
les deux cas, le principe même de la monarchie est critiqué et le roi atteint
dans sa personne.
En France, Henri III est assassiné en 1589 et Henri IV subit
le même sort en 1610.
En Angleterre, Charles I' est exécuté en 1649 et
Jacques II doit s'enfuir en 1688.
Bodin et Hobbes vont s'atteler à une tâche à la fois pratique et théorique.
Il s'agit, pour l'un comme pour l'autre, de
soutenir la monarchie au pouvoir ; ce soutien prend la forme d'un ouvrage théorique qui justifie l'autorité quasi
absolue du pouvoir en place.
Les deux oeuvres sont donc axées sur le concept de souveraineté (autorité politique, puissance de l'État, pouvoir
de commander) dont les auteurs affirment qu'elle est indivisible et quasi absolue.
Le parallèle s'arrête là car, pour ce
qui est de l'origine de cette souveraineté et ses modalités d'application, les avis de ces deux penseurs politiques
diffèrent.
Il reste cependant un autre point commun entre les deux hommes.
Leurs idées, fondatrices dans le domaine de la
pensée politique, seront utilisées ou réinterprétées pour être mises au service de thèses fort différentes des leurs.
Avant d'expliquer ce qui fait la spécificité de la pensée de Hobbes, exprimée principalement dans Léviathan (1651), il
est nécessaire de préciser quelques points de vocabulaire.
• République (« Common-Wealth » dans la version anglaise et « Civitas » dans la version latine) correspond à ce que
nous appelons l'« État ».
Hobbes lui-même donne le mot « State » comme un équivalent.
• Souveraineté (ou souverain) est un mot qui, comme chez Bodin, désigne l'âme de la République, en ce sens qu'il
exprime l'autorité de l'État, telle qu'elle existe indépendamment des individus.
Le mot « souverain » peut donc,
comme le mot « personne » étudié ci-après, se rapporter à plusieurs individus.
• Personne est employé dans le sens moderne de « personne morale ».
Cette personne qui détient la souveraineté
peut être un individu, une assemblée ou la totalité du peuple.
Quand Hobbes dit que la souveraineté ne peut pas.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « L’art imite la nature » ARISTOTE
- L'art n'est-il qu'une imitation de la nature? (corrigé)
- Richard Feynman: La Nature de la physique
- PHILO - TERMINALES GENERALES ET TECHNOLOGIQUES - 2022 PARTIE I : NATURE ET TECHNIQUE.
- Faut il proteger la nature de Christine cost