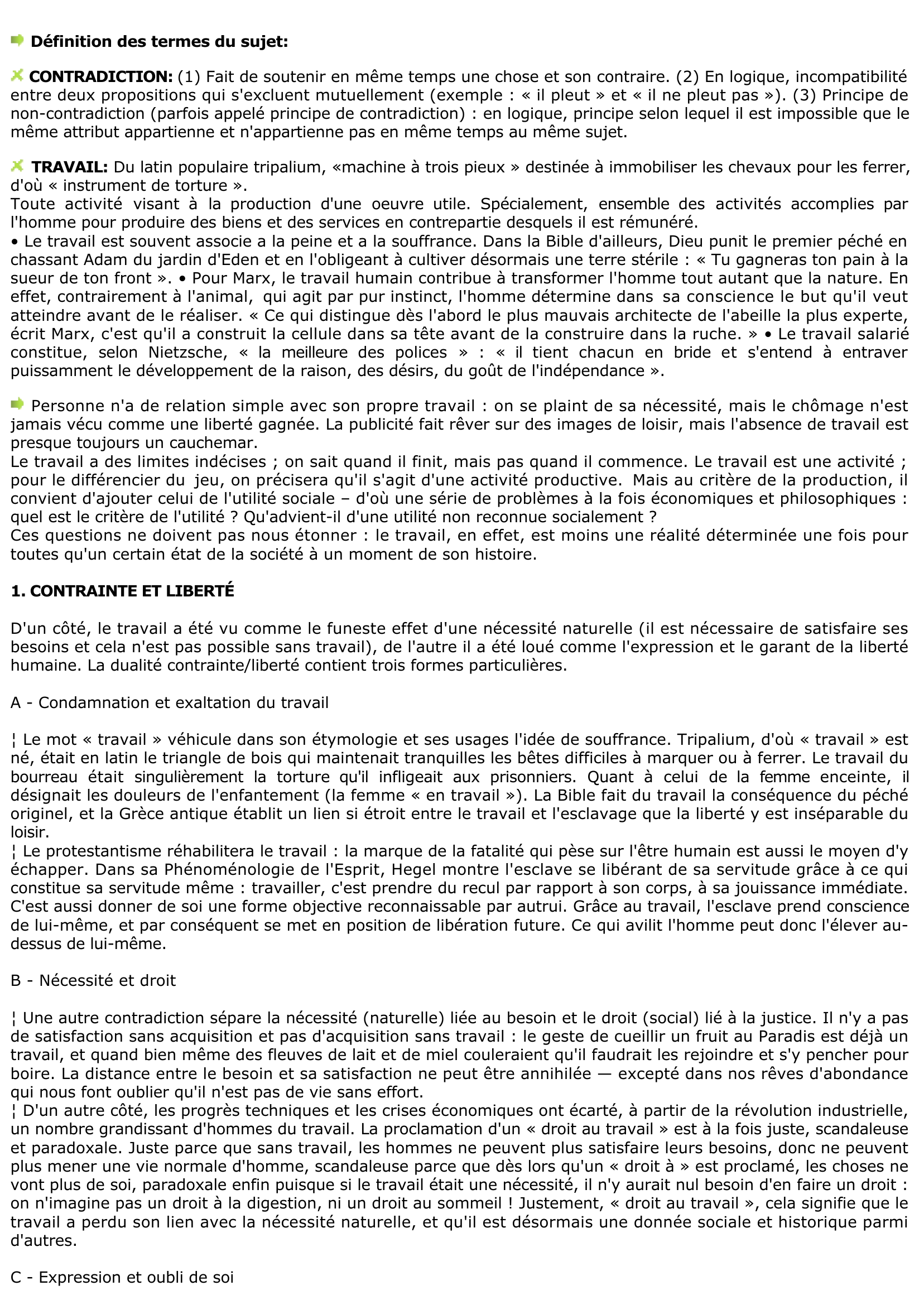Les contradictions du travail
Extrait du document
«
Définition des termes du sujet:
CONTRADICTION: (1) Fait de soutenir en même temps une chose et son contraire.
(2) En logique, incompatibilité
entre deux propositions qui s'excluent mutuellement (exemple : « il pleut » et « il ne pleut pas »).
(3) Principe de
non-contradiction (parfois appelé principe de contradiction) : en logique, principe selon lequel il est impossible que le
même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet.
TRAVAIL: Du latin populaire tripalium, «machine à trois pieux » destinée à immobiliser les chevaux pour les ferrer,
d'où « instrument de torture ».
Toute activité visant à la production d'une oeuvre utile.
Spécialement, ensemble des activités accomplies par
l'homme pour produire des biens et des services en contrepartie desquels il est rémunéré.
• Le travail est souvent associe a la peine et a la souffrance.
Dans la Bible d'ailleurs, Dieu punit le premier péché en
chassant Adam du jardin d'Eden et en l'obligeant à cultiver désormais une terre stérile : « Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front ».
• Pour Marx, le travail humain contribue à transformer l'homme tout autant que la nature.
En
effet, contrairement à l'animal, qui agit par pur instinct, l'homme détermine dans sa conscience le but qu'il veut
atteindre avant de le réaliser.
« Ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte,
écrit Marx, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche.
» • Le travail salarié
constitue, selon Nietzsche, « la meilleure des polices » : « il tient chacun en bride et s'entend à entraver
puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance ».
Personne n'a de relation simple avec son propre travail : on se plaint de sa nécessité, mais le chômage n'est
jamais vécu comme une liberté gagnée.
La publicité fait rêver sur des images de loisir, mais l'absence de travail est
presque toujours un cauchemar.
Le travail a des limites indécises ; on sait quand il finit, mais pas quand il commence.
Le travail est une activité ;
pour le différencier du jeu, on précisera qu'il s'agit d'une activité productive.
Mais au critère de la production, il
convient d'ajouter celui de l'utilité sociale – d'où une série de problèmes à la fois économiques et philosophiques :
quel est le critère de l'utilité ? Qu'advient-il d'une utilité non reconnue socialement ?
Ces questions ne doivent pas nous étonner : le travail, en effet, est moins une réalité déterminée une fois pour
toutes qu'un certain état de la société à un moment de son histoire.
1.
CONTRAINTE ET LIBERTÉ
D'un côté, le travail a été vu comme le funeste effet d'une nécessité naturelle (il est nécessaire de satisfaire ses
besoins et cela n'est pas possible sans travail), de l'autre il a été loué comme l'expression et le garant de la liberté
humaine.
La dualité contrainte/liberté contient trois formes particulières.
A - Condamnation et exaltation du travail
¦ Le mot « travail » véhicule dans son étymologie et ses usages l'idée de souffrance.
Tripalium, d'où « travail » est
né, était en latin le triangle de bois qui maintenait tranquilles les bêtes difficiles à marquer ou à ferrer.
Le travail du
bourreau était singulièrement la torture qu'il infligeait aux prisonniers.
Quant à celui de la femme enceinte, il
désignait les douleurs de l'enfantement (la femme « en travail »).
La Bible fait du travail la conséquence du péché
originel, et la Grèce antique établit un lien si étroit entre le travail et l'esclavage que la liberté y est inséparable du
loisir.
¦ Le protestantisme réhabilitera le travail : la marque de la fatalité qui pèse sur l'être humain est aussi le moyen d'y
échapper.
Dans sa Phénoménologie de l'Esprit, Hegel montre l'esclave se libérant de sa servitude grâce à ce qui
constitue sa servitude même : travailler, c'est prendre du recul par rapport à son corps, à sa jouissance immédiate.
C'est aussi donner de soi une forme objective reconnaissable par autrui.
Grâce au travail, l'esclave prend conscience
de lui-même, et par conséquent se met en position de libération future.
Ce qui avilit l'homme peut donc l'élever audessus de lui-même.
B - Nécessité et droit
¦ Une autre contradiction sépare la nécessité (naturelle) liée au besoin et le droit (social) lié à la justice.
Il n'y a pas
de satisfaction sans acquisition et pas d'acquisition sans travail : le geste de cueillir un fruit au Paradis est déjà un
travail, et quand bien même des fleuves de lait et de miel couleraient qu'il faudrait les rejoindre et s'y pencher pour
boire.
La distance entre le besoin et sa satisfaction ne peut être annihilée — excepté dans nos rêves d'abondance
qui nous font oublier qu'il n'est pas de vie sans effort.
¦ D'un autre côté, les progrès techniques et les crises économiques ont écarté, à partir de la révolution industrielle,
un nombre grandissant d'hommes du travail.
La proclamation d'un « droit au travail » est à la fois juste, scandaleuse
et paradoxale.
Juste parce que sans travail, les hommes ne peuvent plus satisfaire leurs besoins, donc ne peuvent
plus mener une vie normale d'homme, scandaleuse parce que dès lors qu'un « droit à » est proclamé, les choses ne
vont plus de soi, paradoxale enfin puisque si le travail était une nécessité, il n'y aurait nul besoin d'en faire un droit :
on n'imagine pas un droit à la digestion, ni un droit au sommeil ! Justement, « droit au travail », cela signifie que le
travail a perdu son lien avec la nécessité naturelle, et qu'il est désormais une donnée sociale et historique parmi
d'autres.
C - Expression et oubli de soi.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Sujet : Le travail technique est-il une transformation de l’homme ?
- Travail/Nature/technique: le travail est-il le propre de l'homme ?
- Le travail est il libérateur ?
- travail et bonheur
- Dissetation Le Travail nous rend il plus humain ?