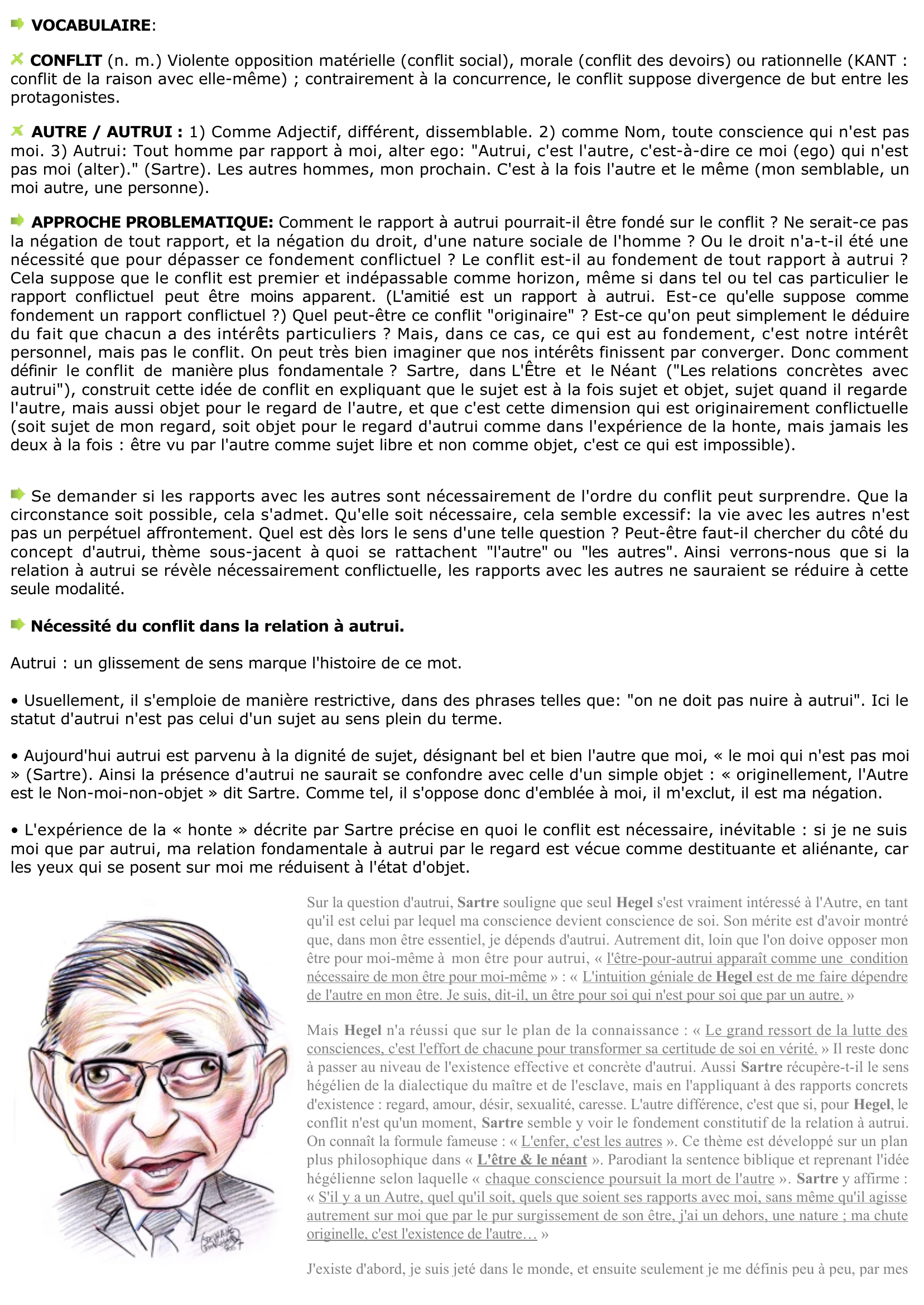Le rapport avec autrui est-il fondé sur le conflit ?
Extrait du document
«
VOCABULAIRE:
CONFLIT (n.
m.) Violente opposition matérielle (conflit social), morale (conflit des devoirs) ou rationnelle (KANT :
conflit de la raison avec elle-même) ; contrairement à la concurrence, le conflit suppose divergence de but entre les
protagonistes.
AUTRE / AUTRUI : 1) Comme Adjectif, différent, dissemblable.
2) comme Nom, toute conscience qui n'est pas
moi.
3) Autrui: Tout homme par rapport à moi, alter ego: "Autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire ce moi (ego) qui n'est
pas moi (alter)." (Sartre).
Les autres hommes, mon prochain.
C'est à la fois l'autre et le même (mon semblable, un
moi autre, une personne).
APPROCHE PROBLEMATIQUE: Comment le rapport à autrui pourrait-il être fondé sur le conflit ? Ne serait-ce pas
la négation de tout rapport, et la négation du droit, d'une nature sociale de l'homme ? Ou le droit n'a-t-il été une
nécessité que pour dépasser ce fondement conflictuel ? Le conflit est-il au fondement de tout rapport à autrui ?
Cela suppose que le conflit est premier et indépassable comme horizon, même si dans tel ou tel cas particulier le
rapport conflictuel peut être moins apparent.
(L'amitié est un rapport à autrui.
Est-ce qu'elle suppose comme
fondement un rapport conflictuel ?) Quel peut-être ce conflit "originaire" ? Est-ce qu'on peut simplement le déduire
du fait que chacun a des intérêts particuliers ? Mais, dans ce cas, ce qui est au fondement, c'est notre intérêt
personnel, mais pas le conflit.
On peut très bien imaginer que nos intérêts finissent par converger.
Donc comment
définir le conflit de manière plus fondamentale ? Sartre, dans L'Être et le Néant ("Les relations concrètes avec
autrui"), construit cette idée de conflit en expliquant que le sujet est à la fois sujet et objet, sujet quand il regarde
l'autre, mais aussi objet pour le regard de l'autre, et que c'est cette dimension qui est originairement conflictuelle
(soit sujet de mon regard, soit objet pour le regard d'autrui comme dans l'expérience de la honte, mais jamais les
deux à la fois : être vu par l'autre comme sujet libre et non comme objet, c'est ce qui est impossible).
Se demander si les rapports avec les autres sont nécessairement de l'ordre du conflit peut surprendre.
Que la
circonstance soit possible, cela s'admet.
Qu'elle soit nécessaire, cela semble excessif: la vie avec les autres n'est
pas un perpétuel affrontement.
Quel est dès lors le sens d'une telle question ? Peut-être faut-il chercher du côté du
concept d'autrui, thème sous-jacent à quoi se rattachent "l'autre" ou "les autres".
Ainsi verrons-nous que si la
relation à autrui se révèle nécessairement conflictuelle, les rapports avec les autres ne sauraient se réduire à cette
seule modalité.
Nécessité du conflit dans la relation à autrui.
Autrui : un glissement de sens marque l'histoire de ce mot.
• Usuellement, il s'emploie de manière restrictive, dans des phrases telles que: "on ne doit pas nuire à autrui".
Ici le
statut d'autrui n'est pas celui d'un sujet au sens plein du terme.
• Aujourd'hui autrui est parvenu à la dignité de sujet, désignant bel et bien l'autre que moi, « le moi qui n'est pas moi
» (Sartre).
Ainsi la présence d'autrui ne saurait se confondre avec celle d'un simple objet : « originellement, l'Autre
est le Non-moi-non-objet » dit Sartre.
Comme tel, il s'oppose donc d'emblée à moi, il m'exclut, il est ma négation.
• L'expérience de la « honte » décrite par Sartre précise en quoi le conflit est nécessaire, inévitable : si je ne suis
moi que par autrui, ma relation fondamentale à autrui par le regard est vécue comme destituante et aliénante, car
les yeux qui se posent sur moi me réduisent à l'état d'objet.
Sur la question d'autrui, Sartre souligne que seul Hegel s'est vraiment intéressé à l'Autre, en tant
qu'il est celui par lequel ma conscience devient conscience de soi.
Son mérite est d'avoir montré
que, dans mon être essentiel, je dépends d'autrui.
Autrement dit, loin que l'on doive opposer mon
être pour moi-même à mon être pour autrui, « l'être-pour-autrui apparaît comme une condition
nécessaire de mon être pour moi-même » : « L'intuition géniale de Hegel est de me faire dépendre
de l'autre en mon être.
Je suis, dit-il, un être pour soi qui n'est pour soi que par un autre.
»
Mais Hegel n'a réussi que sur le plan de la connaissance : « Le grand ressort de la lutte des
consciences, c'est l'effort de chacune pour transformer sa certitude de soi en vérité.
» Il reste donc
à passer au niveau de l'existence effective et concrète d'autrui.
Aussi Sartre récupère-t-il le sens
hégélien de la dialectique du maître et de l'esclave, mais en l'appliquant à des rapports concrets
d'existence : regard, amour, désir, sexualité, caresse.
L'autre différence, c'est que si, pour Hegel, le
conflit n'est qu'un moment, Sartre semble y voir le fondement constitutif de la relation à autrui.
On connaît la formule fameuse : « L'enfer, c'est les autres ».
Ce thème est développé sur un plan
plus philosophique dans « L'être & le néant ».
Parodiant la sentence biblique et reprenant l'idée
hégélienne selon laquelle « chaque conscience poursuit la mort de l'autre ».
Sartre y affirme :
« S'il y a un Autre, quel qu'il soit, quels que soient ses rapports avec moi, sans même qu'il agisse
autrement sur moi que par le pur surgissement de son être, j'ai un dehors, une nature ; ma chute
originelle, c'est l'existence de l'autre… »
J'existe d'abord, je suis jeté dans le monde, et ensuite seulement je me définis peu à peu, par mes.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le conflit est il au fondement de tout rapport avec autrui ?
- Le conflit est-il au fondement de tout rapport avec autrui ?
- Le conflit est-il au fondement de tout rapport avec autrui ?
- RAPPORT DE STAGE BTS AGRICULTURE
- rapport de stage BTS ASSISTANAT DE DIRECTION 2023-