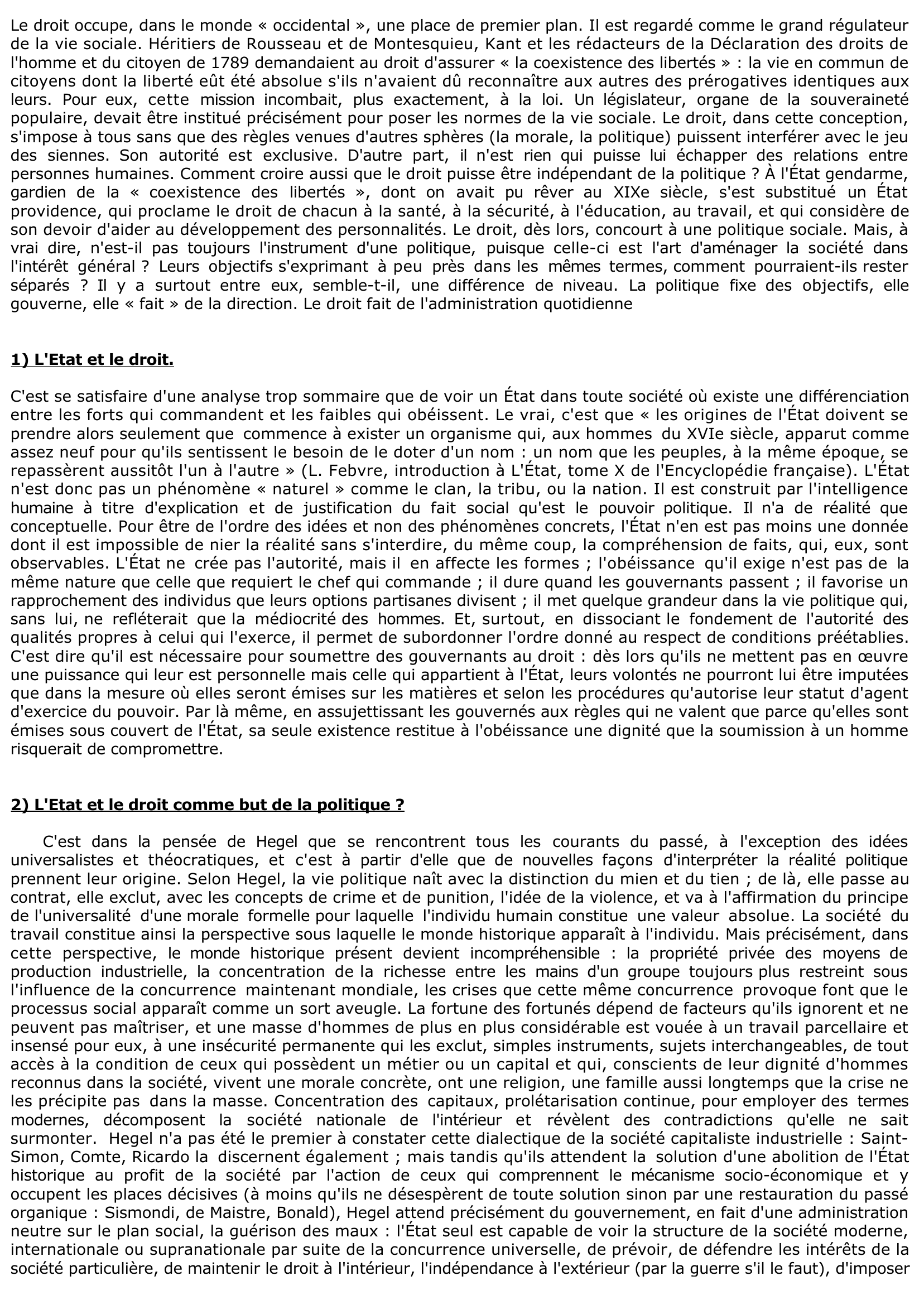Le droit est-il le seul horizon de la politique ?
Extrait du document
«
Le droit occupe, dans le monde « occidental », une place de premier plan.
Il est regardé comme le grand régulateur
de la vie sociale.
Héritiers de Rousseau et de Montesquieu, Kant et les rédacteurs de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 demandaient au droit d'assurer « la coexistence des libertés » : la vie en commun de
citoyens dont la liberté eût été absolue s'ils n'avaient dû reconnaître aux autres des prérogatives identiques aux
leurs.
Pour eux, cette mission incombait, plus exactement, à la loi.
Un législateur, organe de la souveraineté
populaire, devait être institué précisément pour poser les normes de la vie sociale.
Le droit, dans cette conception,
s'impose à tous sans que des règles venues d'autres sphères (la morale, la politique) puissent interférer avec le jeu
des siennes.
Son autorité est exclusive.
D'autre part, il n'est rien qui puisse lui échapper des relations entre
personnes humaines.
Comment croire aussi que le droit puisse être indépendant de la politique ? À l'État gendarme,
gardien de la « coexistence des libertés », dont on avait pu rêver au XIXe siècle, s'est substitué un État
providence, qui proclame le droit de chacun à la santé, à la sécurité, à l'éducation, au travail, et qui considère de
son devoir d'aider au développement des personnalités.
Le droit, dès lors, concourt à une politique sociale.
Mais, à
vrai dire, n'est-il pas toujours l'instrument d'une politique, puisque celle-ci est l'art d'aménager la société dans
l'intérêt général ? Leurs objectifs s'exprimant à peu près dans les mêmes termes, comment pourraient-ils rester
séparés ? Il y a surtout entre eux, semble-t-il, une différence de niveau.
La politique fixe des objectifs, elle
gouverne, elle « fait » de la direction.
Le droit fait de l'administration quotidienne
1) L'Etat et le droit.
C'est se satisfaire d'une analyse trop sommaire que de voir un État dans toute société où existe une différenciation
entre les forts qui commandent et les faibles qui obéissent.
Le vrai, c'est que « les origines de l'État doivent se
prendre alors seulement que commence à exister un organisme qui, aux hommes du XVIe siècle, apparut comme
assez neuf pour qu'ils sentissent le besoin de le doter d'un nom : un nom que les peuples, à la même époque, se
repassèrent aussitôt l'un à l'autre » (L.
Febvre, introduction à L'État, tome X de l'Encyclopédie française).
L'État
n'est donc pas un phénomène « naturel » comme le clan, la tribu, ou la nation.
Il est construit par l'intelligence
humaine à titre d'explication et de justification du fait social qu'est le pouvoir politique.
Il n'a de réalité que
conceptuelle.
Pour être de l'ordre des idées et non des phénomènes concrets, l'État n'en est pas moins une donnée
dont il est impossible de nier la réalité sans s'interdire, du même coup, la compréhension de faits, qui, eux, sont
observables.
L'État ne crée pas l'autorité, mais il en affecte les formes ; l'obéissance qu'il exige n'est pas de la
même nature que celle que requiert le chef qui commande ; il dure quand les gouvernants passent ; il favorise un
rapprochement des individus que leurs options partisanes divisent ; il met quelque grandeur dans la vie politique qui,
sans lui, ne refléterait que la médiocrité des hommes.
Et, surtout, en dissociant le fondement de l'autorité des
qualités propres à celui qui l'exerce, il permet de subordonner l'ordre donné au respect de conditions préétablies.
C'est dire qu'il est nécessaire pour soumettre des gouvernants au droit : dès lors qu'ils ne mettent pas en œuvre
une puissance qui leur est personnelle mais celle qui appartient à l'État, leurs volontés ne pourront lui être imputées
que dans la mesure où elles seront émises sur les matières et selon les procédures qu'autorise leur statut d'agent
d'exercice du pouvoir.
Par là même, en assujettissant les gouvernés aux règles qui ne valent que parce qu'elles sont
émises sous couvert de l'État, sa seule existence restitue à l'obéissance une dignité que la soumission à un homme
risquerait de compromettre.
2) L'Etat et le droit comme but de la politique ?
C'est dans la pensée de Hegel que se rencontrent tous les courants du passé, à l'exception des idées
universalistes et théocratiques, et c'est à partir d'elle que de nouvelles façons d'interpréter la réalité politique
prennent leur origine.
Selon Hegel, la vie politique naît avec la distinction du mien et du tien ; de là, elle passe au
contrat, elle exclut, avec les concepts de crime et de punition, l'idée de la violence, et va à l'affirmation du principe
de l'universalité d'une morale formelle pour laquelle l'individu humain constitue une valeur absolue.
La société du
travail constitue ainsi la perspective sous laquelle le monde historique apparaît à l'individu.
Mais précisément, dans
cette perspective, le monde historique présent devient incompréhensible : la propriété privée des moyens de
production industrielle, la concentration de la richesse entre les mains d'un groupe toujours plus restreint sous
l'influence de la concurrence maintenant mondiale, les crises que cette même concurrence provoque font que le
processus social apparaît comme un sort aveugle.
La fortune des fortunés dépend de facteurs qu'ils ignorent et ne
peuvent pas maîtriser, et une masse d'hommes de plus en plus considérable est vouée à un travail parcellaire et
insensé pour eux, à une insécurité permanente qui les exclut, simples instruments, sujets interchangeables, de tout
accès à la condition de ceux qui possèdent un métier ou un capital et qui, conscients de leur dignité d'hommes
reconnus dans la société, vivent une morale concrète, ont une religion, une famille aussi longtemps que la crise ne
les précipite pas dans la masse.
Concentration des capitaux, prolétarisation continue, pour employer des termes
modernes, décomposent la société nationale de l'intérieur et révèlent des contradictions qu'elle ne sait
surmonter.
Hegel n'a pas été le premier à constater cette dialectique de la société capitaliste industrielle : SaintSimon, Comte, Ricardo la discernent également ; mais tandis qu'ils attendent la solution d'une abolition de l'État
historique au profit de la société par l'action de ceux qui comprennent le mécanisme socio-économique et y
occupent les places décisives (à moins qu'ils ne désespèrent de toute solution sinon par une restauration du passé
organique : Sismondi, de Maistre, Bonald), Hegel attend précisément du gouvernement, en fait d'une administration
neutre sur le plan social, la guérison des maux : l'État seul est capable de voir la structure de la société moderne,
internationale ou supranationale par suite de la concurrence universelle, de prévoir, de défendre les intérêts de la
société particulière, de maintenir le droit à l'intérieur, l'indépendance à l'extérieur (par la guerre s'il le faut), d'imposer.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rapport entre Droit et politique
- La Politique et le droit
- Un critique contemporain définit l'esprit du XVIIIe siècle en ces termes: "Il fallait édifier une politique sans droit divin, une religion sans mystère, une morale sans dogme." Dans quelle mesure et avec quelles nuances ce jugement se trouve-t-il vérifié
- Avons-nous le droit de nous desinteréssé de la politique ?
- Faire régner la justice est-il du ressort du politique ou du droit ?