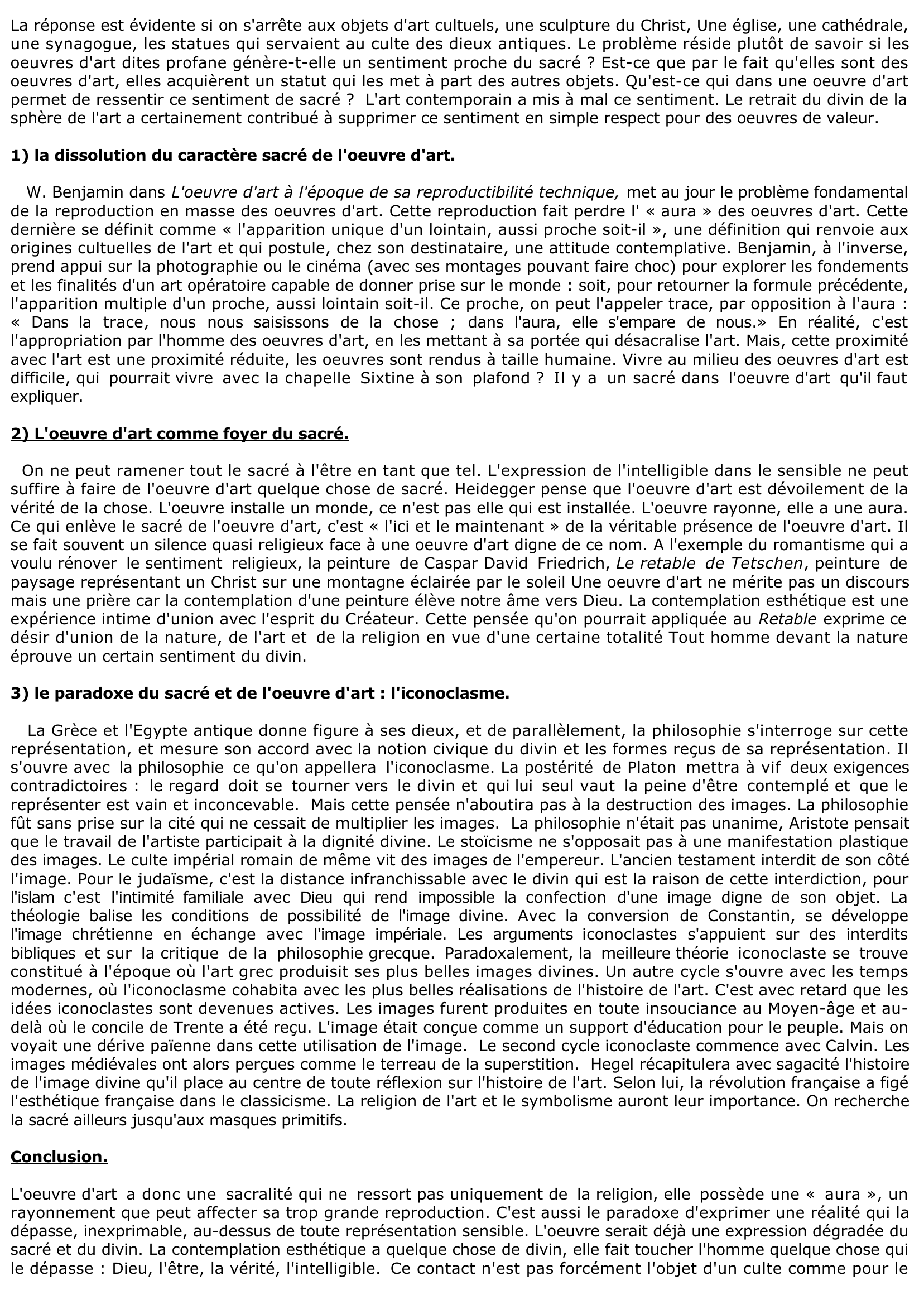l'art peut-il ne pas être sacré ?
Extrait du document
«
La réponse est évidente si on s'arrête aux objets d'art cultuels, une sculpture du Christ, Une église, une cathédrale,
une synagogue, les statues qui servaient au culte des dieux antiques.
Le problème réside plutôt de savoir si les
oeuvres d'art dites profane génère-t-elle un sentiment proche du sacré ? Est-ce que par le fait qu'elles sont des
oeuvres d'art, elles acquièrent un statut qui les met à part des autres objets.
Qu'est-ce qui dans une oeuvre d'art
permet de ressentir ce sentiment de sacré ? L'art contemporain a mis à mal ce sentiment.
Le retrait du divin de la
sphère de l'art a certainement contribué à supprimer ce sentiment en simple respect pour des oeuvres de valeur.
1) la dissolution du caractère sacré de l'oeuvre d'art.
W.
Benjamin dans L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, met au jour le problème fondamental
de la reproduction en masse des oeuvres d'art.
Cette reproduction fait perdre l' « aura » des oeuvres d'art.
Cette
dernière se définit comme « l'apparition unique d'un lointain, aussi proche soit-il », une définition qui renvoie aux
origines cultuelles de l'art et qui postule, chez son destinataire, une attitude contemplative.
Benjamin, à l'inverse,
prend appui sur la photographie ou le cinéma (avec ses montages pouvant faire choc) pour explorer les fondements
et les finalités d'un art opératoire capable de donner prise sur le monde : soit, pour retourner la formule précédente,
l'apparition multiple d'un proche, aussi lointain soit-il.
Ce proche, on peut l'appeler trace, par opposition à l'aura :
« Dans la trace, nous nous saisissons de la chose ; dans l'aura, elle s'empare de nous.» En réalité, c'est
l'appropriation par l'homme des oeuvres d'art, en les mettant à sa portée qui désacralise l'art.
Mais, cette proximité
avec l'art est une proximité réduite, les oeuvres sont rendus à taille humaine.
Vivre au milieu des oeuvres d'art est
difficile, qui pourrait vivre avec la chapelle Sixtine à son plafond ? Il y a un sacré dans l'oeuvre d'art qu'il faut
expliquer.
2) L'oeuvre d'art comme foyer du sacré.
On ne peut ramener tout le sacré à l'être en tant que tel.
L'expression de l'intelligible dans le sensible ne peut
suffire à faire de l'oeuvre d'art quelque chose de sacré.
Heidegger pense que l'oeuvre d'art est dévoilement de la
vérité de la chose.
L'oeuvre installe un monde, ce n'est pas elle qui est installée.
L'oeuvre rayonne, elle a une aura.
Ce qui enlève le sacré de l'oeuvre d'art, c'est « l'ici et le maintenant » de la véritable présence de l'oeuvre d'art.
Il
se fait souvent un silence quasi religieux face à une oeuvre d'art digne de ce nom.
A l'exemple du romantisme qui a
voulu rénover le sentiment religieux, la peinture de Caspar David Friedrich, Le retable de Tetschen, peinture de
paysage représentant un Christ sur une montagne éclairée par le soleil Une oeuvre d'art ne mérite pas un discours
mais une prière car la contemplation d'une peinture élève notre âme vers Dieu.
La contemplation esthétique est une
expérience intime d'union avec l'esprit du Créateur.
Cette pensée qu'on pourrait appliquée au Retable exprime ce
désir d'union de la nature, de l'art et de la religion en vue d'une certaine totalité Tout homme devant la nature
éprouve un certain sentiment du divin.
3) le paradoxe du sacré et de l'oeuvre d'art : l'iconoclasme.
La Grèce et l'Egypte antique donne figure à ses dieux, et de parallèlement, la philosophie s'interroge sur cette
représentation, et mesure son accord avec la notion civique du divin et les formes reçus de sa représentation.
Il
s'ouvre avec la philosophie ce qu'on appellera l'iconoclasme.
La postérité de Platon mettra à vif deux exigences
contradictoires : le regard doit se tourner vers le divin et qui lui seul vaut la peine d'être contemplé et que le
représenter est vain et inconcevable.
Mais cette pensée n'aboutira pas à la destruction des images.
La philosophie
fût sans prise sur la cité qui ne cessait de multiplier les images.
La philosophie n'était pas unanime, Aristote pensait
que le travail de l'artiste participait à la dignité divine.
Le stoïcisme ne s'opposait pas à une manifestation plastique
des images.
Le culte impérial romain de même vit des images de l'empereur.
L'ancien testament interdit de son côté
l'image.
Pour le judaïsme, c'est la distance infranchissable avec le divin qui est la raison de cette interdiction, pour
l'islam c'est l'intimité familiale avec Dieu qui rend impossible la confection d'une image digne de son objet.
La
théologie balise les conditions de possibilité de l'image divine.
Avec la conversion de Constantin, se développe
l'image chrétienne en échange avec l'image impériale.
Les arguments iconoclastes s'appuient sur des interdits
bibliques et sur la critique de la philosophie grecque.
Paradoxalement, la meilleure théorie iconoclaste se trouve
constitué à l'époque où l'art grec produisit ses plus belles images divines.
Un autre cycle s'ouvre avec les temps
modernes, où l'iconoclasme cohabita avec les plus belles réalisations de l'histoire de l'art.
C'est avec retard que les
idées iconoclastes sont devenues actives.
Les images furent produites en toute insouciance au Moyen-âge et audelà où le concile de Trente a été reçu.
L'image était conçue comme un support d'éducation pour le peuple.
Mais on
voyait une dérive païenne dans cette utilisation de l'image.
Le second cycle iconoclaste commence avec Calvin.
Les
images médiévales ont alors perçues comme le terreau de la superstition.
Hegel récapitulera avec sagacité l'histoire
de l'image divine qu'il place au centre de toute réflexion sur l'histoire de l'art.
Selon lui, la révolution française a figé
l'esthétique française dans le classicisme.
La religion de l'art et le symbolisme auront leur importance.
On recherche
la sacré ailleurs jusqu'aux masques primitifs.
Conclusion.
L'oeuvre d'art a donc une sacralité qui ne ressort pas uniquement de la religion, elle possède une « aura », un
rayonnement que peut affecter sa trop grande reproduction.
C'est aussi le paradoxe d'exprimer une réalité qui la
dépasse, inexprimable, au-dessus de toute représentation sensible.
L'oeuvre serait déjà une expression dégradée du
sacré et du divin.
La contemplation esthétique a quelque chose de divin, elle fait toucher l'homme quelque chose qui
le dépasse : Dieu, l'être, la vérité, l'intelligible.
Ce contact n'est pas forcément l'objet d'un culte comme pour le.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Une oeuvre d'art est-elle un objet sacré ?
- A quoi tient le côté dit sacré de l'art ?
- N'y a t il pas un caractère sacré de tout art ?
- Une oeuvre d'art est-elle un objet sacré ?
- La politique n'est-elle qu'un art du calcul ?