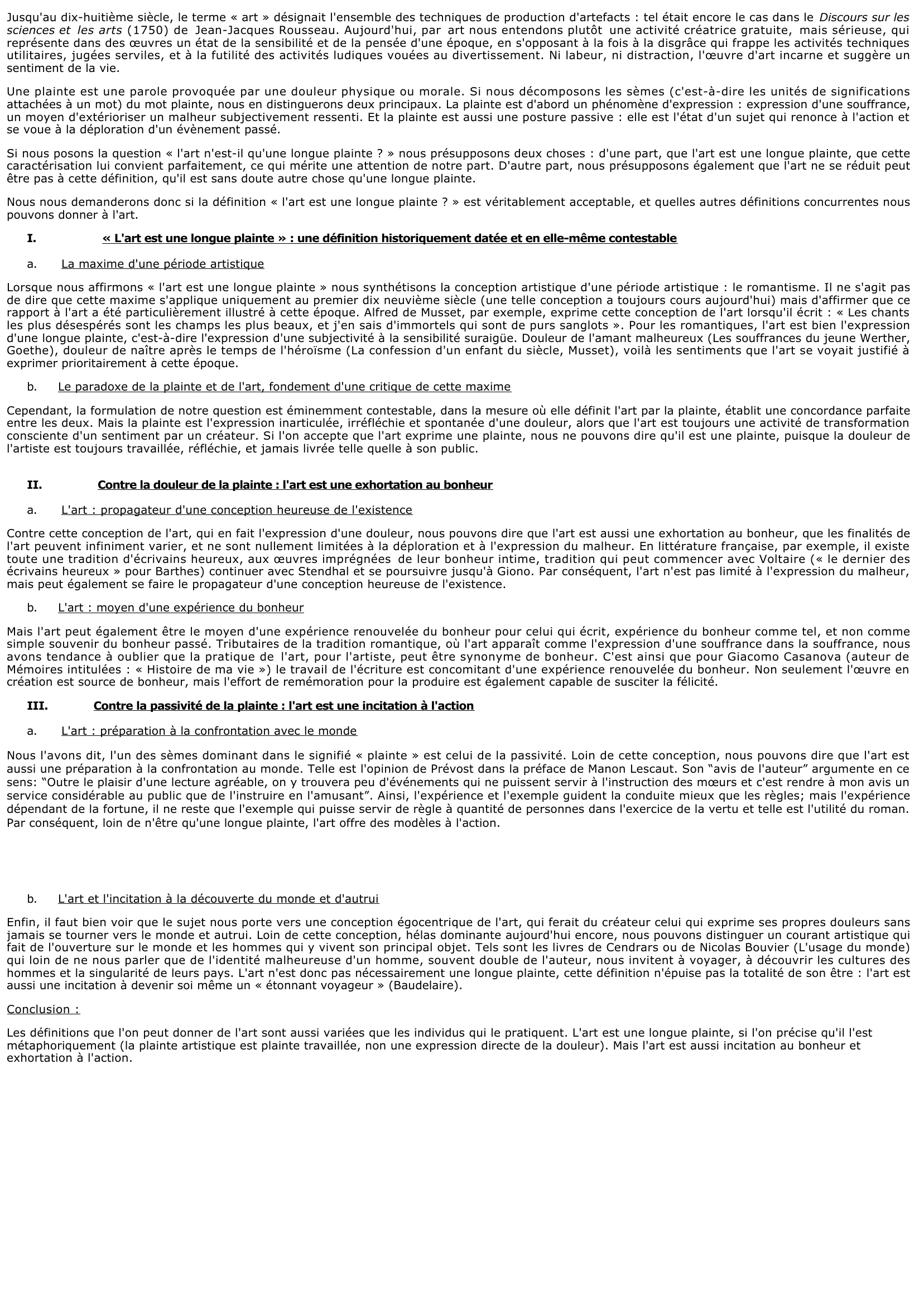L'art n'est il qu'une longue plainte ?
Extrait du document
«
Jusqu'au dix-huitième siècle, le terme « art » désignait l'ensemble des techniques de production d'artefacts : tel était encore le cas dans le Discours sur les
sciences et les arts (1750) de Jean-Jacques Rousseau.
Aujourd'hui, par art nous entendons plutôt une activité créatrice gratuite, mais sérieuse, qui
représente dans des œuvres un état de la sensibilité et de la pensée d'une époque, en s'opposant à la fois à la disgrâce qui frappe les activités techniques
utilitaires, jugées serviles, et à la futilité des activités ludiques vouées au divertissement.
Ni labeur, ni distraction, l'œuvre d'art incarne et suggère un
sentiment de la vie.
Une plainte est une parole provoquée par une douleur physique ou morale.
Si nous décomposons les sèmes (c'est-à-dire les unités de significations
attachées à un mot) du mot plainte, nous en distinguerons deux principaux.
La plainte est d'abord un phénomène d'expression : expression d'une souffrance,
un moyen d'extérioriser un malheur subjectivement ressenti.
Et la plainte est aussi une posture passive : elle est l'état d'un sujet qui renonce à l'action et
se voue à la déploration d'un évènement passé.
Si nous posons la question « l'art n'est-il qu'une longue plainte ? » nous présupposons deux choses : d'une part, que l'art est une longue plainte, que cette
caractérisation lui convient parfaitement, ce qui mérite une attention de notre part.
D'autre part, nous présupposons également que l'art ne se réduit peut
être pas à cette définition, qu'il est sans doute autre chose qu'une longue plainte.
Nous nous demanderons donc si la définition « l'art est une longue plainte ? » est véritablement acceptable, et quelles autres définitions concurrentes nous
pouvons donner à l'art.
I.
a.
« L'art est une longue plainte » : une définition historiquement datée et en elle-même contestable
La maxime d'une période artistique
Lorsque nous affirmons « l'art est une longue plainte » nous synthétisons la conception artistique d'une période artistique : le romantisme.
Il ne s'agit pas
de dire que cette maxime s'applique uniquement au premier dix neuvième siècle (une telle conception a toujours cours aujourd'hui) mais d'affirmer que ce
rapport à l'art a été particulièrement illustré à cette époque.
Alfred de Musset, par exemple, exprime cette conception de l'art lorsqu'il écrit : « Les chants
les plus désespérés sont les champs les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots ».
Pour les romantiques, l'art est bien l'expression
d'une longue plainte, c'est-à-dire l'expression d'une subjectivité à la sensibilité suraigüe.
Douleur de l'amant malheureux (Les souffrances du jeune Werther,
Goethe), douleur de naître après le temps de l'héroïsme (La confession d'un enfant du siècle, Musset), voilà les sentiments que l'art se voyait justifié à
exprimer prioritairement à cette époque.
b.
Le paradoxe de la plainte et de l'art, fondement d'une critique de cette maxime
Cependant, la formulation de notre question est éminemment contestable, dans la mesure où elle définit l'art par la plainte, établit une concordance parfaite
entre les deux.
Mais la plainte est l'expression inarticulée, irréfléchie et spontanée d'une douleur, alors que l'art est toujours une activité de transformation
consciente d'un sentiment par un créateur.
Si l'on accepte que l'art exprime une plainte, nous ne pouvons dire qu'il est une plainte, puisque la douleur de
l'artiste est toujours travaillée, réfléchie, et jamais livrée telle quelle à son public.
II.
a.
Contre la douleur de la plainte : l'art est une exhortation au bonheur
L'art : propagateur d'une conception heureuse de l'existence
Contre cette conception de l'art, qui en fait l'expression d'une douleur, nous pouvons dire que l'art est aussi une exhortation au bonheur, que les finalités de
l'art peuvent infiniment varier, et ne sont nullement limitées à la déploration et à l'expression du malheur.
En littérature française, par exemple, il existe
toute une tradition d'écrivains heureux, aux œuvres imprégnées de leur bonheur intime, tradition qui peut commencer avec Voltaire (« le dernier des
écrivains heureux » pour Barthes) continuer avec Stendhal et se poursuivre jusqu'à Giono.
Par conséquent, l'art n'est pas limité à l'expression du malheur,
mais peut également se faire le propagateur d'une conception heureuse de l'existence.
b.
L'art : moyen d'une expérience du bonheur
Mais l'art peut également être le moyen d'une expérience renouvelée du bonheur pour celui qui écrit, expérience du bonheur comme tel, et non comme
simple souvenir du bonheur passé.
Tributaires de la tradition romantique, où l'art apparaît comme l'expression d'une souffrance dans la souffrance, nous
avons tendance à oublier que la pratique de l'art, pour l'artiste, peut être synonyme de bonheur.
C'est ainsi que pour Giacomo Casanova (auteur de
Mémoires intitulées : « Histoire de ma vie ») le travail de l'écriture est concomitant d'une expérience renouvelée du bonheur.
Non seulement l'œuvre en
création est source de bonheur, mais l'effort de remémoration pour la produire est également capable de susciter la félicité.
III.
a.
Contre la passivité de la plainte : l'art est une incitation à l'action
L'art : préparation à la confrontation avec le monde
Nous l'avons dit, l'un des sèmes dominant dans le signifié « plainte » est celui de la passivité.
Loin de cette conception, nous pouvons dire que l'art est
aussi une préparation à la confrontation au monde.
Telle est l'opinion de Prévost dans la préface de Manon Lescaut.
Son “avis de l'auteur” argumente en ce
sens: “Outre le plaisir d'une lecture agréable, on y trouvera peu d'événements qui ne puissent servir à l'instruction des mœurs et c'est rendre à mon avis un
service considérable au public que de l'instruire en l'amusant”.
Ainsi, l'expérience et l'exemple guident la conduite mieux que les règles; mais l'expérience
dépendant de la fortune, il ne reste que l'exemple qui puisse servir de règle à quantité de personnes dans l'exercice de la vertu et telle est l'utilité du roman.
Par conséquent, loin de n'être qu'une longue plainte, l'art offre des modèles à l'action.
b.
L'art et l'incitation à la découverte du monde et d'autrui
Enfin, il faut bien voir que le sujet nous porte vers une conception égocentrique de l'art, qui ferait du créateur celui qui exprime ses propres douleurs sans
jamais se tourner vers le monde et autrui.
Loin de cette conception, hélas dominante aujourd'hui encore, nous pouvons distinguer un courant artistique qui
fait de l'ouverture sur le monde et les hommes qui y vivent son principal objet.
Tels sont les livres de Cendrars ou de Nicolas Bouvier (L'usage du monde)
qui loin de ne nous parler que de l'identité malheureuse d'un homme, souvent double de l'auteur, nous invitent à voyager, à découvrir les cultures des
hommes et la singularité de leurs pays.
L'art n'est donc pas nécessairement une longue plainte, cette définition n'épuise pas la totalité de son être : l'art est
aussi une incitation à devenir soi même un « étonnant voyageur » (Baudelaire).
Conclusion :
Les définitions que l'on peut donner de l'art sont aussi variées que les individus qui le pratiquent.
L'art est une longue plainte, si l'on précise qu'il l'est
métaphoriquement (la plainte artistique est plainte travaillée, non une expression directe de la douleur).
Mais l'art est aussi incitation au bonheur et
exhortation à l'action..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La politique n'est-elle qu'un art du calcul ?
- « L’art imite la nature » ARISTOTE
- Les oeuvres d'art sont ascétiques et sans pudeur... Horkheimer
- [Affinités de l'art et de la philosophie] Bergson
- L'universalité du besoin d'art chez Hegel