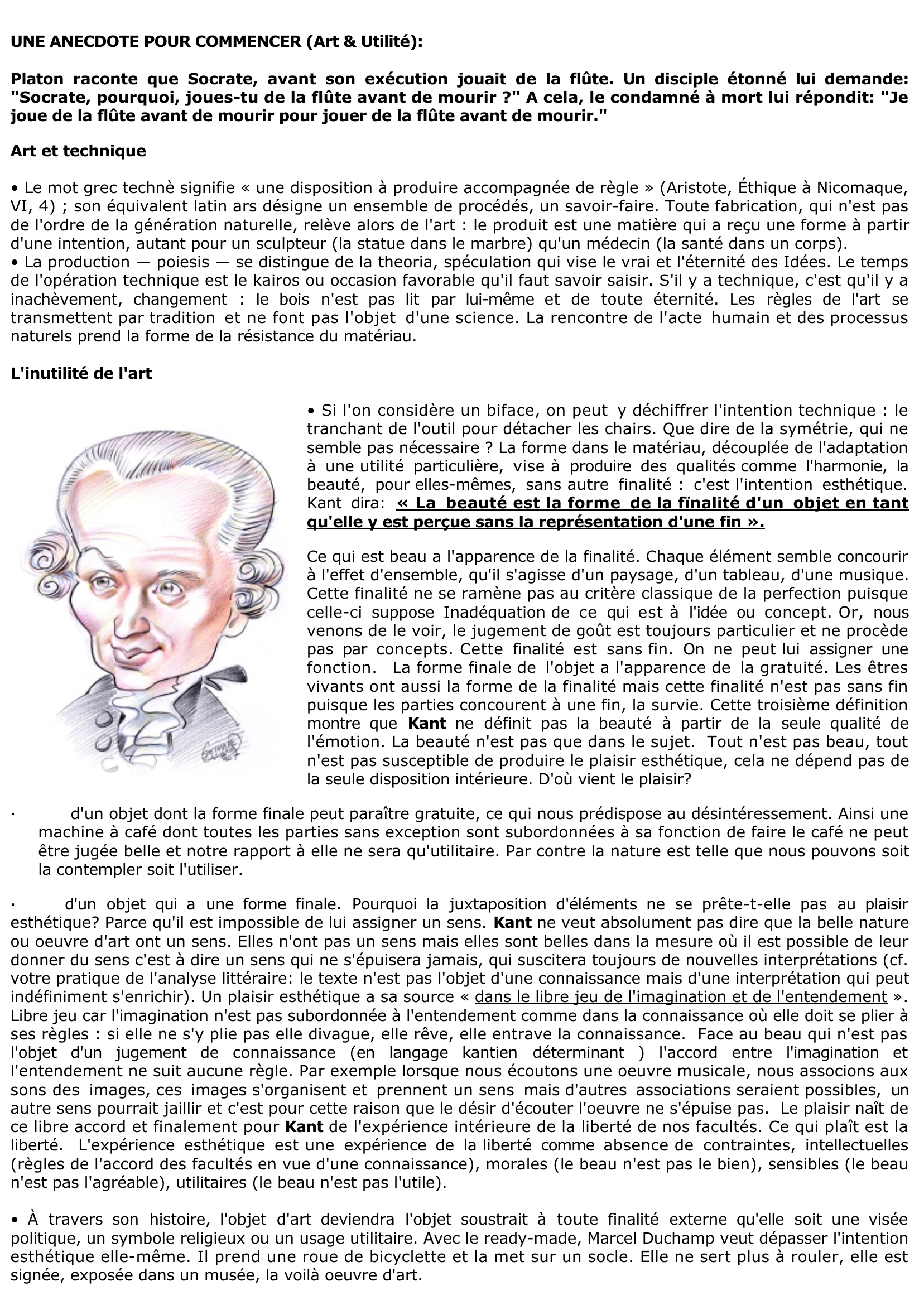L'art et L'artificiel ?
Extrait du document
«
UNE ANECDOTE POUR COMMENCER (Art & Utilité):
Platon raconte que Socrate, avant son exécution jouait de la flûte.
Un disciple étonné lui demande:
"Socrate, pourquoi, joues-tu de la flûte avant de mourir ?" A cela, le condamné à mort lui répondit: "Je
joue de la flûte avant de mourir pour jouer de la flûte avant de mourir."
Art et technique
• Le mot grec technè signifie « une disposition à produire accompagnée de règle » (Aristote, Éthique à Nicomaque,
VI, 4) ; son équivalent latin ars désigne un ensemble de procédés, un savoir-faire.
Toute fabrication, qui n'est pas
de l'ordre de la génération naturelle, relève alors de l'art : le produit est une matière qui a reçu une forme à partir
d'une intention, autant pour un sculpteur (la statue dans le marbre) qu'un médecin (la santé dans un corps).
• La production — poiesis — se distingue de la theoria, spéculation qui vise le vrai et l'éternité des Idées.
Le temps
de l'opération technique est le kairos ou occasion favorable qu'il faut savoir saisir.
S'il y a technique, c'est qu'il y a
inachèvement, changement : le bois n'est pas lit par lui-même et de toute éternité.
Les règles de l'art se
transmettent par tradition et ne font pas l'objet d'une science.
La rencontre de l'acte humain et des processus
naturels prend la forme de la résistance du matériau.
L'inutilité de l'art
• Si l'on considère un biface, on peut y déchiffrer l'intention technique : le
tranchant de l'outil pour détacher les chairs.
Que dire de la symétrie, qui ne
semble pas nécessaire ? La forme dans le matériau, découplée de l'adaptation
à une utilité particulière, vise à produire des qualités comme l'harmonie, la
beauté, pour elles-mêmes, sans autre finalité : c'est l'intention esthétique.
Kant dira: « La beauté est la forme de la fïnalité d'un objet en tant
qu'elle y est perçue sans la représentation d'une fin ».
Ce qui est beau a l'apparence de la finalité.
Chaque élément semble concourir
à l'effet d'ensemble, qu'il s'agisse d'un paysage, d'un tableau, d'une musique.
Cette finalité ne se ramène pas au critère classique de la perfection puisque
celle-ci suppose Inadéquation de ce qui est à l'idée ou concept.
Or, nous
venons de le voir, le jugement de goût est toujours particulier et ne procède
pas par concepts.
Cette finalité est sans fin.
On ne peut lui assigner une
fonction.
La forme finale de l'objet a l'apparence de la gratuité.
Les êtres
vivants ont aussi la forme de la finalité mais cette finalité n'est pas sans fin
puisque les parties concourent à une fin, la survie.
Cette troisième définition
montre que Kant ne définit pas la beauté à partir de la seule qualité de
l'émotion.
La beauté n'est pas que dans le sujet.
Tout n'est pas beau, tout
n'est pas susceptible de produire le plaisir esthétique, cela ne dépend pas de
la seule disposition intérieure.
D'où vient le plaisir?
·
d'un objet dont la forme finale peut paraître gratuite, ce qui nous prédispose au désintéressement.
Ainsi une
machine à café dont toutes les parties sans exception sont subordonnées à sa fonction de faire le café ne peut
être jugée belle et notre rapport à elle ne sera qu'utilitaire.
Par contre la nature est telle que nous pouvons soit
la contempler soit l'utiliser.
·
d'un objet qui a une forme finale.
Pourquoi la juxtaposition d'éléments ne se prête-t-elle pas au plaisir
esthétique? Parce qu'il est impossible de lui assigner un sens.
Kant ne veut absolument pas dire que la belle nature
ou oeuvre d'art ont un sens.
Elles n'ont pas un sens mais elles sont belles dans la mesure où il est possible de leur
donner du sens c'est à dire un sens qui ne s'épuisera jamais, qui suscitera toujours de nouvelles interprétations (cf.
votre pratique de l'analyse littéraire: le texte n'est pas l'objet d'une connaissance mais d'une interprétation qui peut
indéfiniment s'enrichir).
Un plaisir esthétique a sa source « dans le libre jeu de l'imagination et de l'entendement ».
Libre jeu car l'imagination n'est pas subordonnée à l'entendement comme dans la connaissance où elle doit se plier à
ses règles : si elle ne s'y plie pas elle divague, elle rêve, elle entrave la connaissance.
Face au beau qui n'est pas
l'objet d'un jugement de connaissance (en langage kantien déterminant ) l'accord entre l'imagination et
l'entendement ne suit aucune règle.
Par exemple lorsque nous écoutons une oeuvre musicale, nous associons aux
sons des images, ces images s'organisent et prennent un sens mais d'autres associations seraient possibles, un
autre sens pourrait jaillir et c'est pour cette raison que le désir d'écouter l'oeuvre ne s'épuise pas.
Le plaisir naît de
ce libre accord et finalement pour Kant de l'expérience intérieure de la liberté de nos facultés.
Ce qui plaît est la
liberté.
L'expérience esthétique est une expérience de la liberté comme absence de contraintes, intellectuelles
(règles de l'accord des facultés en vue d'une connaissance), morales (le beau n'est pas le bien), sensibles (le beau
n'est pas l'agréable), utilitaires (le beau n'est pas l'utile).
• À travers son histoire, l'objet d'art deviendra l'objet soustrait à toute finalité externe qu'elle soit une visée
politique, un symbole religieux ou un usage utilitaire.
Avec le ready-made, Marcel Duchamp veut dépasser l'intention
esthétique elle-même.
Il prend une roue de bicyclette et la met sur un socle.
Elle ne sert plus à rouler, elle est
signée, exposée dans un musée, la voilà oeuvre d'art..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La politique n'est-elle qu'un art du calcul ?
- « L’art imite la nature » ARISTOTE
- Les oeuvres d'art sont ascétiques et sans pudeur... Horkheimer
- [Affinités de l'art et de la philosophie] Bergson
- L'universalité du besoin d'art chez Hegel