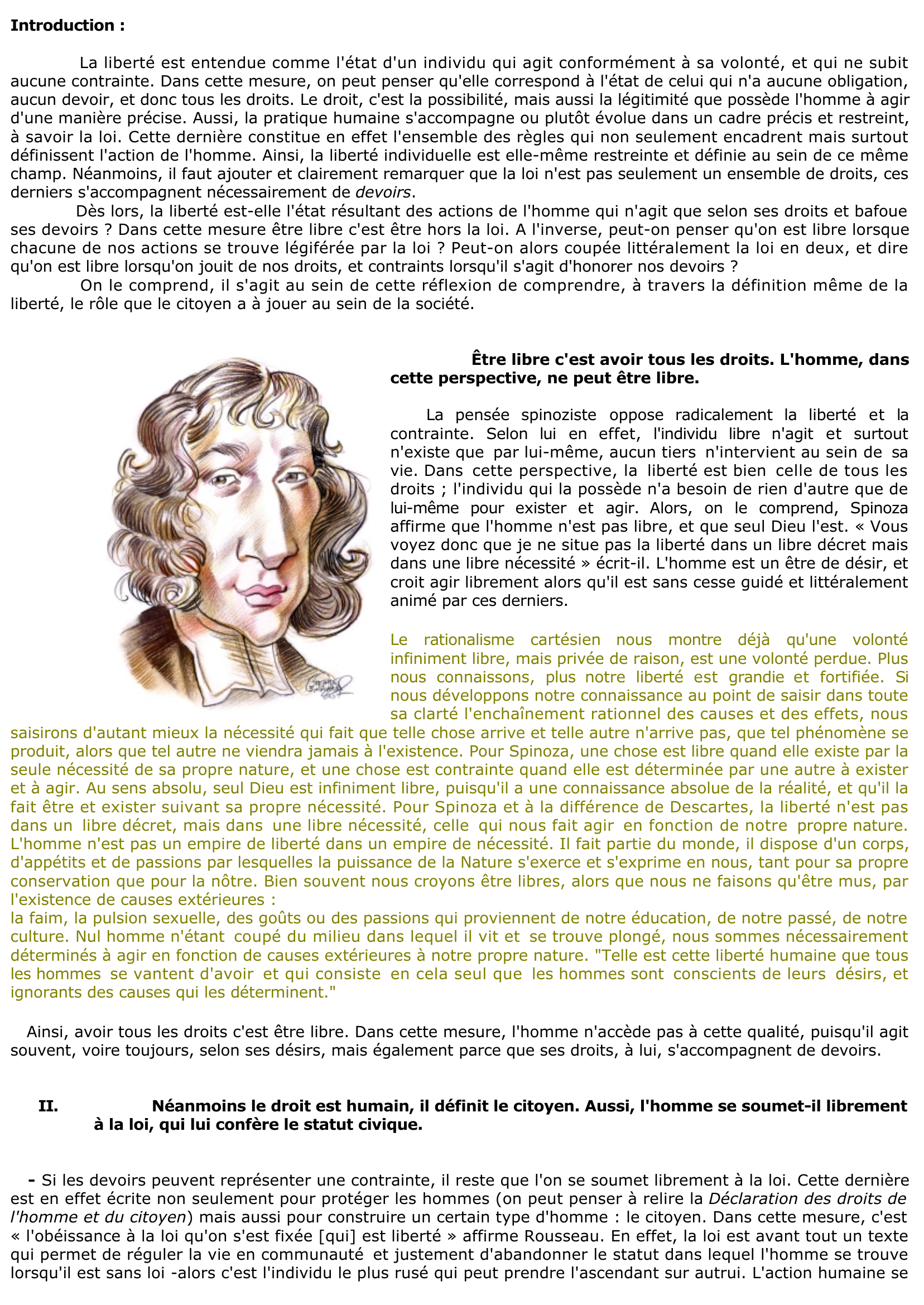La suprême liberté c'est d'avoir tous les droits. ?
Extrait du document
«
Introduction :
La liberté est entendue comme l'état d'un individu qui agit conformément à sa volonté, et qui ne subit
aucune contrainte.
Dans cette mesure, on peut penser qu'elle correspond à l'état de celui qui n'a aucune obligation,
aucun devoir, et donc tous les droits.
Le droit, c'est la possibilité, mais aussi la légitimité que possède l'homme à agir
d'une manière précise.
Aussi, la pratique humaine s'accompagne ou plutôt évolue dans un cadre précis et restreint,
à savoir la loi.
Cette dernière constitue en effet l'ensemble des règles qui non seulement encadrent mais surtout
définissent l'action de l'homme.
Ainsi, la liberté individuelle est elle-même restreinte et définie au sein de ce même
champ.
Néanmoins, il faut ajouter et clairement remarquer que la loi n'est pas seulement un ensemble de droits, ces
derniers s'accompagnent nécessairement de devoirs.
Dès lors, la liberté est-elle l'état résultant des actions de l'homme qui n'agit que selon ses droits et bafoue
ses devoirs ? Dans cette mesure être libre c'est être hors la loi.
A l'inverse, peut-on penser qu'on est libre lorsque
chacune de nos actions se trouve légiférée par la loi ? Peut-on alors coupée littéralement la loi en deux, et dire
qu'on est libre lorsqu'on jouit de nos droits, et contraints lorsqu'il s'agit d'honorer nos devoirs ?
On le comprend, il s'agit au sein de cette réflexion de comprendre, à travers la définition même de la
liberté, le rôle que le citoyen a à jouer au sein de la société.
I.
Être libre c'est avoir tous les droits.
L'homme, dans
cette perspective, ne peut être libre.
La pensée spinoziste oppose radicalement la liberté et la
contrainte.
Selon lui en effet, l'individu libre n'agit et surtout
n'existe que par lui-même, aucun tiers n'intervient au sein de sa
vie.
Dans cette perspective, la liberté est bien celle de tous les
droits ; l'individu qui la possède n'a besoin de rien d'autre que de
lui-même pour exister et agir.
Alors, on le comprend, Spinoza
affirme que l'homme n'est pas libre, et que seul Dieu l'est.
« Vous
voyez donc que je ne situe pas la liberté dans un libre décret mais
dans une libre nécessité » écrit-il.
L'homme est un être de désir, et
croit agir librement alors qu'il est sans cesse guidé et littéralement
animé par ces derniers.
Le rationalisme cartésien nous montre déjà qu'une volonté
infiniment libre, mais privée de raison, est une volonté perdue.
Plus
nous connaissons, plus notre liberté est grandie et fortifiée.
Si
nous développons notre connaissance au point de saisir dans toute
sa clarté l'enchaînement rationnel des causes et des effets, nous
saisirons d'autant mieux la nécessité qui fait que telle chose arrive et telle autre n'arrive pas, que tel phénomène se
produit, alors que tel autre ne viendra jamais à l'existence.
Pour Spinoza, une chose est libre quand elle existe par la
seule nécessité de sa propre nature, et une chose est contrainte quand elle est déterminée par une autre à exister
et à agir.
Au sens absolu, seul Dieu est infiniment libre, puisqu'il a une connaissance absolue de la réalité, et qu'il la
fait être et exister suivant sa propre nécessité.
Pour Spinoza et à la différence de Descartes, la liberté n'est pas
dans un libre décret, mais dans une libre nécessité, celle qui nous fait agir en fonction de notre propre nature.
L'homme n'est pas un empire de liberté dans un empire de nécessité.
Il fait partie du monde, il dispose d'un corps,
d'appétits et de passions par lesquelles la puissance de la Nature s'exerce et s'exprime en nous, tant pour sa propre
conservation que pour la nôtre.
Bien souvent nous croyons être libres, alors que nous ne faisons qu'être mus, par
l'existence de causes extérieures :
la faim, la pulsion sexuelle, des goûts ou des passions qui proviennent de notre éducation, de notre passé, de notre
culture.
Nul homme n'étant coupé du milieu dans lequel il vit et se trouve plongé, nous sommes nécessairement
déterminés à agir en fonction de causes extérieures à notre propre nature.
"Telle est cette liberté humaine que tous
les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs, et
ignorants des causes qui les déterminent."
Ainsi, avoir tous les droits c'est être libre.
Dans cette mesure, l'homme n'accède pas à cette qualité, puisqu'il agit
souvent, voire toujours, selon ses désirs, mais également parce que ses droits, à lui, s'accompagnent de devoirs.
II.
Néanmoins le droit est humain, il définit le citoyen.
Aussi, l'homme se soumet-il librement
à la loi, qui lui confère le statut civique.
- Si les devoirs peuvent représenter une contrainte, il reste que l'on se soumet librement à la loi.
Cette dernière
est en effet écrite non seulement pour protéger les hommes (on peut penser à relire la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen) mais aussi pour construire un certain type d'homme : le citoyen.
Dans cette mesure, c'est
« l'obéissance à la loi qu'on s'est fixée [qui] est liberté » affirme Rousseau.
En effet, la loi est avant tout un texte
qui permet de réguler la vie en communauté et justement d'abandonner le statut dans lequel l'homme se trouve
lorsqu'il est sans loi -alors c'est l'individu le plus rusé qui peut prendre l'ascendant sur autrui.
L'action humaine se.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HEGEL: «L'État, comme réalité en acte de la volonté substantielle, [...] est le rationnel en soi et pour soi [...] dans lequel la liberté obtient sa valeur suprême.»
- HEGEL: «L'État, comme réalité en acte de la volonté substantielle, [...] est le rationnel en soi et pour soi [...] dans lequel la liberté obtient sa valeur suprême.»
- La liberté se réduit-elle à une déclaration des droits de l'homme ?
- L'égalité des droits est-elle une condition de la liberté ?
- Analyse Texte 1 Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges ( 1791)