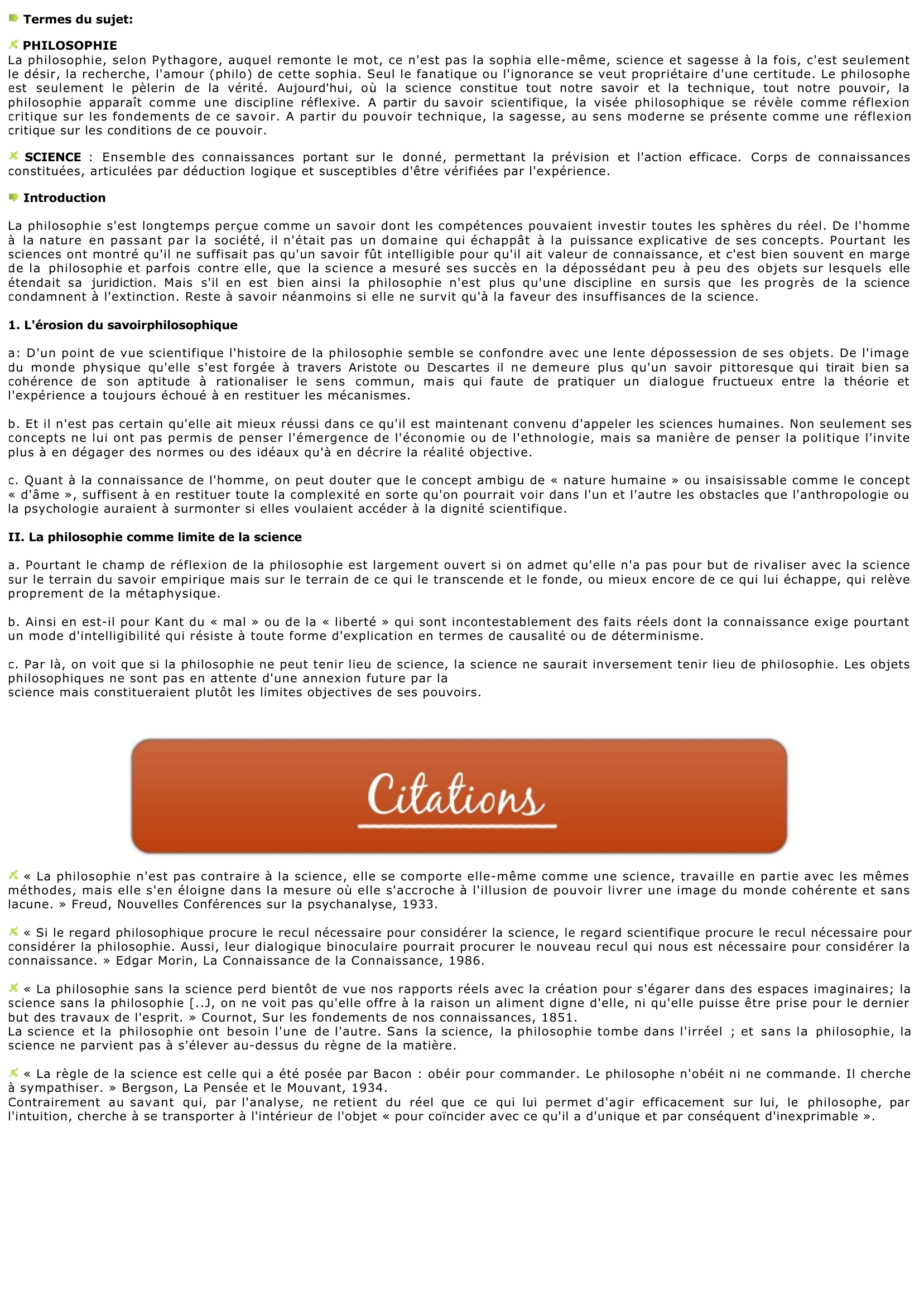La philosophie est-elle la somme des insuffisances de la science ?
Extrait du document
«
Termes du sujet:
PHILOSOPHIE
La philosophie, selon Pythagore, auquel remonte le mot, ce n'est pas la sophia elle-même, science et sagesse à la fois, c'est seulement
le désir, la recherche, l'amour (philo) de cette sophia.
Seul le fanatique ou l'ignorance se veut propriétaire d'une certitude.
Le philosophe
est seulement le pèlerin de la vérité.
Aujourd'hui, où la science constitue tout notre savoir et la technique, tout notre pouvoir, la
philosophie apparaît comme une discipline réflexive.
A partir du savoir scientifique, la visée philosophique se révèle comme réflexion
critique sur les fondements de ce savoir.
A partir du pouvoir technique, la sagesse, au sens moderne se présente comme une réflexion
critique sur les conditions de ce pouvoir.
SCIENCE : Ensemble des connaissances portant sur le donné, permettant la prévision et l'action efficace.
Corps de connaissances
constituées, articulées par déduction logique et susceptibles d'être vérifiées par l'expérience.
Introduction
La philosophie s'est longtemps perçue comme un savoir dont les compétences pouvaient investir toutes les sphères du réel.
De l'homme
à la nature en passant par la société, il n'était pas un domaine qui échappât à la puissance explicative de ses concepts.
Pourtant les
sciences ont montré qu'il ne suffisait pas qu'un savoir fût intelligible pour qu'il ait valeur de connaissance, et c'est bien souvent en marge
de la philosophie et parfois contre elle, que la science a mesuré ses succès en la dépossédant peu à peu des objets sur lesquels elle
étendait sa juridiction.
Mais s'il en est bien ainsi la philosophie n'est plus qu'une discipline en sursis que les progrès de la science
condamnent à l'extinction.
Reste à savoir néanmoins si elle ne survit qu'à la faveur des insuffisances de la science.
1.
L'érosion du savoirphilosophique
a: D'un point de vue scientifique l'histoire de la philosophie semble se confondre avec une lente dépossession de ses objets.
De l'image
du monde physique qu'elle s'est forgée à travers Aristote ou Descartes il ne demeure plus qu'un savoir pittoresque qui tirait bien sa
cohérence de son aptitude à rationaliser le sens commun, mais qui faute de pratiquer un dialogue fructueux entre la théorie et
l'expérience a toujours échoué à en restituer les mécanismes.
b.
Et il n'est pas certain qu'elle ait mieux réussi dans ce qu'il est maintenant convenu d'appeler les sciences humaines.
Non seulement ses
concepts ne lui ont pas permis de penser l'émergence de l'économie ou de l'ethnologie, mais sa manière de penser la politique l'invite
plus à en dégager des normes ou des idéaux qu'à en décrire la réalité objective.
c.
Quant à la connaissance de l'homme, on peut douter que le concept ambigu de « nature humaine » ou insaisissable comme le concept
« d'âme », suffisent à en restituer toute la complexité en sorte qu'on pourrait voir dans l'un et l'autre les obstacles que l'anthropologie ou
la psychologie auraient à surmonter si elles voulaient accéder à la dignité scientifique.
II.
La philosophie comme limite de la science
a.
Pourtant le champ de réflexion de la philosophie est largement ouvert si on admet qu'elle n'a pas pour but de rivaliser avec la science
sur le terrain du savoir empirique mais sur le terrain de ce qui le transcende et le fonde, ou mieux encore de ce qui lui échappe, qui relève
proprement de la métaphysique.
b.
Ainsi en est-il pour Kant du « mal » ou de la « liberté » qui sont incontestablement des faits réels dont la connaissance exige pourtant
un mode d'intelligibilité qui résiste à toute forme d'explication en termes de causalité ou de déterminisme.
c.
Par là, on voit que si la philosophie ne peut tenir lieu de science, la science ne saurait inversement tenir lieu de philosophie.
Les objets
philosophiques ne sont pas en attente d'une annexion future par la
science mais constitueraient plutôt les limites objectives de ses pouvoirs.
« La philosophie n'est pas contraire à la science, elle se comporte elle-même comme une science, travaille en partie avec les mêmes
méthodes, mais elle s'en éloigne dans la mesure où elle s'accroche à l'illusion de pouvoir livrer une image du monde cohérente et sans
lacune.
» Freud, Nouvelles Conférences sur la psychanalyse, 1933.
« Si le regard philosophique procure le recul nécessaire pour considérer la science, le regard scientifique procure le recul nécessaire pour
considérer la philosophie.
Aussi, leur dialogique binoculaire pourrait procurer le nouveau recul qui nous est nécessaire pour considérer la
connaissance.
» Edgar Morin, La Connaissance de la Connaissance, 1986.
« La philosophie sans la science perd bientôt de vue nos rapports réels avec la création pour s'égarer dans des espaces imaginaires; la
science sans la philosophie [..J, on ne voit pas qu'elle offre à la raison un aliment digne d'elle, ni qu'elle puisse être prise pour le dernier
but des travaux de l'esprit.
» Cournot, Sur les fondements de nos connaissances, 1851.
La science et la philosophie ont besoin l'une de l'autre.
Sans la science, la philosophie tombe dans l'irréel ; et sans la philosophie, la
science ne parvient pas à s'élever au-dessus du règne de la matière.
« La règle de la science est celle qui a été posée par Bacon : obéir pour commander.
Le philosophe n'obéit ni ne commande.
Il cherche
à sympathiser.
» Bergson, La Pensée et le Mouvant, 1934.
Contrairement au savant qui, par l'analyse, ne retient du réel que ce qui lui permet d'agir efficacement sur lui, le philosophe, par
l'intuition, cherche à se transporter à l'intérieur de l'objet « pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable »..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dissertation philosophie Bertrand Russell in Science et Religion: la conscience
- La philosophie est-elle une science?
- Bergson: La philosophie et la science
- « La méthode d'Euclide n'est qu'une brillante absurdité. Maintenant, toute grande erreur, poursuivie consciemment, méthodiquement, et qui emporte avec cela l'assentiment général - qu'elle concerne la vie ou la science - a son principe dans la philosophie
- Faut-il encore dissocier science et philosophie ?