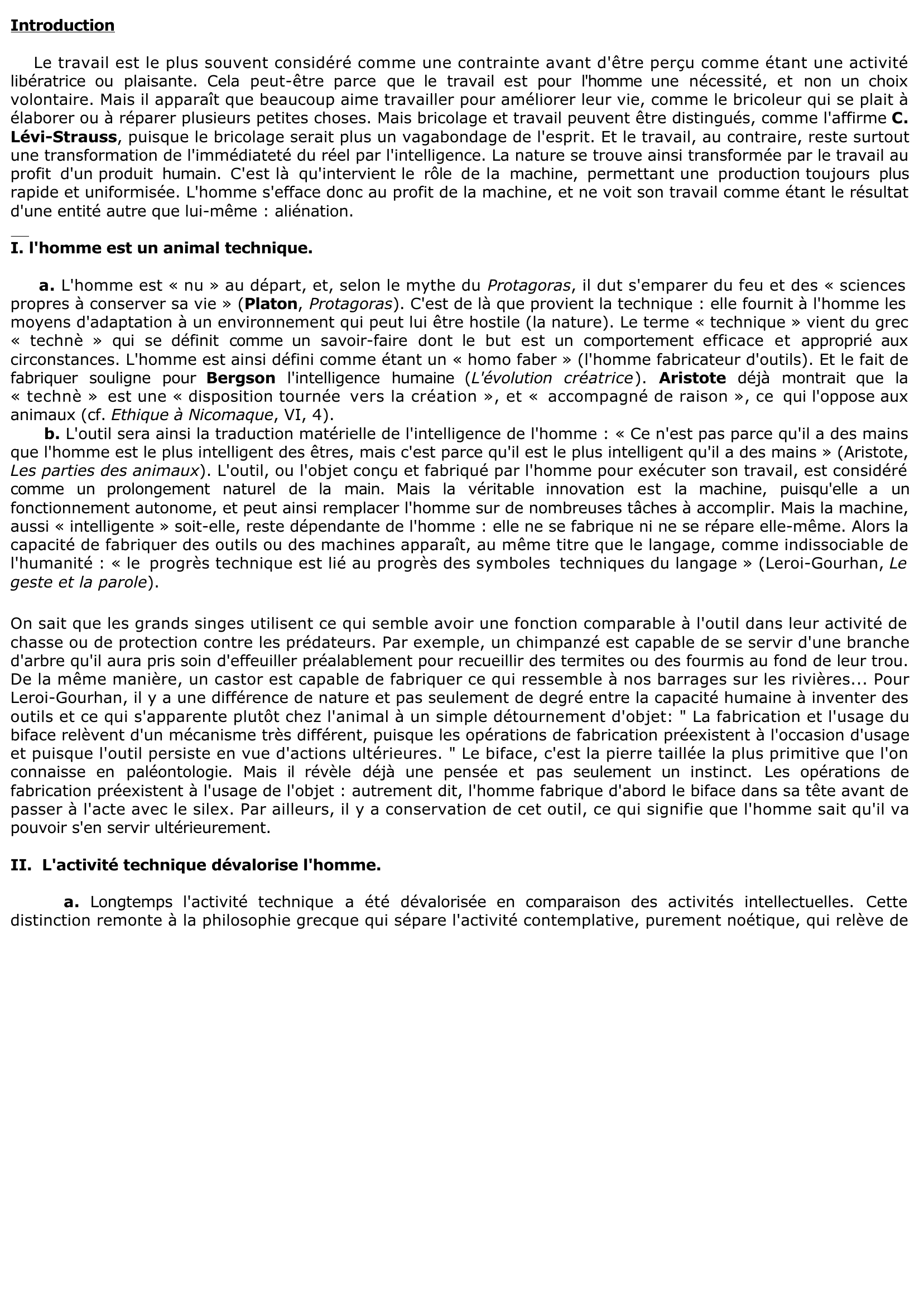La mécanisation peut-elle dénaturer le travail des hommes ?
Extrait du document
«
Introduction
Le travail est le plus souvent considéré comme une contrainte avant d'être perçu comme étant une activité
libératrice ou plaisante.
Cela peut-être parce que le travail est pour l'homme une nécessité, et non un choix
volontaire.
Mais il apparaît que beaucoup aime travailler pour améliorer leur vie, comme le bricoleur qui se plait à
élaborer ou à réparer plusieurs petites choses.
Mais bricolage et travail peuvent être distingués, comme l'affirme C.
Lévi-Strauss, puisque le bricolage serait plus un vagabondage de l'esprit.
Et le travail, au contraire, reste surtout
une transformation de l'immédiateté du réel par l'intelligence.
La nature se trouve ainsi transformée par le travail au
profit d'un produit humain.
C'est là qu'intervient le rôle de la machine, permettant une production toujours plus
rapide et uniformisée.
L'homme s'efface donc au profit de la machine, et ne voit son travail comme étant le résultat
d'une entité autre que lui-même : aliénation.
I.
l'homme est un animal technique.
a.
L'homme est « nu » au départ, et, selon le mythe du Protagoras, il dut s'emparer du feu et des « sciences
propres à conserver sa vie » (Platon, Protagoras).
C'est de là que provient la technique : elle fournit à l'homme les
moyens d'adaptation à un environnement qui peut lui être hostile (la nature).
Le terme « technique » vient du grec
« technè » qui se définit comme un savoir-faire dont le but est un comportement efficace et approprié aux
circonstances.
L'homme est ainsi défini comme étant un « homo faber » (l'homme fabricateur d'outils).
Et le fait de
fabriquer souligne pour Bergson l'intelligence humaine (L'évolution créatrice).
Aristote déjà montrait que la
« technè » est une « disposition tournée vers la création », et « accompagné de raison », ce qui l'oppose aux
animaux (cf.
Ethique à Nicomaque, VI, 4).
b.
L'outil sera ainsi la traduction matérielle de l'intelligence de l'homme : « Ce n'est pas parce qu'il a des mains
que l'homme est le plus intelligent des êtres, mais c'est parce qu'il est le plus intelligent qu'il a des mains » (Aristote,
Les parties des animaux).
L'outil, ou l'objet conçu et fabriqué par l'homme pour exécuter son travail, est considéré
comme un prolongement naturel de la main.
Mais la véritable innovation est la machine, puisqu'elle a un
fonctionnement autonome, et peut ainsi remplacer l'homme sur de nombreuses tâches à accomplir.
Mais la machine,
aussi « intelligente » soit-elle, reste dépendante de l'homme : elle ne se fabrique ni ne se répare elle-même.
Alors la
capacité de fabriquer des outils ou des machines apparaît, au même titre que le langage, comme indissociable de
l'humanité : « le progrès technique est lié au progrès des symboles techniques du langage » (Leroi-Gourhan, Le
geste et la parole).
On sait que les grands singes utilisent ce qui semble avoir une fonction comparable à l'outil dans leur activité de
chasse ou de protection contre les prédateurs.
Par exemple, un chimpanzé est capable de se servir d'une branche
d'arbre qu'il aura pris soin d'effeuiller préalablement pour recueillir des termites ou des fourmis au fond de leur trou.
De la même manière, un castor est capable de fabriquer ce qui ressemble à nos barrages sur les rivières...
Pour
Leroi-Gourhan, il y a une différence de nature et pas seulement de degré entre la capacité humaine à inventer des
outils et ce qui s'apparente plutôt chez l'animal à un simple détournement d'objet: " La fabrication et l'usage du
biface relèvent d'un mécanisme très différent, puisque les opérations de fabrication préexistent à l'occasion d'usage
et puisque l'outil persiste en vue d'actions ultérieures.
" Le biface, c'est la pierre taillée la plus primitive que l'on
connaisse en paléontologie.
Mais il révèle déjà une pensée et pas seulement un instinct.
Les opérations de
fabrication préexistent à l'usage de l'objet : autrement dit, l'homme fabrique d'abord le biface dans sa tête avant de
passer à l'acte avec le silex.
Par ailleurs, il y a conservation de cet outil, ce qui signifie que l'homme sait qu'il va
pouvoir s'en servir ultérieurement.
II.
L'activité technique dévalorise l'homme.
a.
Longtemps l'activité technique a été dévalorisée en comparaison des activités intellectuelles.
Cette
distinction remonte à la philosophie grecque qui sépare l'activité contemplative, purement noétique, qui relève de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Mill: Le travail engendre-t-il l'inégalité entre les hommes ?
- Le travail est-il un facteur d'union ou de division entre les hommes ?
- Peut-on concevoir que le travail peut séparer les hommes et aussi les unir ?
- Le travail contribue-t-il a unir les hommes ou a les diviser ?
- La division du travail sépare-t-elle les hommes ?