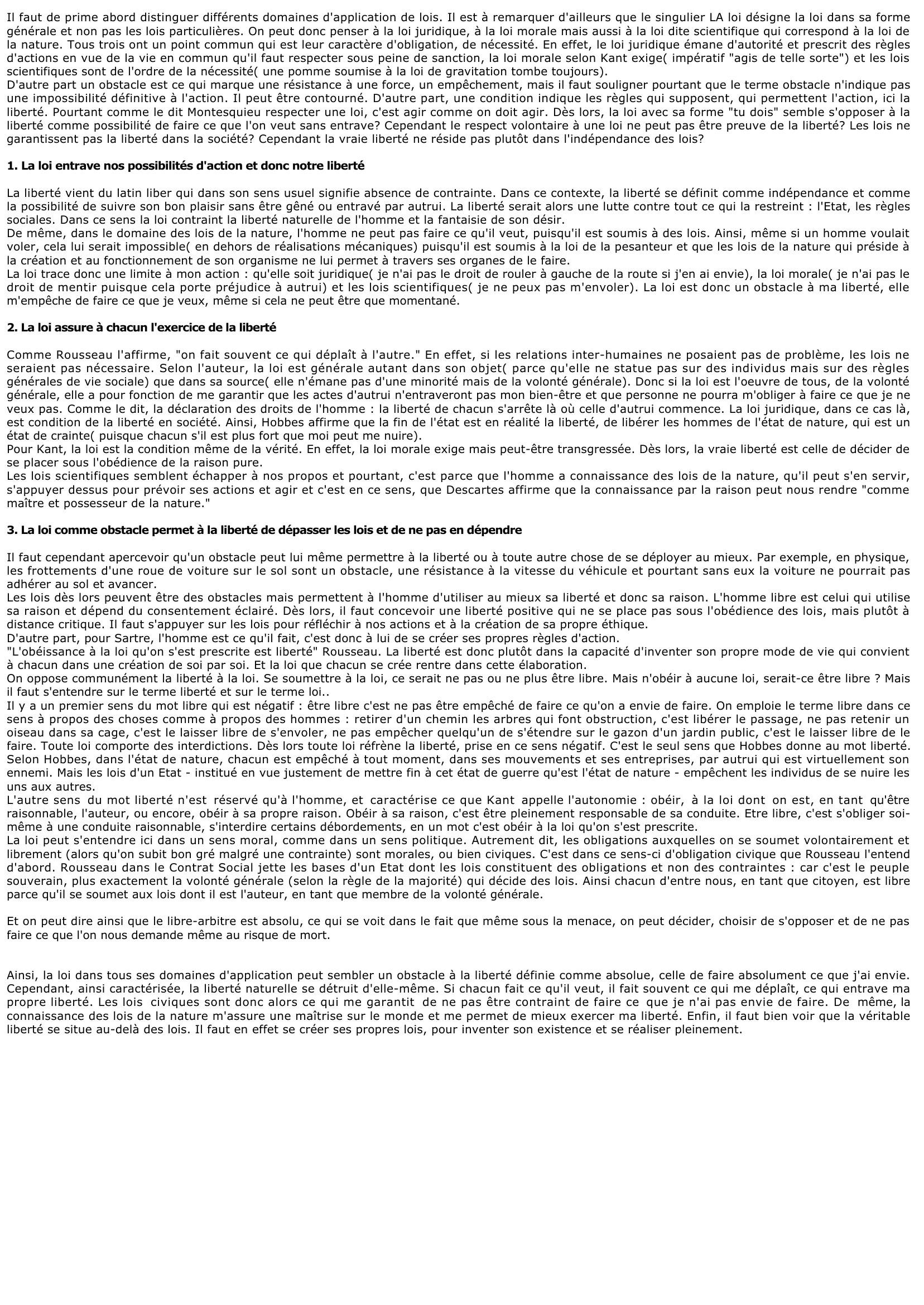La loi s'oppose-t-elle à la liberté?
Extrait du document
«
Il faut de prime abord distinguer différents domaines d'application de lois.
Il est à remarquer d'ailleurs que le singulier LA loi désigne la loi dans sa forme
générale et non pas les lois particulières.
On peut donc penser à la loi juridique, à la loi morale mais aussi à la loi dite scientifique qui correspond à la loi de
la nature.
Tous trois ont un point commun qui est leur caractère d'obligation, de nécessité.
En effet, le loi juridique émane d'autorité et prescrit des règles
d'actions en vue de la vie en commun qu'il faut respecter sous peine de sanction, la loi morale selon Kant exige( impératif "agis de telle sorte") et les lois
scientifiques sont de l'ordre de la nécessité( une pomme soumise à la loi de gravitation tombe toujours).
D'autre part un obstacle est ce qui marque une résistance à une force, un empêchement, mais il faut souligner pourtant que le terme obstacle n'indique pas
une impossibilité définitive à l'action.
Il peut être contourné.
D'autre part, une condition indique les règles qui supposent, qui permettent l'action, ici la
liberté.
Pourtant comme le dit Montesquieu respecter une loi, c'est agir comme on doit agir.
Dès lors, la loi avec sa forme "tu dois" semble s'opposer à la
liberté comme possibilité de faire ce que l'on veut sans entrave? Cependant le respect volontaire à une loi ne peut pas être preuve de la liberté? Les lois ne
garantissent pas la liberté dans la société? Cependant la vraie liberté ne réside pas plutôt dans l'indépendance des lois?
1.
La loi entrave nos possibilités d'action et donc notre liberté
La liberté vient du latin liber qui dans son sens usuel signifie absence de contrainte.
Dans ce contexte, la liberté se définit comme indépendance et comme
la possibilité de suivre son bon plaisir sans être gêné ou entravé par autrui.
La liberté serait alors une lutte contre tout ce qui la restreint : l'Etat, les règles
sociales.
Dans ce sens la loi contraint la liberté naturelle de l'homme et la fantaisie de son désir.
De même, dans le domaine des lois de la nature, l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut, puisqu'il est soumis à des lois.
Ainsi, même si un homme voulait
voler, cela lui serait impossible( en dehors de réalisations mécaniques) puisqu'il est soumis à la loi de la pesanteur et que les lois de la nature qui préside à
la création et au fonctionnement de son organisme ne lui permet à travers ses organes de le faire.
La loi trace donc une limite à mon action : qu'elle soit juridique( je n'ai pas le droit de rouler à gauche de la route si j'en ai envie), la loi morale( je n'ai pas le
droit de mentir puisque cela porte préjudice à autrui) et les lois scientifiques( je ne peux pas m'envoler).
La loi est donc un obstacle à ma liberté, elle
m'empêche de faire ce que je veux, même si cela ne peut être que momentané.
2.
La loi assure à chacun l'exercice de la liberté
Comme Rousseau l'affirme, "on fait souvent ce qui déplaît à l'autre." En effet, si les relations inter-humaines ne posaient pas de problème, les lois ne
seraient pas nécessaire.
Selon l'auteur, la loi est générale autant dans son objet( parce qu'elle ne statue pas sur des individus mais sur des règles
générales de vie sociale) que dans sa source( elle n'émane pas d'une minorité mais de la volonté générale).
Donc si la loi est l'oeuvre de tous, de la volonté
générale, elle a pour fonction de me garantir que les actes d'autrui n'entraveront pas mon bien-être et que personne ne pourra m'obliger à faire ce que je ne
veux pas.
Comme le dit, la déclaration des droits de l'homme : la liberté de chacun s'arrête là où celle d'autrui commence.
La loi juridique, dans ce cas là,
est condition de la liberté en société.
Ainsi, Hobbes affirme que la fin de l'état est en réalité la liberté, de libérer les hommes de l'état de nature, qui est un
état de crainte( puisque chacun s'il est plus fort que moi peut me nuire).
Pour Kant, la loi est la condition même de la vérité.
En effet, la loi morale exige mais peut-être transgressée.
Dès lors, la vraie liberté est celle de décider de
se placer sous l'obédience de la raison pure.
Les lois scientifiques semblent échapper à nos propos et pourtant, c'est parce que l'homme a connaissance des lois de la nature, qu'il peut s'en servir,
s'appuyer dessus pour prévoir ses actions et agir et c'est en ce sens, que Descartes affirme que la connaissance par la raison peut nous rendre "comme
maître et possesseur de la nature."
3.
La loi comme obstacle permet à la liberté de dépasser les lois et de ne pas en dépendre
Il faut cependant apercevoir qu'un obstacle peut lui même permettre à la liberté ou à toute autre chose de se déployer au mieux.
Par exemple, en physique,
les frottements d'une roue de voiture sur le sol sont un obstacle, une résistance à la vitesse du véhicule et pourtant sans eux la voiture ne pourrait pas
adhérer au sol et avancer.
Les lois dès lors peuvent être des obstacles mais permettent à l'homme d'utiliser au mieux sa liberté et donc sa raison.
L'homme libre est celui qui utilise
sa raison et dépend du consentement éclairé.
Dès lors, il faut concevoir une liberté positive qui ne se place pas sous l'obédience des lois, mais plutôt à
distance critique.
Il faut s'appuyer sur les lois pour réfléchir à nos actions et à la création de sa propre éthique.
D'autre part, pour Sartre, l'homme est ce qu'il fait, c'est donc à lui de se créer ses propres règles d'action.
"L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté" Rousseau.
La liberté est donc plutôt dans la capacité d'inventer son propre mode de vie qui convient
à chacun dans une création de soi par soi.
Et la loi que chacun se crée rentre dans cette élaboration.
On oppose communément la liberté à la loi.
Se soumettre à la loi, ce serait ne pas ou ne plus être libre.
Mais n'obéir à aucune loi, serait-ce être libre ? Mais
il faut s'entendre sur le terme liberté et sur le terme loi..
Il y a un premier sens du mot libre qui est négatif : être libre c'est ne pas être empêché de faire ce qu'on a envie de faire.
On emploie le terme libre dans ce
sens à propos des choses comme à propos des hommes : retirer d'un chemin les arbres qui font obstruction, c'est libérer le passage, ne pas retenir un
oiseau dans sa cage, c'est le laisser libre de s'envoler, ne pas empêcher quelqu'un de s'étendre sur le gazon d'un jardin public, c'est le laisser libre de le
faire.
Toute loi comporte des interdictions.
Dès lors toute loi réfrène la liberté, prise en ce sens négatif.
C'est le seul sens que Hobbes donne au mot liberté.
Selon Hobbes, dans l'état de nature, chacun est empêché à tout moment, dans ses mouvements et ses entreprises, par autrui qui est virtuellement son
ennemi.
Mais les lois d'un Etat - institué en vue justement de mettre fin à cet état de guerre qu'est l'état de nature - empêchent les individus de se nuire les
uns aux autres.
L'autre sens du mot liberté n'est réservé qu'à l'homme, et caractérise ce que Kant appelle l'autonomie : obéir, à la loi dont on est, en tant qu'être
raisonnable, l'auteur, ou encore, obéir à sa propre raison.
Obéir à sa raison, c'est être pleinement responsable de sa conduite.
Etre libre, c'est s'obliger soimême à une conduite raisonnable, s'interdire certains débordements, en un mot c'est obéir à la loi qu'on s'est prescrite.
La loi peut s'entendre ici dans un sens moral, comme dans un sens politique.
Autrement dit, les obligations auxquelles on se soumet volontairement et
librement (alors qu'on subit bon gré malgré une contrainte) sont morales, ou bien civiques.
C'est dans ce sens-ci d'obligation civique que Rousseau l'entend
d'abord.
Rousseau dans le Contrat Social jette les bases d'un Etat dont les lois constituent des obligations et non des contraintes : car c'est le peuple
souverain, plus exactement la volonté générale (selon la règle de la majorité) qui décide des lois.
Ainsi chacun d'entre nous, en tant que citoyen, est libre
parce qu'il se soumet aux lois dont il est l'auteur, en tant que membre de la volonté générale.
Et on peut dire ainsi que le libre-arbitre est absolu, ce qui se voit dans le fait que même sous la menace, on peut décider, choisir de s'opposer et de ne pas
faire ce que l'on nous demande même au risque de mort.
Ainsi, la loi dans tous ses domaines d'application peut sembler un obstacle à la liberté définie comme absolue, celle de faire absolument ce que j'ai envie.
Cependant, ainsi caractérisée, la liberté naturelle se détruit d'elle-même.
Si chacun fait ce qu'il veut, il fait souvent ce qui me déplaît, ce qui entrave ma
propre liberté.
Les lois civiques sont donc alors ce qui me garantit de ne pas être contraint de faire ce que je n'ai pas envie de faire.
De même, la
connaissance des lois de la nature m'assure une maîtrise sur le monde et me permet de mieux exercer ma liberté.
Enfin, il faut bien voir que la véritable
liberté se situe au-delà des lois.
Il faut en effet se créer ses propres lois, pour inventer son existence et se réaliser pleinement..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La liberté s'oppose-t-elle nécessairement à la loi ?
- La liberté peut-elle être sans loi ?
- La loi limite-t-elle la liberté ou lui donne-t-elle les moyens de se réaliser ?
- KANT: «Le droit est l'ensemble conceptuel des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être concilié avec l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de la liberté.»
- La loi est-elle un obstacle à la liberté ?