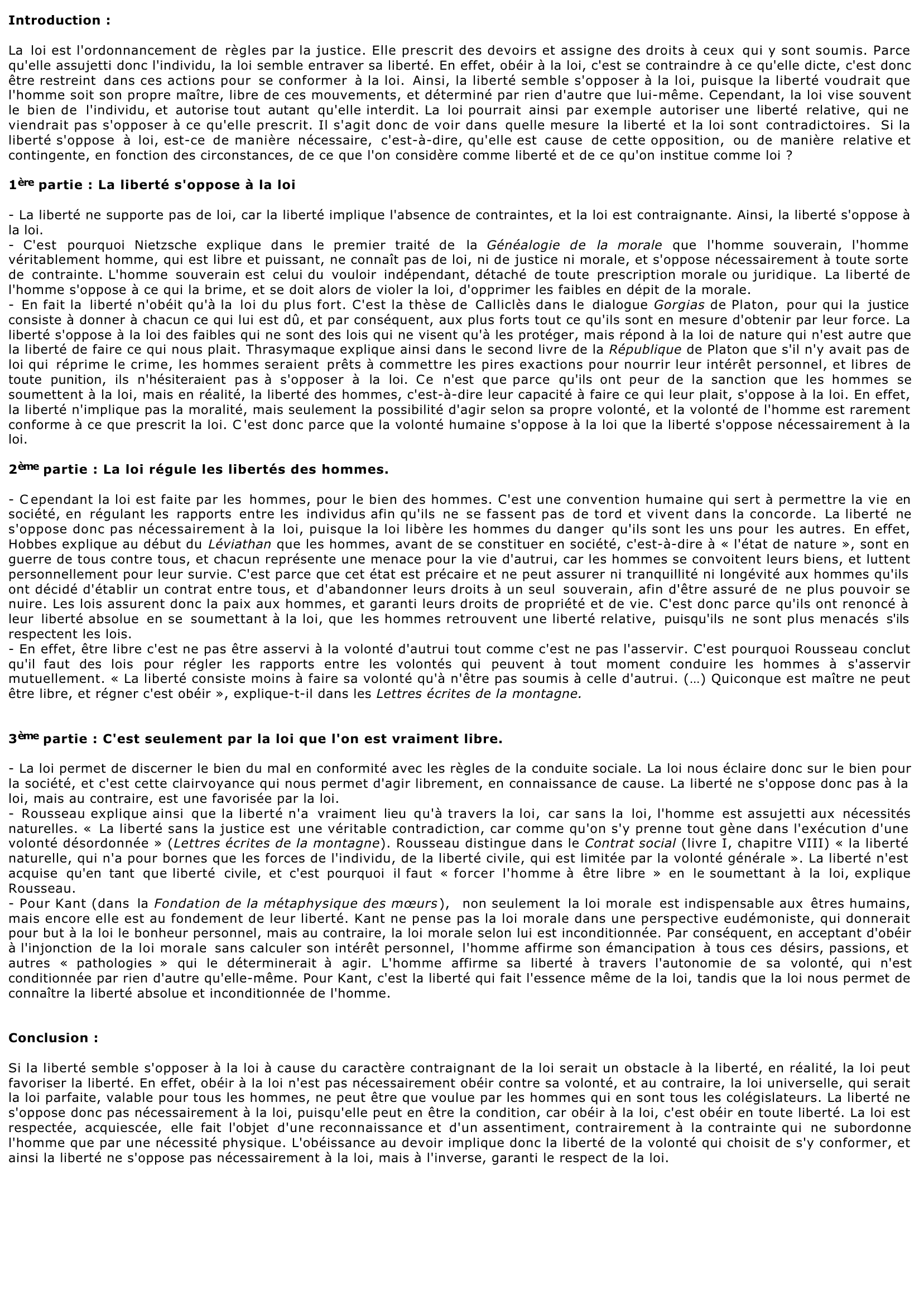La liberté s'oppose-t-elle nécessairement à la loi ?
Extrait du document
«
Introduction :
La loi est l'ordonnancement de règles par la justice.
Elle prescrit des devoirs et assigne des droits à ceux qui y sont soumis.
Parce
qu'elle assujetti donc l'individu, la loi semble entraver sa liberté.
En effet, obéir à la loi, c'est se contraindre à ce qu'elle dicte, c'est donc
être restreint dans ces actions pour se conformer à la loi.
Ainsi, la liberté semble s'opposer à la loi, puisque la liberté voudrait que
l'homme soit son propre maître, libre de ces mouvements, et déterminé par rien d'autre que lui-même.
Cependant, la loi vise souvent
le bien de l'individu, et autorise tout autant qu'elle interdit.
La loi pourrait ainsi par exemple autoriser une liberté relative, qui ne
viendrait pas s'opposer à ce qu'elle prescrit.
Il s'agit donc de voir dans quelle mesure la liberté et la loi sont contradictoires.
Si la
liberté s'oppose à loi, est-ce de manière nécessaire, c'est-à-dire, qu'elle est cause de cette opposition, ou de manière relative et
contingente, en fonction des circonstances, de ce que l'on considère comme liberté et de ce qu'on institue comme loi ?
1 ère partie : La liberté s'oppose à la loi
- La liberté ne supporte pas de loi, car la liberté implique l'absence de contraintes, et la loi est contraignante.
Ainsi, la liberté s'oppose à
la loi.
- C'est pourquoi Nietzsche explique dans le premier traité de la Généalogie de la morale que l'homme souverain, l'homme
véritablement homme, qui est libre et puissant, ne connaît pas de loi, ni de justice ni morale, et s'oppose nécessairement à toute sorte
de contrainte.
L'homme souverain est celui du vouloir indépendant, détaché de toute prescription morale ou juridique.
La liberté de
l'homme s'oppose à ce qui la brime, et se doit alors de violer la loi, d'opprimer les faibles en dépit de la morale.
- En fait la liberté n'obéit qu'à la loi du plus fort.
C'est la thèse de Calliclès dans le dialogue Gorgias de Platon, pour qui la justice
consiste à donner à chacun ce qui lui est dû, et par conséquent, aux plus forts tout ce qu'ils sont en mesure d'obtenir par leur force.
La
liberté s'oppose à la loi des faibles qui ne sont des lois qui ne visent qu'à les protéger, mais répond à la loi de nature qui n'est autre que
la liberté de faire ce qui nous plait.
Thrasymaque explique ainsi dans le second livre de la République de Platon que s'il n'y avait pas de
loi qui réprime le crime, les hommes seraient prêts à commettre les pires exactions pour nourrir leur intérêt personnel, et libres de
toute punition, ils n'hésiteraient pas à s'opposer à la loi.
C e n'est que parce qu'ils ont peur de la sanction que les hommes se
soumettent à la loi, mais en réalité, la liberté des hommes, c'est-à-dire leur capacité à faire ce qui leur plait, s'oppose à la loi.
En effet,
la liberté n'implique pas la moralité, mais seulement la possibilité d'agir selon sa propre volonté, et la volonté de l'homme est rarement
conforme à ce que prescrit la loi.
C 'est donc parce que la volonté humaine s'oppose à la loi que la liberté s'oppose nécessairement à la
loi.
2 ème partie : La loi régule les libertés des hommes.
- C ependant la loi est faite par les hommes, pour le bien des hommes.
C'est une convention humaine qui sert à permettre la vie en
société, en régulant les rapports entre les individus afin qu'ils ne se fassent pas de tord et vivent dans la concorde.
La liberté ne
s'oppose donc pas nécessairement à la loi, puisque la loi libère les hommes du danger qu'ils sont les uns pour les autres.
En effet,
Hobbes explique au début du Léviathan que les hommes, avant de se constituer en société, c'est-à-dire à « l'état de nature », sont en
guerre de tous contre tous, et chacun représente une menace pour la vie d'autrui, car les hommes se convoitent leurs biens, et luttent
personnellement pour leur survie.
C'est parce que cet état est précaire et ne peut assurer ni tranquillité ni longévité aux hommes qu'ils
ont décidé d'établir un contrat entre tous, et d'abandonner leurs droits à un seul souverain, afin d'être assuré de ne plus pouvoir se
nuire.
Les lois assurent donc la paix aux hommes, et garanti leurs droits de propriété et de vie.
C'est donc parce qu'ils ont renoncé à
leur liberté absolue en se soumettant à la loi, que les hommes retrouvent une liberté relative, puisqu'ils ne sont plus menacés s'ils
respectent les lois.
- En effet, être libre c'est ne pas être asservi à la volonté d'autrui tout comme c'est ne pas l'asservir.
C'est pourquoi Rousseau conclut
qu'il faut des lois pour régler les rapports entre les volontés qui peuvent à tout moment conduire les hommes à s'asservir
mutuellement.
« La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui.
(…) Quiconque est maître ne peut
être libre, et régner c'est obéir », explique-t-il dans les Lettres écrites de la montagne.
3 ème partie : C'est seulement par la loi que l'on est vraiment libre.
- La loi permet de discerner le bien du mal en conformité avec les règles de la conduite sociale.
La loi nous éclaire donc sur le bien pour
la société, et c'est cette clairvoyance qui nous permet d'agir librement, en connaissance de cause.
La liberté ne s'oppose donc pas à la
loi, mais au contraire, est une favorisée par la loi.
- Rousseau explique ainsi que la liberté n'a vraiment lieu qu'à travers la loi, car sans la loi, l'homme est assujetti aux nécessités
naturelles.
« La liberté sans la justice est une véritable contradiction, car comme qu'on s'y prenne tout gène dans l'exécution d'une
volonté désordonnée » (Lettres écrites de la montagne).
Rousseau distingue dans le Contrat social (livre I, chapitre VIII) « la liberté
naturelle, qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile, qui est limitée par la volonté générale ».
La liberté n'est
acquise qu'en tant que liberté civile, et c'est pourquoi il faut « forcer l'homme à être libre » en le soumettant à la loi, explique
Rousseau.
- Pour Kant (dans la Fondation de la métaphysique des mœurs ), non seulement la loi morale est indispensable aux êtres humains,
mais encore elle est au fondement de leur liberté.
Kant ne pense pas la loi morale dans une perspective eudémoniste, qui donnerait
pour but à la loi le bonheur personnel, mais au contraire, la loi morale selon lui est inconditionnée.
Par conséquent, en acceptant d'obéir
à l'injonction de la loi morale sans calculer son intérêt personnel, l'homme affirme son émancipation à tous ces désirs, passions, et
autres « pathologies » qui le déterminerait à agir.
L'homme affirme sa liberté à travers l'autonomie de sa volonté, qui n'est
conditionnée par rien d'autre qu'elle-même.
Pour Kant, c'est la liberté qui fait l'essence même de la loi, tandis que la loi nous permet de
connaître la liberté absolue et inconditionnée de l'homme.
Conclusion :
Si la liberté semble s'opposer à la loi à cause du caractère contraignant de la loi serait un obstacle à la liberté, en réalité, la loi peut
favoriser la liberté.
En effet, obéir à la loi n'est pas nécessairement obéir contre sa volonté, et au contraire, la loi universelle, qui serait
la loi parfaite, valable pour tous les hommes, ne peut être que voulue par les hommes qui en sont tous les colégislateurs.
La liberté ne
s'oppose donc pas nécessairement à la loi, puisqu'elle peut en être la condition, car obéir à la loi, c'est obéir en toute liberté.
La loi est
respectée, acquiescée, elle fait l'objet d'une reconnaissance et d'un assentiment, contrairement à la contrainte qui ne subordonne
l'homme que par une nécessité physique.
L'obéissance au devoir implique donc la liberté de la volonté qui choisit de s'y conformer, et
ainsi la liberté ne s'oppose pas nécessairement à la loi, mais à l'inverse, garanti le respect de la loi..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La loi s'oppose-t-elle à la liberté?
- La culture s'oppose-t-elle nécessairement à la nature ?
- La liberté peut-elle être sans loi ?
- La loi limite-t-elle la liberté ou lui donne-t-elle les moyens de se réaliser ?
- KANT: «Le droit est l'ensemble conceptuel des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être concilié avec l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de la liberté.»