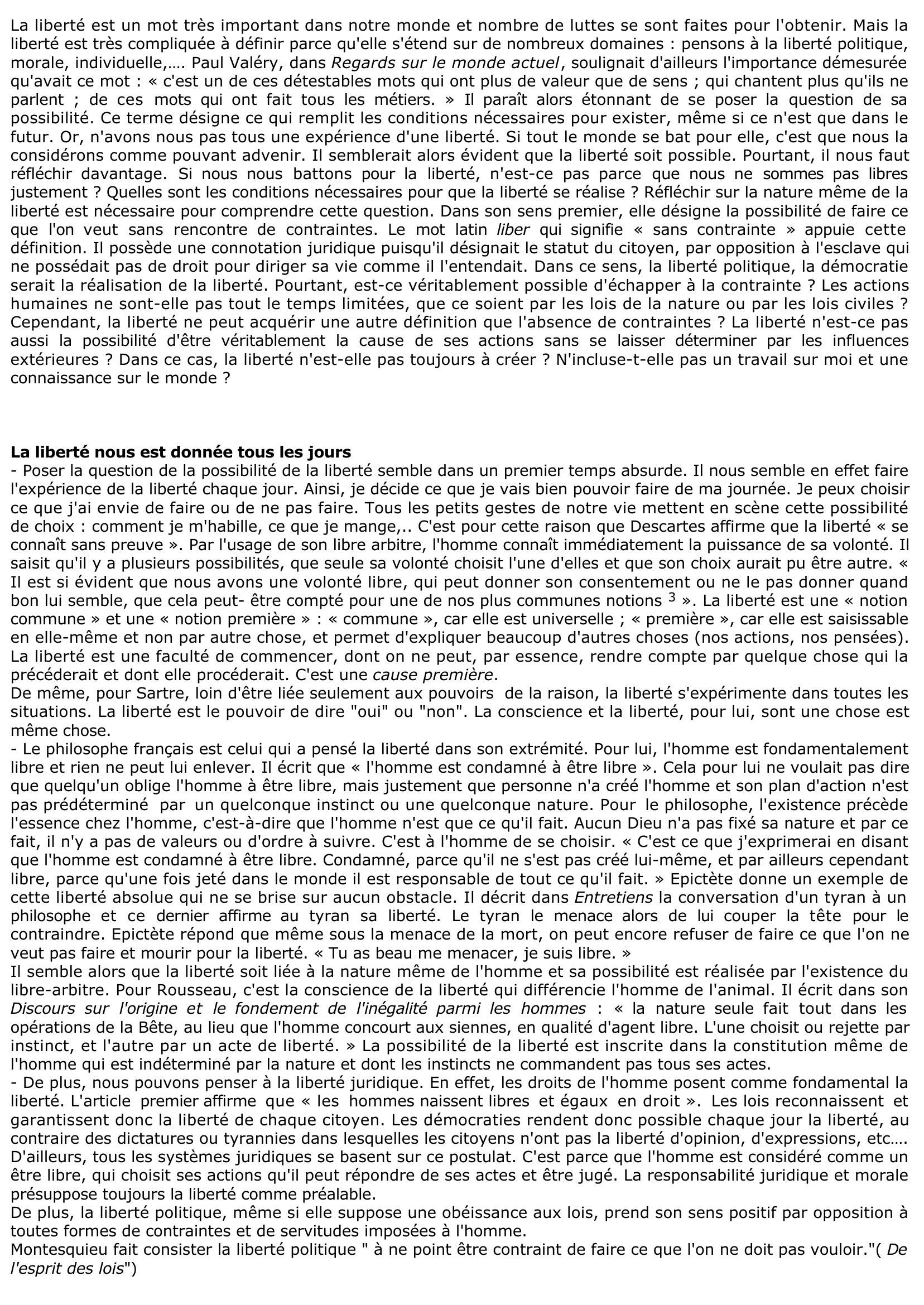La liberté est-elle possible ?
Extrait du document
«
La liberté est un mot très important dans notre monde et nombre de luttes se sont faites pour l'obtenir.
Mais la
liberté est très compliquée à définir parce qu'elle s'étend sur de nombreux domaines : pensons à la liberté politique,
morale, individuelle,….
Paul Valéry, dans Regards sur le monde actuel, soulignait d'ailleurs l'importance démesurée
qu'avait ce mot : « c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens ; qui chantent plus qu'ils ne
parlent ; de ces mots qui ont fait tous les métiers.
» Il paraît alors étonnant de se poser la question de sa
possibilité.
Ce terme désigne ce qui remplit les conditions nécessaires pour exister, même si ce n'est que dans le
futur.
Or, n'avons nous pas tous une expérience d'une liberté.
Si tout le monde se bat pour elle, c'est que nous la
considérons comme pouvant advenir.
Il semblerait alors évident que la liberté soit possible.
Pourtant, il nous faut
réfléchir davantage.
Si nous nous battons pour la liberté, n'est-ce pas parce que nous ne sommes pas libres
justement ? Quelles sont les conditions nécessaires pour que la liberté se réalise ? Réfléchir sur la nature même de la
liberté est nécessaire pour comprendre cette question.
Dans son sens premier, elle désigne la possibilité de faire ce
que l'on veut sans rencontre de contraintes.
Le mot latin liber qui signifie « sans contrainte » appuie cette
définition.
Il possède une connotation juridique puisqu'il désignait le statut du citoyen, par opposition à l'esclave qui
ne possédait pas de droit pour diriger sa vie comme il l'entendait.
Dans ce sens, la liberté politique, la démocratie
serait la réalisation de la liberté.
Pourtant, est-ce véritablement possible d'échapper à la contrainte ? Les actions
humaines ne sont-elle pas tout le temps limitées, que ce soient par les lois de la nature ou par les lois civiles ?
Cependant, la liberté ne peut acquérir une autre définition que l'absence de contraintes ? La liberté n'est-ce pas
aussi la possibilité d'être véritablement la cause de ses actions sans se laisser déterminer par les influences
extérieures ? Dans ce cas, la liberté n'est-elle pas toujours à créer ? N'incluse-t-elle pas un travail sur moi et une
connaissance sur le monde ?
La liberté nous est donnée tous les jours
- Poser la question de la possibilité de la liberté semble dans un premier temps absurde.
Il nous semble en effet faire
l'expérience de la liberté chaque jour.
Ainsi, je décide ce que je vais bien pouvoir faire de ma journée.
Je peux choisir
ce que j'ai envie de faire ou de ne pas faire.
Tous les petits gestes de notre vie mettent en scène cette possibilité
de choix : comment je m'habille, ce que je mange,..
C'est pour cette raison que Descartes affirme que la liberté « se
connaît sans preuve ».
Par l'usage de son libre arbitre, l'homme connaît immédiatement la puissance de sa volonté.
Il
saisit qu'il y a plusieurs possibilités, que seule sa volonté choisit l'une d'elles et que son choix aurait pu être autre.
«
Il est si évident que nous avons une volonté libre, qui peut donner son consentement ou ne le pas donner quand
bon lui semble, que cela peut- être compté pour une de nos plus communes notions 3 ».
La liberté est une « notion
commune » et une « notion première » : « commune », car elle est universelle ; « première », car elle est saisissable
en elle-même et non par autre chose, et permet d'expliquer beaucoup d'autres choses (nos actions, nos pensées).
La liberté est une faculté de commencer, dont on ne peut, par essence, rendre compte par quelque chose qui la
précéderait et dont elle procéderait.
C'est une cause première.
De même, pour Sartre, loin d'être liée seulement aux pouvoirs de la raison, la liberté s'expérimente dans toutes les
situations.
La liberté est le pouvoir de dire "oui" ou "non".
La conscience et la liberté, pour lui, sont une chose est
même chose.
- Le philosophe français est celui qui a pensé la liberté dans son extrémité.
Pour lui, l'homme est fondamentalement
libre et rien ne peut lui enlever.
Il écrit que « l'homme est condamné à être libre ».
Cela pour lui ne voulait pas dire
que quelqu'un oblige l'homme à être libre, mais justement que personne n'a créé l'homme et son plan d'action n'est
pas prédéterminé par un quelconque instinct ou une quelconque nature.
Pour le philosophe, l'existence précède
l'essence chez l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'est que ce qu'il fait.
Aucun Dieu n'a pas fixé sa nature et par ce
fait, il n'y a pas de valeurs ou d'ordre à suivre.
C'est à l'homme de se choisir.
« C'est ce que j'exprimerai en disant
que l'homme est condamné à être libre.
Condamné, parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant
libre, parce qu'une fois jeté dans le monde il est responsable de tout ce qu'il fait.
» Epictète donne un exemple de
cette liberté absolue qui ne se brise sur aucun obstacle.
Il décrit dans Entretiens la conversation d'un tyran à un
philosophe et ce dernier affirme au tyran sa liberté.
Le tyran le menace alors de lui couper la tête pour le
contraindre.
Epictète répond que même sous la menace de la mort, on peut encore refuser de faire ce que l'on ne
veut pas faire et mourir pour la liberté.
« Tu as beau me menacer, je suis libre.
»
Il semble alors que la liberté soit liée à la nature même de l'homme et sa possibilité est réalisée par l'existence du
libre-arbitre.
Pour Rousseau, c'est la conscience de la liberté qui différencie l'homme de l'animal.
Il écrit dans son
Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes : « la nature seule fait tout dans les
opérations de la Bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes, en qualité d'agent libre.
L'une choisit ou rejette par
instinct, et l'autre par un acte de liberté.
» La possibilité de la liberté est inscrite dans la constitution même de
l'homme qui est indéterminé par la nature et dont les instincts ne commandent pas tous ses actes.
- De plus, nous pouvons penser à la liberté juridique.
En effet, les droits de l'homme posent comme fondamental la
liberté.
L'article premier affirme que « les hommes naissent libres et égaux en droit ».
Les lois reconnaissent et
garantissent donc la liberté de chaque citoyen.
Les démocraties rendent donc possible chaque jour la liberté, au
contraire des dictatures ou tyrannies dans lesquelles les citoyens n'ont pas la liberté d'opinion, d'expressions, etc….
D'ailleurs, tous les systèmes juridiques se basent sur ce postulat.
C'est parce que l'homme est considéré comme un
être libre, qui choisit ses actions qu'il peut répondre de ses actes et être jugé.
La responsabilité juridique et morale
présuppose toujours la liberté comme préalable.
De plus, la liberté politique, même si elle suppose une obéissance aux lois, prend son sens positif par opposition à
toutes formes de contraintes et de servitudes imposées à l'homme.
Montesquieu fait consister la liberté politique " à ne point être contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir."( De
l'esprit des lois").
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Liberté de manchot - Augustin
- « La liberté consiste à faire ce que chacun désire» Mill
- L’Arabie Saoudite et la liberté d’expression: peut-on parler de liberté?
- Bergson étude de texte: liberté et invention
- La liberté peut-elle être sans loi ?