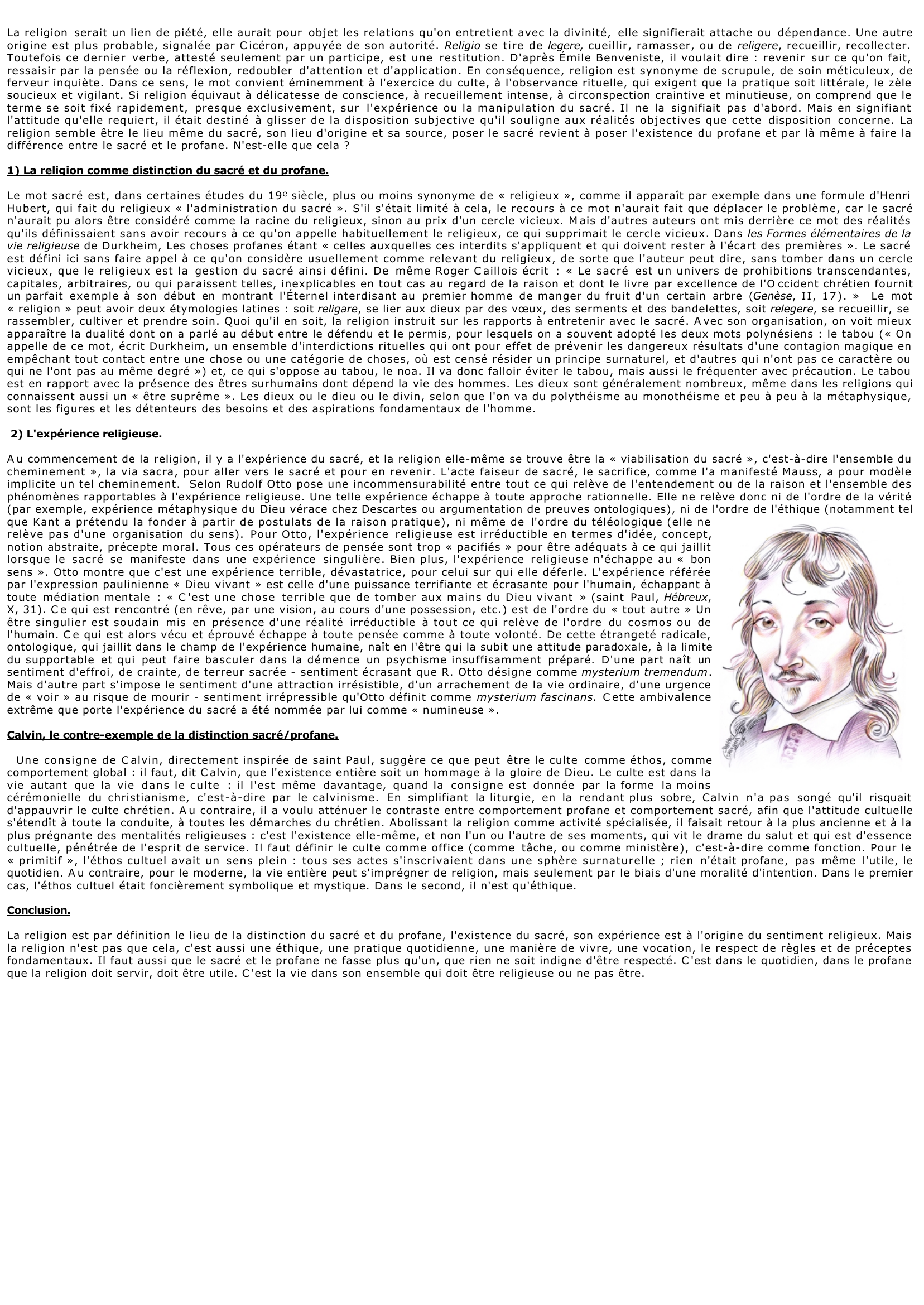La distinction du sacré et du profane suffit-elle à définir la religion ?
Extrait du document
«
La religion serait un lien de piété, elle aurait pour objet les relations qu'on entretient avec la divinité, elle signifierait attache ou dépendance.
Une autre
origine est plus probable, signalée par C icéron, appuyée de son autorité.
Religio se tire de legere, cueillir, ramasser, ou de religere, recueillir, recollecter.
Toutefois ce dernier verbe, attesté seulement par un participe, est une restitution.
D'après Émile Benveniste, il voulait dire : revenir sur ce qu'on fait,
ressaisir par la pensée ou la réflexion, redoubler d'attention et d'application.
En conséquence, religion est synonyme de scrupule, de soin méticuleux, de
ferveur inquiète.
Dans ce sens, le mot convient éminemment à l'exercice du culte, à l'observance rituelle, qui exigent que la pratique soit littérale, le zèle
soucieux et vigilant.
Si religion équivaut à délicatesse de conscience, à recueillement intense, à circonspection craintive et minutieuse, on comprend que le
terme se soit fixé rapidement, presque exclusivement, sur l'expérience ou la manipulation du sacré.
Il ne la signifiait pas d'abord.
Mais en signifiant
l'attitude qu'elle requiert, il était destiné à glisser de la disposition subjective qu'il souligne aux réalités objectives que cette disposition concerne.
La
religion semble être le lieu même du sacré, son lieu d'origine et sa source, poser le sacré revient à poser l'existence du profane et par là même à faire la
différence entre le sacré et le profane.
N'est-elle que cela ?
1) La religion comme distinction du sacré et du profane.
Le mot sacré est, dans certaines études du 19 e siècle, plus ou moins synonyme de « religieux », comme il apparaît par exemple dans une formule d'Henri
Hubert, qui fait du religieux « l'administration du sacré ».
S'il s'était limité à cela, le recours à ce mot n'aurait fait que déplacer le problème, car le sacré
n'aurait pu alors être considéré comme la racine du religieux, sinon au prix d'un cercle vicieux.
M ais d'autres auteurs ont mis derrière ce mot des réalités
qu'ils définissaient sans avoir recours à ce qu'on appelle habituellement le religieux, ce qui supprimait le cercle vicieux.
Dans les Formes élémentaires de la
vie religieuse de Durkheim, Les choses profanes étant « celles auxquelles ces interdits s'appliquent et qui doivent rester à l'écart des premières ».
Le sacré
est défini ici sans faire appel à ce qu'on considère usuellement comme relevant du religieux, de sorte que l'auteur peut dire, sans tomber dans un cercle
vicieux, que le religieux est la gestion du sacré ainsi défini.
De même Roger C aillois écrit : « Le sacré est un univers de prohibitions transcendantes,
capitales, arbitraires, ou qui paraissent telles, inexplicables en tout cas au regard de la raison et dont le livre par excellence de l'O ccident chrétien fournit
un parfait exemple à son début en montrant l'Éternel interdisant au premier homme de manger du fruit d'un certain arbre (Genèse, II, 17).
» Le mot
« religion » peut avoir deux étymologies latines : soit religare, se lier aux dieux par des vœux, des serments et des bandelettes, soit relegere, se recueillir, se
rassembler, cultiver et prendre soin.
Quoi qu'il en soit, la religion instruit sur les rapports à entretenir avec le sacré.
A vec son organisation, on voit mieux
apparaître la dualité dont on a parlé au début entre le défendu et le permis, pour lesquels on a souvent adopté les deux mots polynésiens : le tabou (« On
appelle de ce mot, écrit Durkheim, un ensemble d'interdictions rituelles qui ont pour effet de prévenir les dangereux résultats d'une contagion magique en
empêchant tout contact entre une chose ou une catégorie de choses, où est censé résider un principe surnaturel, et d'autres qui n'ont pas ce caractère ou
qui ne l'ont pas au même degré ») et, ce qui s'oppose au tabou, le noa.
Il va donc falloir éviter le tabou, mais aussi le fréquenter avec précaution.
Le tabou
est en rapport avec la présence des êtres surhumains dont dépend la vie des hommes.
Les dieux sont généralement nombreux, même dans les religions qui
connaissent aussi un « être suprême ».
Les dieux ou le dieu ou le divin, selon que l'on va du polythéisme au monothéisme et peu à peu à la métaphysique,
sont les figures et les détenteurs des besoins et des aspirations fondamentaux de l'homme.
2) L'expérience religieuse.
A u commencement de la religion, il y a l'expérience du sacré, et la religion elle-même se trouve être la « viabilisation du sacré », c'est-à-dire l'ensemble du
cheminement », la via sacra, pour aller vers le sacré et pour en revenir.
L'acte faiseur de sacré, le sacrifice, comme l'a manifesté Mauss, a pour modèle
implicite un tel cheminement.
Selon Rudolf Otto pose une incommensurabilité entre tout ce qui relève de l'entendement ou de la raison et l'ensemble des
phénomènes rapportables à l'expérience religieuse.
Une telle expérience échappe à toute approche rationnelle.
Elle ne relève donc ni de l'ordre de la vérité
(par exemple, expérience métaphysique du Dieu vérace chez Descartes ou argumentation de preuves ontologiques), ni de l'ordre de l'éthique (notamment tel
que Kant a prétendu la fonder à partir de postulats de la raison pratique), ni même de l'ordre du téléologique (elle ne
relève pas d'une organisation du sens).
Pour Otto, l'expérience religieuse est irréductible en termes d'idée, concept,
notion abstraite, précepte moral.
Tous ces opérateurs de pensée sont trop « pacifiés » pour être adéquats à ce qui jaillit
lorsque le sacré se manifeste dans une expérience singulière.
Bien plus, l'expérience religieuse n'échappe au « bon
sens ».
Otto montre que c'est une expérience terrible, dévastatrice, pour celui sur qui elle déferle.
L'expérience référée
par l'expression paulinienne « Dieu vivant » est celle d'une puissance terrifiante et écrasante pour l'humain, échappant à
toute médiation mentale : « C 'est une chose terrible que de tomber aux mains du Dieu vivant » (saint Paul, Hébreux,
X, 31).
C e qui est rencontré (en rêve, par une vision, au cours d'une possession, etc.) est de l'ordre du « tout autre » Un
être singulier est soudain mis en présence d'une réalité irréductible à tout ce qui relève de l'ordre du cosmos ou de
l'humain.
C e qui est alors vécu et éprouvé échappe à toute pensée comme à toute volonté.
De cette étrangeté radicale,
ontologique, qui jaillit dans le champ de l'expérience humaine, naît en l'être qui la subit une attitude paradoxale, à la limite
du supportable et qui peut faire basculer dans la démence un psychisme insuffisamment préparé.
D'une part naît un
sentiment d'effroi, de crainte, de terreur sacrée - sentiment écrasant que R.
Otto désigne comme mysterium tremendum.
Mais d'autre part s'impose le sentiment d'une attraction irrésistible, d'un arrachement de la vie ordinaire, d'une urgence
de « voir » au risque de mourir - sentiment irrépressible qu'Otto définit comme mysterium fascinans.
C ette ambivalence
extrême que porte l'expérience du sacré a été nommée par lui comme « numineuse ».
Calvin, le contre-exemple de la distinction sacré/profane.
Une consigne de C alvin, directement inspirée de saint Paul, suggère ce que peut être le culte comme éthos, comme
comportement global : il faut, dit C alvin, que l'existence entière soit un hommage à la gloire de Dieu.
Le culte est dans la
vie autant que la vie dans le culte : il l'est même davantage, quand la consigne est donnée par la forme la moins
cérémonielle du christianisme, c'est-à-dire par le calvinisme.
En simplifiant la liturgie, en la rendant plus sobre, Calvin n'a pas songé qu'il risquait
d'appauvrir le culte chrétien.
A u contraire, il a voulu atténuer le contraste entre comportement profane et comportement sacré, afin que l'attitude cultuelle
s'étendît à toute la conduite, à toutes les démarches du chrétien.
Abolissant la religion comme activité spécialisée, il faisait retour à la plus ancienne et à la
plus prégnante des mentalités religieuses : c'est l'existence elle-même, et non l'un ou l'autre de ses moments, qui vit le drame du salut et qui est d'essence
cultuelle, pénétrée de l'esprit de service.
Il faut définir le culte comme office (comme tâche, ou comme ministère), c'est-à-dire comme fonction.
Pour le
« primitif », l'éthos cultuel avait un sens plein : tous ses actes s'inscrivaient dans une sphère surnaturelle ; rien n'était profane, pas même l'utile, le
quotidien.
A u contraire, pour le moderne, la vie entière peut s'imprégner de religion, mais seulement par le biais d'une moralité d'intention.
Dans le premier
cas, l'éthos cultuel était foncièrement symbolique et mystique.
Dans le second, il n'est qu'éthique.
Conclusion.
La religion est par définition le lieu de la distinction du sacré et du profane, l'existence du sacré, son expérience est à l'origine du sentiment religieux.
Mais
la religion n'est pas que cela, c'est aussi une éthique, une pratique quotidienne, une manière de vivre, une vocation, le respect de règles et de préceptes
fondamentaux.
Il faut aussi que le sacré et le profane ne fasse plus qu'un, que rien ne soit indigne d'être respecté.
C 'est dans le quotidien, dans le profane
que la religion doit servir, doit être utile.
C 'est la vie dans son ensemble qui doit être religieuse ou ne pas être..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La religion peut-elle se définir par sa fonction sociale ?
- Chapitre 11. Axe 1. Comment définir et mesurer la mobilité sociale ?
- Sujet : Définir l’expression « valeur humaine universelle » et montrer son originalité
- Dissertation philosophie Bertrand Russell in Science et Religion: la conscience
- Nietzsche et la religion