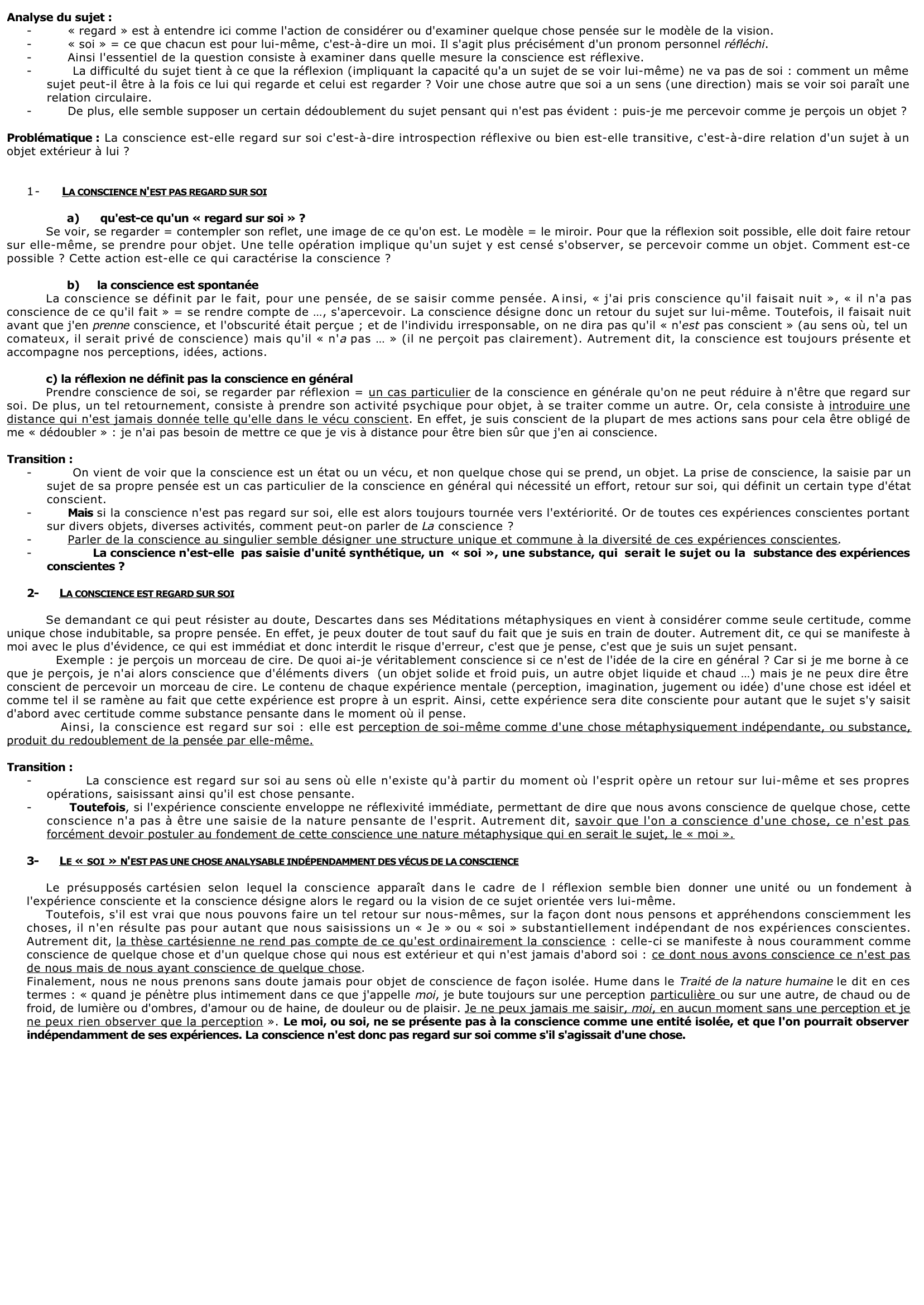La conscience est-elle regard sur soi ?
Extrait du document
«
Analyse du sujet :
« regard » est à entendre ici comme l'action de considérer ou d'examiner quelque chose pensée sur le modèle de la vision.
« soi » = ce que chacun est pour lui-même, c'est-à-dire un moi.
Il s'agit plus précisément d'un pronom personnel réfléchi.
Ainsi l'essentiel de la question consiste à examiner dans quelle mesure la conscience est réflexive.
La difficulté du sujet tient à ce que la réflexion (impliquant la capacité qu'a un sujet de se voir lui-même) ne va pas de soi : comment un même
sujet peut-il être à la fois ce lui qui regarde et celui est regarder ? Voir une chose autre que soi a un sens (une direction) mais se voir soi paraît une
relation circulaire.
De plus, elle semble supposer un certain dédoublement du sujet pensant qui n'est pas évident : puis-je me percevoir comme je perçois un objet ?
Problématique : La conscience est-elle regard sur soi c'est-à-dire introspection réflexive ou bien est-elle transitive, c'est-à-dire relation d'un sujet à un
objet extérieur à lui ?
1-
LA CONSCIENCE N'EST PAS REGARD SUR SOI
a)
qu'est-ce qu'un « regard sur soi » ?
Se voir, se regarder = contempler son reflet, une image de ce qu'on est.
Le modèle = le miroir.
Pour que la réflexion soit possible, elle doit faire retour
sur elle-même, se prendre pour objet.
Une telle opération implique qu'un sujet y est censé s'observer, se percevoir comme un objet.
Comment est-ce
possible ? Cette action est-elle ce qui caractérise la conscience ?
b)
la conscience est spontanée
La conscience se définit par le fait, pour une pensée, de se saisir comme pensée.
A insi, « j'ai pris conscience qu'il faisait nuit », « il n'a pas
conscience de ce qu'il fait » = se rendre compte de …, s'apercevoir.
La conscience désigne donc un retour du sujet sur lui-même.
Toutefois, il faisait nuit
avant que j'en prenne conscience, et l'obscurité était perçue ; et de l'individu irresponsable, on ne dira pas qu'il « n'est pas conscient » (au sens où, tel un
comateux, il serait privé de conscience) mais qu'il « n' a pas … » (il ne perçoit pas clairement).
Autrement dit, la conscience est toujours présente et
accompagne nos perceptions, idées, actions.
c) la réflexion ne définit pas la conscience en général
Prendre conscience de soi, se regarder par réflexion = un cas particulier de la conscience en générale qu'on ne peut réduire à n'être que regard sur
soi.
De plus, un tel retournement, consiste à prendre son activité psychique pour objet, à se traiter comme un autre.
Or, cela consiste à introduire une
distance qui n'est jamais donnée telle qu'elle dans le vécu conscient.
En effet, je suis conscient de la plupart de mes actions sans pour cela être obligé de
me « dédoubler » : je n'ai pas besoin de mettre ce que je vis à distance pour être bien sûr que j'en ai conscience.
Transition :
On vient de voir que la conscience est un état ou un vécu, et non quelque chose qui se prend, un objet.
La prise de conscience, la saisie par un
sujet de sa propre pensée est un cas particulier de la conscience en général qui nécessité un effort, retour sur soi, qui définit un certain type d'état
conscient.
Mais si la conscience n'est pas regard sur soi, elle est alors toujours tournée vers l'extériorité.
Or de toutes ces expériences conscientes portant
sur divers objets, diverses activités, comment peut-on parler de La conscience ?
Parler de la conscience au singulier semble désigner une structure unique et commune à la diversité de ces expériences conscientes.
La conscience n'est-elle pas saisie d'unité synthétique, un « soi », une substance, qui serait le sujet ou la substance des expériences
conscientes ?
2-
LA CONSCIENCE EST REGARD SUR SOI
Se demandant ce qui peut résister au doute, Descartes dans ses Méditations métaphysiques en vient à considérer comme seule certitude, comme
unique chose indubitable, sa propre pensée.
En effet, je peux douter de tout sauf du fait que je suis en train de douter.
Autrement dit, ce qui se manifeste à
moi avec le plus d'évidence, ce qui est immédiat et donc interdit le risque d'erreur, c'est que je pense, c'est que je suis un sujet pensant.
Exemple : je perçois un morceau de cire.
De quoi ai-je véritablement conscience si ce n'est de l'idée de la cire en général ? Car si je me borne à ce
que je perçois, je n'ai alors conscience que d'éléments divers (un objet solide et froid puis, un autre objet liquide et chaud …) mais je ne peux dire être
conscient de percevoir un morceau de cire.
Le contenu de chaque expérience mentale (perception, imagination, jugement ou idée) d'une chose est idéel et
comme tel il se ramène au fait que cette expérience est propre à un esprit.
Ainsi, cette expérience sera dite consciente pour autant que le sujet s'y saisit
d'abord avec certitude comme substance pensante dans le moment où il pense.
Ainsi, la conscience est regard sur soi : elle est perception de soi-même comme d'une chose métaphysiquement indépendante, ou substance,
produit du redoublement de la pensée par elle-même.
Transition :
La conscience est regard sur soi au sens où elle n'existe qu'à partir du moment où l'esprit opère un retour sur lui-même et ses propres
opérations, saisissant ainsi qu'il est chose pensante.
Toutefois, si l'expérience consciente enveloppe ne réflexivité immédiate, permettant de dire que nous avons conscience de quelque chose, cette
conscience n'a pas à être une saisie de la nature pensante de l'esprit.
Autrement dit, savoir que l'on a conscience d'une chose, ce n'est pas
forcément devoir postuler au fondement de cette conscience une nature métaphysique qui en serait le sujet, le « moi ».
3-
LE « SOI » N'EST PAS UNE CHOSE ANALYSABLE INDÉPENDAMMENT DES VÉCUS DE LA CONSCIENCE
Le présupposés cartésien selon lequel la conscience apparaît dans le cadre de l réflexion semble bien donner une unité ou un fondement à
l'expérience consciente et la conscience désigne alors le regard ou la vision de ce sujet orientée vers lui-même.
Toutefois, s'il est vrai que nous pouvons faire un tel retour sur nous-mêmes, sur la façon dont nous pensons et appréhendons consciemment les
choses, il n'en résulte pas pour autant que nous saisissions un « Je » ou « soi » substantiellement indépendant de nos expériences conscientes.
Autrement dit, la thèse cartésienne ne rend pas compte de ce qu'est ordinairement la conscience : celle-ci se manifeste à nous couramment comme
conscience de quelque chose et d'un quelque chose qui nous est extérieur et qui n'est jamais d'abord soi : ce dont nous avons conscience ce n'est pas
de nous mais de nous ayant conscience de quelque chose.
Finalement, nous ne nous prenons sans doute jamais pour objet de conscience de façon isolée.
Hume dans le Traité de la nature humaine le dit en ces
termes : « quand je pénètre plus intimement dans ce que j'appelle moi, je bute toujours sur une perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de
froid, de lumière ou d'ombres, d'amour ou de haine, de douleur ou de plaisir.
Je ne peux jamais me saisir, moi, en aucun moment sans une perception et je
ne peux rien observer que la perception ».
Le moi, ou soi, ne se présente pas à la conscience comme une entité isolée, et que l'on pourrait observer
indépendamment de ses expériences.
La conscience n'est donc pas regard sur soi comme s'il s'agissait d'une chose..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Philosophie : Conscience/ Inconscient
- la conscience nous condamne a l'inquiétude ?
- Montrez les différents éléments de l’argumentation qui permettent d’établir que Kant a une conception de la conscience qui se trouve être encore ici d’inspiration cartésienne
- la conscience peut-elle faire obstacle au bonheur ?
- Dissertation philosophie Bertrand Russell in Science et Religion: la conscience