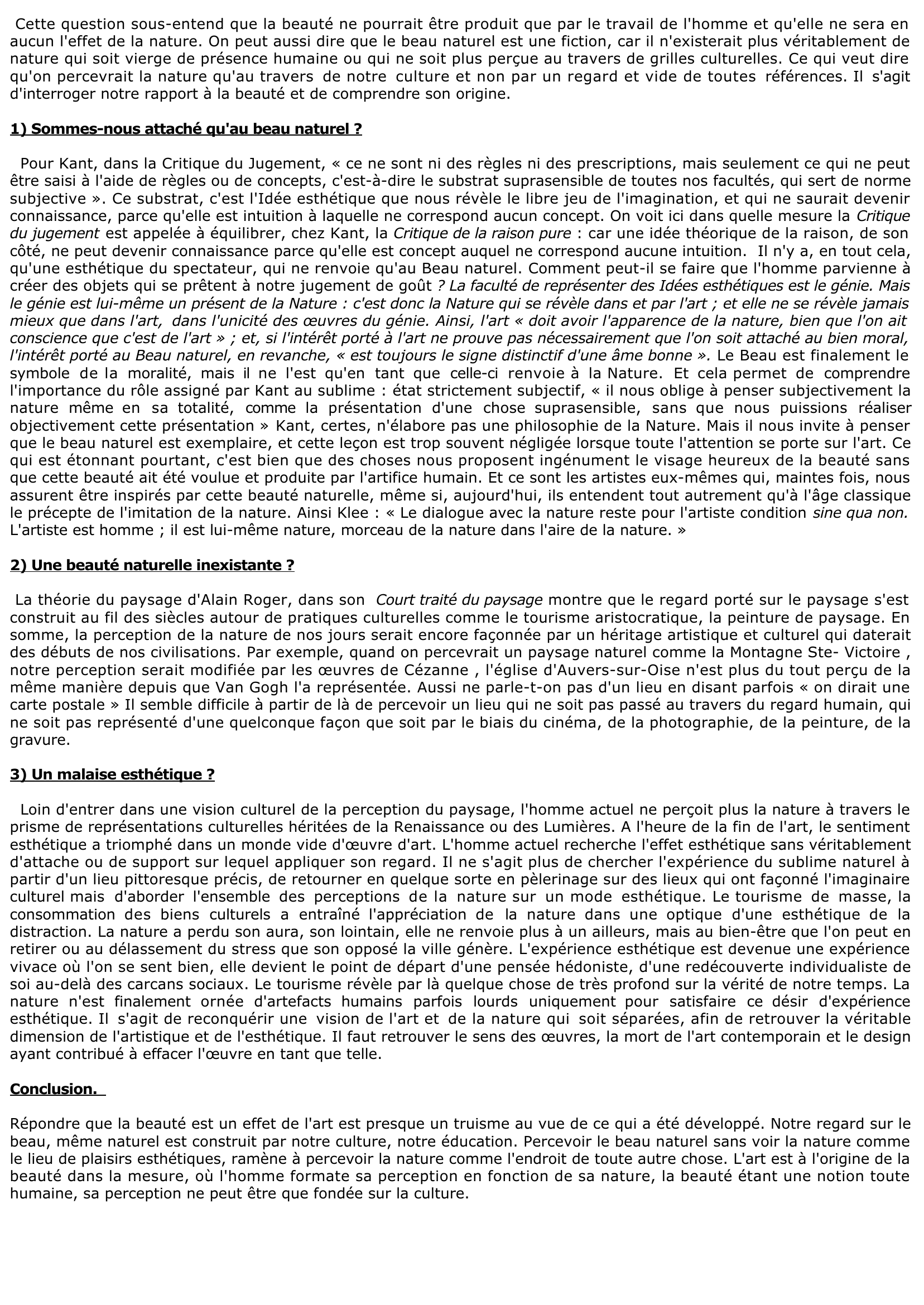La beauté n'est-elle qu'un effet de l'art ?
Extrait du document
«
Cette question sous-entend que la beauté ne pourrait être produit que par le travail de l'homme et qu'elle ne sera en
aucun l'effet de la nature.
On peut aussi dire que le beau naturel est une fiction, car il n'existerait plus véritablement de
nature qui soit vierge de présence humaine ou qui ne soit plus perçue au travers de grilles culturelles.
Ce qui veut dire
qu'on percevrait la nature qu'au travers de notre culture et non par un regard et vide de toutes références.
Il s'agit
d'interroger notre rapport à la beauté et de comprendre son origine.
1) Sommes-nous attaché qu'au beau naturel ?
Pour Kant, dans la Critique du Jugement, « ce ne sont ni des règles ni des prescriptions, mais seulement ce qui ne peut
être saisi à l'aide de règles ou de concepts, c'est-à-dire le substrat suprasensible de toutes nos facultés, qui sert de norme
subjective ».
Ce substrat, c'est l'Idée esthétique que nous révèle le libre jeu de l'imagination, et qui ne saurait devenir
connaissance, parce qu'elle est intuition à laquelle ne correspond aucun concept.
On voit ici dans quelle mesure la Critique
du jugement est appelée à équilibrer, chez Kant, la Critique de la raison pure : car une idée théorique de la raison, de son
côté, ne peut devenir connaissance parce qu'elle est concept auquel ne correspond aucune intuition.
Il n'y a, en tout cela,
qu'une esthétique du spectateur, qui ne renvoie qu'au Beau naturel.
Comment peut-il se faire que l'homme parvienne à
créer des objets qui se prêtent à notre jugement de goût ? La faculté de représenter des Idées esthétiques est le génie.
Mais
le génie est lui-même un présent de la Nature : c'est donc la Nature qui se révèle dans et par l'art ; et elle ne se révèle jamais
mieux que dans l'art, dans l'unicité des œuvres du génie.
Ainsi, l'art « doit avoir l'apparence de la nature, bien que l'on ait
conscience que c'est de l'art » ; et, si l'intérêt porté à l'art ne prouve pas nécessairement que l'on soit attaché au bien moral,
l'intérêt porté au Beau naturel, en revanche, « est toujours le signe distinctif d'une âme bonne ».
Le Beau est finalement le
symbole de la moralité, mais il ne l'est qu'en tant que celle-ci renvoie à la Nature.
Et cela permet de comprendre
l'importance du rôle assigné par Kant au sublime : état strictement subjectif, « il nous oblige à penser subjectivement la
nature même en sa totalité, comme la présentation d'une chose suprasensible, sans que nous puissions réaliser
objectivement cette présentation » Kant, certes, n'élabore pas une philosophie de la Nature.
Mais il nous invite à penser
que le beau naturel est exemplaire, et cette leçon est trop souvent négligée lorsque toute l'attention se porte sur l'art.
Ce
qui est étonnant pourtant, c'est bien que des choses nous proposent ingénument le visage heureux de la beauté sans
que cette beauté ait été voulue et produite par l'artifice humain.
Et ce sont les artistes eux-mêmes qui, maintes fois, nous
assurent être inspirés par cette beauté naturelle, même si, aujourd'hui, ils entendent tout autrement qu'à l'âge classique
le précepte de l'imitation de la nature.
Ainsi Klee : « Le dialogue avec la nature reste pour l'artiste condition sine qua non.
L'artiste est homme ; il est lui-même nature, morceau de la nature dans l'aire de la nature.
»
2) Une beauté naturelle inexistante ?
La théorie du paysage d'Alain Roger, dans son Court traité du paysage montre que le regard porté sur le paysage s'est
construit au fil des siècles autour de pratiques culturelles comme le tourisme aristocratique, la peinture de paysage.
En
somme, la perception de la nature de nos jours serait encore façonnée par un héritage artistique et culturel qui daterait
des débuts de nos civilisations.
Par exemple, quand on percevrait un paysage naturel comme la Montagne Ste- Victoire ,
notre perception serait modifiée par les œuvres de Cézanne , l'église d'Auvers-sur-Oise n'est plus du tout perçu de la
même manière depuis que Van Gogh l'a représentée.
Aussi ne parle-t-on pas d'un lieu en disant parfois « on dirait une
carte postale » Il semble difficile à partir de là de percevoir un lieu qui ne soit pas passé au travers du regard humain, qui
ne soit pas représenté d'une quelconque façon que soit par le biais du cinéma, de la photographie, de la peinture, de la
gravure.
3) Un malaise esthétique ?
Loin d'entrer dans une vision culturel de la perception du paysage, l'homme actuel ne perçoit plus la nature à travers le
prisme de représentations culturelles héritées de la Renaissance ou des Lumières.
A l'heure de la fin de l'art, le sentiment
esthétique a triomphé dans un monde vide d'œuvre d'art.
L'homme actuel recherche l'effet esthétique sans véritablement
d'attache ou de support sur lequel appliquer son regard.
Il ne s'agit plus de chercher l'expérience du sublime naturel à
partir d'un lieu pittoresque précis, de retourner en quelque sorte en pèlerinage sur des lieux qui ont façonné l'imaginaire
culturel mais d'aborder l'ensemble des perceptions de la nature sur un mode esthétique.
Le tourisme de masse, la
consommation des biens culturels a entraîné l'appréciation de la nature dans une optique d'une esthétique de la
distraction.
La nature a perdu son aura, son lointain, elle ne renvoie plus à un ailleurs, mais au bien-être que l'on peut en
retirer ou au délassement du stress que son opposé la ville génère.
L'expérience esthétique est devenue une expérience
vivace où l'on se sent bien, elle devient le point de départ d'une pensée hédoniste, d'une redécouverte individualiste de
soi au-delà des carcans sociaux.
Le tourisme révèle par là quelque chose de très profond sur la vérité de notre temps.
La
nature n'est finalement ornée d'artefacts humains parfois lourds uniquement pour satisfaire ce désir d'expérience
esthétique.
Il s'agit de reconquérir une vision de l'art et de la nature qui soit séparées, afin de retrouver la véritable
dimension de l'artistique et de l'esthétique.
Il faut retrouver le sens des œuvres, la mort de l'art contemporain et le design
ayant contribué à effacer l'œuvre en tant que telle.
Conclusion.
Répondre que la beauté est un effet de l'art est presque un truisme au vue de ce qui a été développé.
Notre regard sur le
beau, même naturel est construit par notre culture, notre éducation.
Percevoir le beau naturel sans voir la nature comme
le lieu de plaisirs esthétiques, ramène à percevoir la nature comme l'endroit de toute autre chose.
L'art est à l'origine de la
beauté dans la mesure, où l'homme formate sa perception en fonction de sa nature, la beauté étant une notion toute
humaine, sa perception ne peut être que fondée sur la culture..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Hegel: L'expérience de la beauté passe-t-elle nécessairement par l'oeuvre d'art ?
- Puis-je convaincre autrui de la beauté d'une oeuvre d'art à l'aide de concepts ?
- La beauté est-elle la fin de l'art ?
- s'il y a une beauté naturelle, rend-elle l'art inutile ?
- Peut-on juger la beauté d'une oeuvre d'art ?