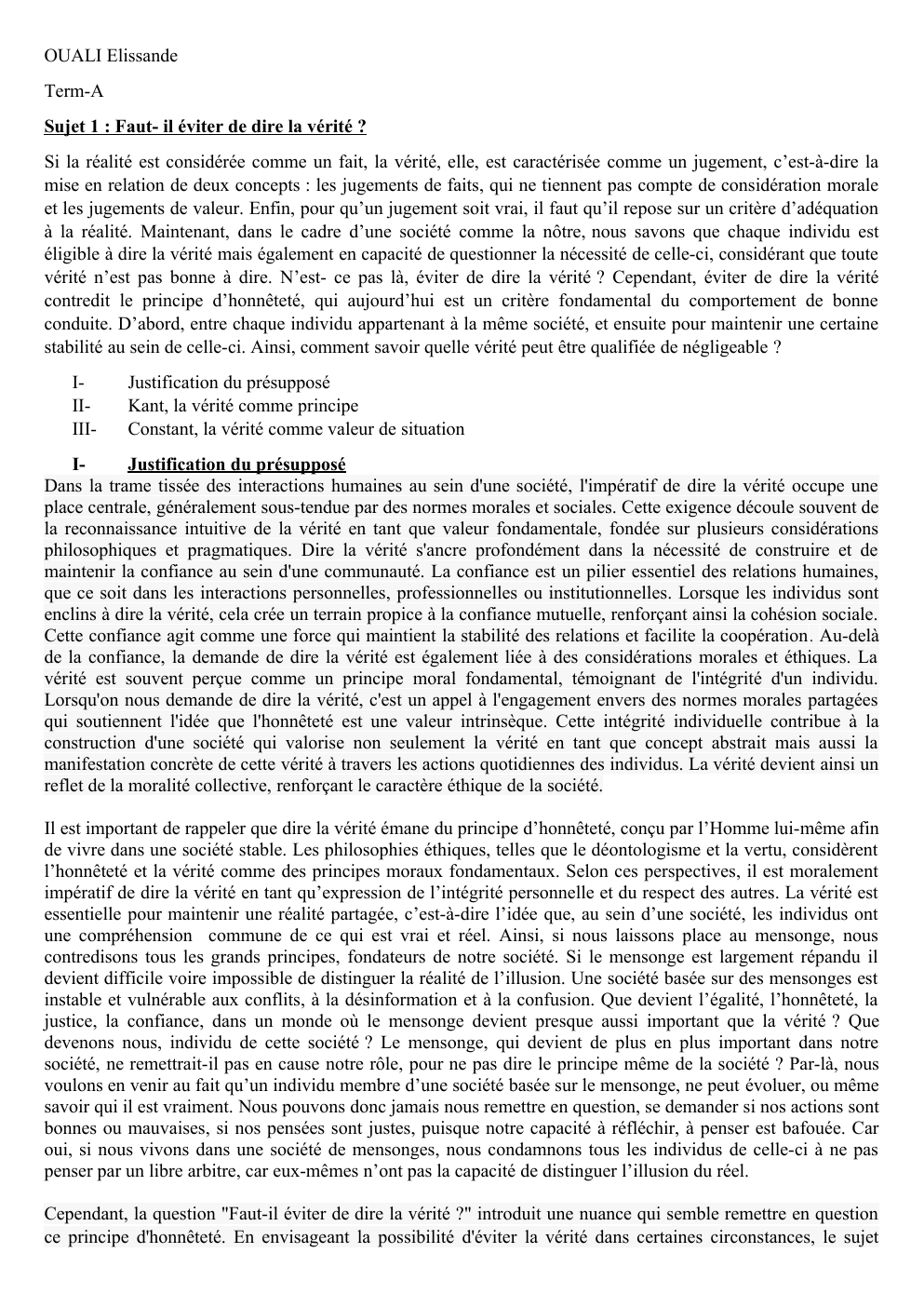faut-il éviter de dire la vérité ?
Publié le 08/02/2024
Extrait du document
«
OUALI Elissande
Term-A
Sujet 1 : Faut- il éviter de dire la vérité ?
Si la réalité est considérée comme un fait, la vérité, elle, est caractérisée comme un jugement, c’est-à-dire la
mise en relation de deux concepts : les jugements de faits, qui ne tiennent pas compte de considération morale
et les jugements de valeur.
Enfin, pour qu’un jugement soit vrai, il faut qu’il repose sur un critère d’adéquation
à la réalité.
Maintenant, dans le cadre d’une société comme la nôtre, nous savons que chaque individu est
éligible à dire la vérité mais également en capacité de questionner la nécessité de celle-ci, considérant que toute
vérité n’est pas bonne à dire.
N’est- ce pas là, éviter de dire la vérité ? Cependant, éviter de dire la vérité
contredit le principe d’honnêteté, qui aujourd’hui est un critère fondamental du comportement de bonne
conduite.
D’abord, entre chaque individu appartenant à la même société, et ensuite pour maintenir une certaine
stabilité au sein de celle-ci.
Ainsi, comment savoir quelle vérité peut être qualifiée de négligeable ?
IIIIII-
Justification du présupposé
Kant, la vérité comme principe
Constant, la vérité comme valeur de situation
IJustification du présupposé
Dans la trame tissée des interactions humaines au sein d'une société, l'impératif de dire la vérité occupe une
place centrale, généralement sous-tendue par des normes morales et sociales.
Cette exigence découle souvent de
la reconnaissance intuitive de la vérité en tant que valeur fondamentale, fondée sur plusieurs considérations
philosophiques et pragmatiques.
Dire la vérité s'ancre profondément dans la nécessité de construire et de
maintenir la confiance au sein d'une communauté.
La confiance est un pilier essentiel des relations humaines,
que ce soit dans les interactions personnelles, professionnelles ou institutionnelles.
Lorsque les individus sont
enclins à dire la vérité, cela crée un terrain propice à la confiance mutuelle, renforçant ainsi la cohésion sociale.
Cette confiance agit comme une force qui maintient la stabilité des relations et facilite la coopération.
Au-delà
de la confiance, la demande de dire la vérité est également liée à des considérations morales et éthiques.
La
vérité est souvent perçue comme un principe moral fondamental, témoignant de l'intégrité d'un individu.
Lorsqu'on nous demande de dire la vérité, c'est un appel à l'engagement envers des normes morales partagées
qui soutiennent l'idée que l'honnêteté est une valeur intrinsèque.
Cette intégrité individuelle contribue à la
construction d'une société qui valorise non seulement la vérité en tant que concept abstrait mais aussi la
manifestation concrète de cette vérité à travers les actions quotidiennes des individus.
La vérité devient ainsi un
reflet de la moralité collective, renforçant le caractère éthique de la société.
Il est important de rappeler que dire la vérité émane du principe d’honnêteté, conçu par l’Homme lui-même afin
de vivre dans une société stable.
Les philosophies éthiques, telles que le déontologisme et la vertu, considèrent
l’honnêteté et la vérité comme des principes moraux fondamentaux.
Selon ces perspectives, il est moralement
impératif de dire la vérité en tant qu’expression de l’intégrité personnelle et du respect des autres.
La vérité est
essentielle pour maintenir une réalité partagée, c’est-à-dire l’idée que, au sein d’une société, les individus ont
une compréhension commune de ce qui est vrai et réel.
Ainsi, si nous laissons place au mensonge, nous
contredisons tous les grands principes, fondateurs de notre société.
Si le mensonge est largement répandu il
devient difficile voire impossible de distinguer la réalité de l’illusion.
Une société basée sur des mensonges est
instable et vulnérable aux conflits, à la désinformation et à la confusion.
Que devient l’égalité, l’honnêteté, la
justice, la confiance, dans un monde où le mensonge devient presque aussi important que la vérité ? Que
devenons nous, individu de cette société ? Le mensonge, qui devient de plus en plus important dans notre
société, ne remettrait-il pas en cause notre rôle, pour ne pas dire le principe même de la société ? Par-là, nous
voulons en venir au fait qu’un individu membre d’une société basée sur le mensonge, ne peut évoluer, ou même
savoir qui il est vraiment.
Nous pouvons donc jamais nous remettre en question, se demander si nos actions sont
bonnes ou mauvaises, si nos pensées sont justes, puisque notre capacité à réfléchir, à penser est bafouée.
Car
oui, si nous vivons dans une société de mensonges, nous condamnons tous les individus de celle-ci à ne pas
penser par un libre arbitre, car eux-mêmes n’ont pas la capacité de distinguer l’illusion du réel.
Cependant, la question "Faut-il éviter de dire la vérité ?" introduit une nuance qui semble remettre en question
ce principe d'honnêteté.
En envisageant la possibilité d'éviter la vérité dans certaines circonstances, le sujet
suggère que l'honnêteté peut être relativisée en fonction des situations.
Cela pose la question de savoir si la
vérité est une valeur morale absolue ou si elle peut être sujette à des compromis en fonction des circonstances.
Si l'honnêteté est un principe moral fondamental, la vérité peut également être considérée comme complexe
dans son application.
Par exemple, la vérité brutale peut parfois causer des dommages psychologiques graves.
Dans une perspective utilitariste, cela pourrait être interprété comme un compromis entre l'honnêteté et le bienêtre global.
Cependant, cette perspective soulève des questions sur la nature même de la vérité en tant que
valeur morale et sur la manière dont elle interagit avec d'autres impératifs moraux.
Ainsi, dans le cadre d’une
situation qui met un individu, ou nous-même en danger, le choix le plus judicieux ne serait-il pas d’éviter de
dire la vérité Ici, nous essayons d’en venir au fait que lorsque dire la vérité peut porter atteinte à notre sécurité,
ou même à notre vie, il est clair qu’éviter de dire la vérité est une nécessité.
Il y a donc une certaine hiérarchie
entre véracité et sécurité.
II-
Kant, la vérité comme principe
Immanuel Kant, philosophe moral du XVIIIe siècle, articule une théorie éthique qui accorde une importance
fondamentale à la vérité en tant que principe moral absolu.
Selon Kant, la vérité est intrinsèquement bonne,
indépendamment des conséquences spécifiques dans des situations données.
Cette perspective s'articule autour
de deux axes majeurs, dont le premier concerne la sécurité.
Kant soutient que la vérité est un impératif moral
essentiel pour garantir la sécurité dans la société.
Dans le cadre de sa formulation de l'impératif catégorique,
Kant affirme que l'on doit agir selon des maximes (principes d'action) qui peuvent être universalisées sans
contradiction.
En d'autres termes, si tout le monde devait mentir, les fondements de la confiance sociale
s'effondreraient, entraînant une insécurité généralisée.
L'exemple de la sécurité se manifeste dans des contextes
variés, de la vie quotidienne aux relations internationales.
Dans un contexte quotidien, par exemple, la
confiance entre amis, partenaires commerciaux ou membres d'une famille repose sur la conviction que la vérité
est dite.
Dans un contexte plus vaste, les accords internationaux et les relations diplomatiques reposent
également sur la transparence et la véracité des informations partagées entre nations.
Ainsi, la vérité est le
fondement de la confiance mutuelle au sein de la société .
Lorsque les individus disent la vérité, ils établissent
un climat de confiance, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement des relations sociales, des transactions
commerciales, de la gouvernance et de nombreux autres aspects de la vie en société.
Kant met en garde contre le calcul du mensonge, soulignant que même des mensonges motivés par de bonnes
intentions peuvent entraîner des conséquences néfastes.
Pour Kant, le mensonge est incompatible avec la
morale, car il viole l'impératif catégorique en traitant l'autre personne comme un moyen pour atteindre un
objectif particulier.
Kant rejette l'idée que le mensonge pourrait être justifié en fonction des conséquences
positives qui pourraient en découler.
Il s'oppose au concept de "mensonge pieux" ou de mensonge bien
intentionné, affirmant que cela équivaut à manipuler la vérité pour atteindre un objectif particulier.
Un exemple
classique est celui d'un parent mentant à son enfant pour le protéger.
Bien que le parent puisse estimer que le
mensonge est motivé par l'amour et la protection, Kant souligne que cette dissimulation sape la confiance à
long terme, créant un précédent où la vérité peut être sacrifiée au gré des circonstances.
Ainsi, mentir, c’est
mépriser l’autre et lui refuser son autonomie dans la mesure où par la tromperie, nous lui refusons de se tenir
sur un pied d’égalité avec nous-même comme nous lui refusons de penser correctement par lui-même.
Le refus
de dire la vérité à autrui tient donc d’un refus de la réalité elle-même.
Le menteur cherche à la fuir ou à la
reconfigurer.
Se....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il préférer la vérité au bonheur ?
- Diderot: La vérité existe-t-elle ou faut-il l'inventer ?
- ARISTOTE: «Comme la politique utilise les autres sciences pratiques, qu'elle légifère sur ce qu'il faut faire et éviter, la fin qu'elle poursuit peut embrasser la fin des autres sciences, au point d'être le bien suprême de l'homme.»
- « Il faut éviter de donner accès dans notre âme à l'idée que dans les raisonnements il y a une chance qu'il n'y ait rien de sain ; préférons cette autre idée : que c'est nous qui ne nous comportons pas encore sainement. » Platon, Phédon, ivcs. av. j.-C.
- Commenter ce texte de Poincaré : « La foi du savant ne ressemble pas à celle que les orthodoxes puisent dans le besoin de certitude. Il ne faut pas croire que l'amour de la vérité se confonde avec l'amour de la certitude [...]; non, la foi du savant ress