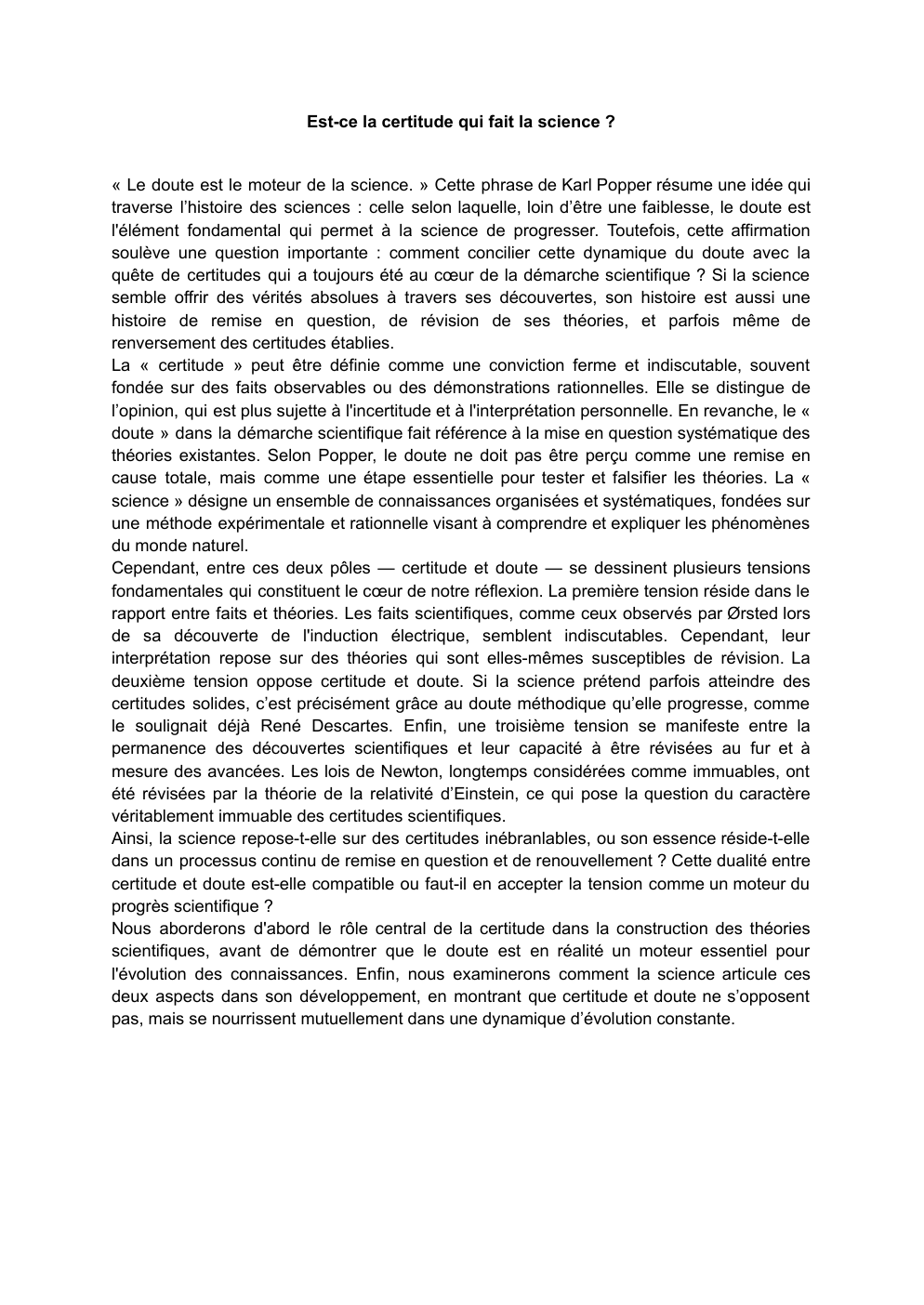Est-ce la certitude qui fait la science ?
Publié le 22/03/2025
Extrait du document
«
Est-ce la certitude qui fait la science ?
« Le doute est le moteur de la science.
» Cette phrase de Karl Popper résume une idée qui
traverse l’histoire des sciences : celle selon laquelle, loin d’être une faiblesse, le doute est
l'élément fondamental qui permet à la science de progresser.
Toutefois, cette affirmation
soulève une question importante : comment concilier cette dynamique du doute avec la
quête de certitudes qui a toujours été au cœur de la démarche scientifique ? Si la science
semble offrir des vérités absolues à travers ses découvertes, son histoire est aussi une
histoire de remise en question, de révision de ses théories, et parfois même de
renversement des certitudes établies.
La « certitude » peut être définie comme une conviction ferme et indiscutable, souvent
fondée sur des faits observables ou des démonstrations rationnelles.
Elle se distingue de
l’opinion, qui est plus sujette à l'incertitude et à l'interprétation personnelle.
En revanche, le «
doute » dans la démarche scientifique fait référence à la mise en question systématique des
théories existantes.
Selon Popper, le doute ne doit pas être perçu comme une remise en
cause totale, mais comme une étape essentielle pour tester et falsifier les théories.
La «
science » désigne un ensemble de connaissances organisées et systématiques, fondées sur
une méthode expérimentale et rationnelle visant à comprendre et expliquer les phénomènes
du monde naturel.
Cependant, entre ces deux pôles — certitude et doute — se dessinent plusieurs tensions
fondamentales qui constituent le cœur de notre réflexion.
La première tension réside dans le
rapport entre faits et théories.
Les faits scientifiques, comme ceux observés par Ørsted lors
de sa découverte de l'induction électrique, semblent indiscutables.
Cependant, leur
interprétation repose sur des théories qui sont elles-mêmes susceptibles de révision.
La
deuxième tension oppose certitude et doute.
Si la science prétend parfois atteindre des
certitudes solides, c’est précisément grâce au doute méthodique qu’elle progresse, comme
le soulignait déjà René Descartes.
Enfin, une troisième tension se manifeste entre la
permanence des découvertes scientifiques et leur capacité à être révisées au fur et à
mesure des avancées.
Les lois de Newton, longtemps considérées comme immuables, ont
été révisées par la théorie de la relativité d’Einstein, ce qui pose la question du caractère
véritablement immuable des certitudes scientifiques.
Ainsi, la science repose-t-elle sur des certitudes inébranlables, ou son essence réside-t-elle
dans un processus continu de remise en question et de renouvellement ? Cette dualité entre
certitude et doute est-elle compatible ou faut-il en accepter la tension comme un moteur du
progrès scientifique ?
Nous aborderons d'abord le rôle central de la certitude dans la construction des théories
scientifiques, avant de démontrer que le doute est en réalité un moteur essentiel pour
l'évolution des connaissances.
Enfin, nous examinerons comment la science articule ces
deux aspects dans son développement, en montrant que certitude et doute ne s’opposent
pas, mais se nourrissent mutuellement dans une dynamique d’évolution constante.
I.
Les certitudes comme fondement de la démarche scientifique
1. Les faits établis comme points de départ de la science
○ Exemple : découverte d’Ørsted, reproductibilité des expériences.
○ Importance des données stables pour l’élaboration théorique.
2. Les théories explicatives comme outils d’unification
○ Exemple : lois de Newton.
○ Structuration des connaissances à partir de cadres cohérents.
3. Les certitudes comme points d’appui pour de nouvelles découvertes
○ Exemple : ADN et avancées en biologie.
○ Certitudes comme socle évolutif.
Transition : Ces certitudes, bien qu’essentielles, ne sont jamais définitives et doivent être
sans cesse confrontées au doute.
II.
Le doute comme moteur de l’évolution scientifique
1. Le doute méthodique dans la progression scientifique
○ Descartes : doute méthodique.
○ Popper : falsifiabilité.
○ Exemple : remise en cause des lois de Newton par Einstein.
2. La révision des paradigmes scientifiques
○ Exemple : relativité restreinte, physique quantique.
○ Les grandes révolutions scientifiques naissent du doute envers les certitudes
établies.
3. Les limites de la prédictibilité et de la certitude
○ Exemple : mécanique quantique (paradoxe de Schrödinger).
○ Incertitudes dans des domaines comme la météorologie ou les sciences
humaines.
Transition : Cette dialectique entre certitude et doute appelle à une articulation féconde
entre les deux.
III.
Une articulation féconde entre certitude et doute
1. Des certitudes provisoires comme fondement du progrès scientifique
○ Exemple : modèles cosmologiques et exploration de la matière noire.
○ Rôle des vérités provisoires dans l’avancée des connaissances.
2. Une dynamique constructive garantissant l’évolution des savoirs
○ Exemple : recherches sur les vaccins à ARN messager.
○ Interaction entre certitudes établies et remise en question méthodique.
3. La complémentarité entre certitude et doute dans la méthode scientifique
○ Exemple : validation et réfutation expérimentale dans la gravité quantique.
○ Cette interaction garantit rigueur et ouverture à l’innovation.
I.
Les certitudes comme fondement de la démarche scientifique (3-4 min)
Les certitudes scientifiques, bien qu’évolutives, constituent souvent le point de départ de la
recherche.
Ce sont les faits établis qui permettent aux scientifiques de développer des
théories robustes et de structurer leurs connaissances.
Par exemple, la découverte d'Ørsted
de l'induction électromagnétique a été un fait reproductible, servant de base solide pour le
développement des théories sur l'électromagnétisme.
Toutefois, la question se pose : est-ce
la certitude d’Ørsted qui rend sa découverte scientifique ? Peut-on dire que sa confiance en
ses résultats est ce qui fait de sa démarche une science rigoureuse ?
La démarche scientifique d'Ørsted n'était pas simplement une conviction personnelle.
Elle
s'inscrivait dans une méthode expérimentale et rigoureuse qui distingue la science des
autres formes de savoir.
Ørsted a formulé une hypothèse, l’a testée expérimentalement et a
observé une déviation de l’aiguille magnétique sous l’effet du courant électrique.
Ce fait
reproductible était une base solide pour énoncer une théorie, mais ce n’était qu’un début.
La
science, en ce sens, ne repose pas uniquement sur la certitude initiale, mais sur le
processus systématique d’observation, de vérification et de reformulation.
Les théories scientifiques, comme celles de Newton, ne sont pas seulement des outils pour
expliquer les phénomènes observés, mais elles servent également à unifier ces
phénomènes, qu’ils soient célestes ou terrestres.
Les lois de Newton, fondées sur des
certitudes initiales, ont permis de structurer un modèle cohérent du monde physique.
Cependant, même ces théories considérées comme absolues pendant plusieurs siècles ont
été révisées à la lumière de découvertes ultérieures, notamment avec la relativité d’Einstein.
Ces révisions montrent que la certitude en science n'est pas figée ; elle évolue avec les
découvertes et le progrès des connaissances.
Ainsi, les certitudes sont essentielles pour la construction du savoir scientifique.
Elles offrent
un point de départ solide et permettent de faire progresser la réflexion.
Toutefois, ces
certitudes ne sont pas immuables : elles évoluent au fur et à mesure des découvertes.
Par
exemple, la découverte de l’ADN a bouleversé la biologie en fournissant une certitude
fondamentale qui a permis de nombreuses avancées, comme le séquençage génomique.
Mais cette certitude a aussi ouvert la voie à de nouvelles questions et révisions, ce qui
souligne que même les découvertes majeures sont sujettes à révision.
Transition : Si la certitude constitue un socle sur lequel se fonde la science, il est tout aussi
crucial d’explorer la place du doute méthodique, moteur de l’évolution des théories
scientifiques.
II.
Le doute comme moteur de l’évolution scientifique (4-5 min)
Le doute, loin de constituer une faiblesse, se révèle être une condition sine qua non de
l’avancement scientifique.
En effet, la science progresse en mettant en question ses propres
certitudes, et c’est précisément ce mécanisme qui permet à la connaissance de se
renouveler.
Le doute méthodique est au cœur de la démarche scientifique, car il incite à
remettre en cause les théories existantes et à tester de nouvelles hypothèses.
Comme
l’affirmait Karl Popper, l’un des grands penseurs du XXe siècle, "une théorie scientifique doit
être falsifiable" : elle doit pouvoir être mise à l'épreuve du doute et être susceptible de se
voir réfutée par l'expérience.
Ce principe de falsifiabilité souligne que la science repose sur
une remise en question constante et sur la révision des connaissances établies.
Prenons, à titre d’exemple, l’évolution des conceptions concernant la gravité.
La loi de la
gravitation universelle de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La science nous conduit-elle toujours à la certitude ?
- A défaut de certitude, une science du probable peut-elle suffire ?
- Philosophie: croyance, certitude et vérité
- Science & Vérité: La science doit-elle donner des certitudes ?
- Dissertation philosophie Bertrand Russell in Science et Religion: la conscience