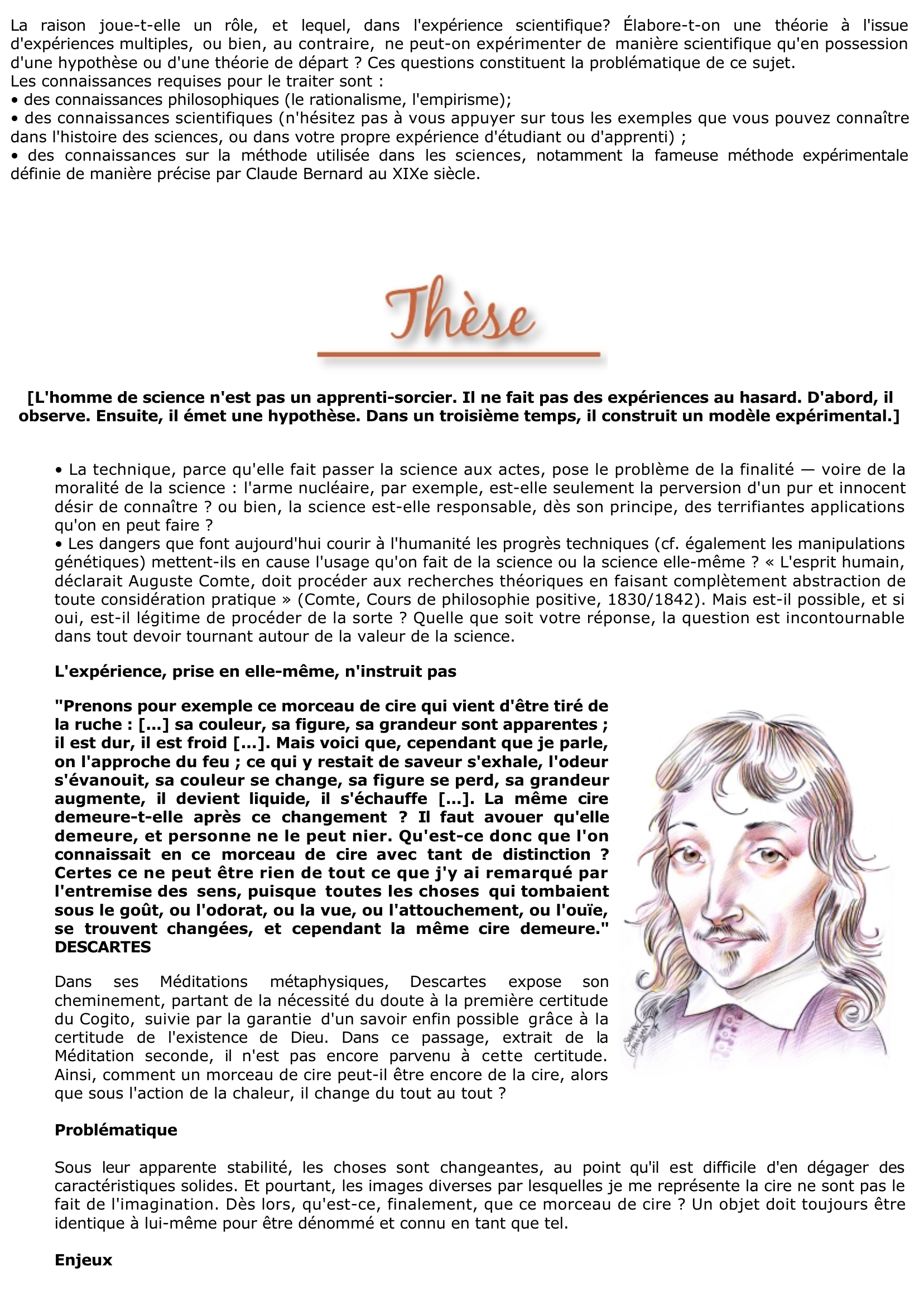En quel sens peut-on dire qu'« on expérimente avec sa raison » ?
Extrait du document
«
La raison joue-t-elle un rôle, et lequel, dans l'expérience scientifique? Élabore-t-on une théorie à l'issue
d'expériences multiples, ou bien, au contraire, ne peut-on expérimenter de manière scientifique qu'en possession
d'une hypothèse ou d'une théorie de départ ? Ces questions constituent la problématique de ce sujet.
Les connaissances requises pour le traiter sont :
• des connaissances philosophiques (le rationalisme, l'empirisme);
• des connaissances scientifiques (n'hésitez pas à vous appuyer sur tous les exemples que vous pouvez connaître
dans l'histoire des sciences, ou dans votre propre expérience d'étudiant ou d'apprenti) ;
• des connaissances sur la méthode utilisée dans les sciences, notamment la fameuse méthode expérimentale
définie de manière précise par Claude Bernard au XIXe siècle.
[L'homme de science n'est pas un apprenti-sorcier.
Il ne fait pas des expériences au hasard.
D'abord, il
observe.
Ensuite, il émet une hypothèse.
Dans un troisième temps, il construit un modèle expérimental.]
• La technique, parce qu'elle fait passer la science aux actes, pose le problème de la finalité — voire de la
moralité de la science : l'arme nucléaire, par exemple, est-elle seulement la perversion d'un pur et innocent
désir de connaître ? ou bien, la science est-elle responsable, dès son principe, des terrifiantes applications
qu'on en peut faire ?
• Les dangers que font aujourd'hui courir à l'humanité les progrès techniques (cf.
également les manipulations
génétiques) mettent-ils en cause l'usage qu'on fait de la science ou la science elle-même ? « L'esprit humain,
déclarait Auguste Comte, doit procéder aux recherches théoriques en faisant complètement abstraction de
toute considération pratique » (Comte, Cours de philosophie positive, 1830/1842).
Mais est-il possible, et si
oui, est-il légitime de procéder de la sorte ? Quelle que soit votre réponse, la question est incontournable
dans tout devoir tournant autour de la valeur de la science.
L'expérience, prise en elle-même, n'instruit pas
"Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d'être tiré de
la ruche : [...] sa couleur, sa figure, sa grandeur sont apparentes ;
il est dur, il est froid [...].
Mais voici que, cependant que je parle,
on l'approche du feu ; ce qui y restait de saveur s'exhale, l'odeur
s'évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur
augmente, il devient liquide, il s'échauffe [...].
La même cire
demeure-t-elle après ce changement ? Il faut avouer qu'elle
demeure, et personne ne le peut nier.
Qu'est-ce donc que l'on
connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction ?
Certes ce ne peut être rien de tout ce que j'y ai remarqué par
l'entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient
sous le goût, ou l'odorat, ou la vue, ou l'attouchement, ou l'ouïe,
se trouvent changées, et cependant la même cire demeure."
DESCARTES
Dans ses Méditations métaphysiques, Descartes expose son
cheminement, partant de la nécessité du doute à la première certitude
du Cogito, suivie par la garantie d'un savoir enfin possible grâce à la
certitude de l'existence de Dieu.
Dans ce passage, extrait de la
Méditation seconde, il n'est pas encore parvenu à cette certitude.
Ainsi, comment un morceau de cire peut-il être encore de la cire, alors
que sous l'action de la chaleur, il change du tout au tout ?
Problématique
Sous leur apparente stabilité, les choses sont changeantes, au point qu'il est difficile d'en dégager des
caractéristiques solides.
Et pourtant, les images diverses par lesquelles je me représente la cire ne sont pas le
fait de l'imagination.
Dès lors, qu'est-ce, finalement, que ce morceau de cire ? Un objet doit toujours être
identique à lui-même pour être dénommé et connu en tant que tel.
Enjeux.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- En quel sens peut-on dire qu'on expérimente avec sa raison ?
- Les sens sans la raison son vides, mais la raison sans les sens est aveugle (Kant)
- Spinoza: La raison oppose-t-elle les hommes plus que les sens ?
- « [...] Il est besoin que nous ayons quelque raison, qui nous enseigne que nous devons en cette rencontre nous fier plutôt au jugement que nous faisons en suite de l'attouchement, qu'à celui où semble nous porter le sens de la vue. » Descartes, Réponses
- Rousseau: Où chercher la vérité : dans les sens ou dans la raison ?