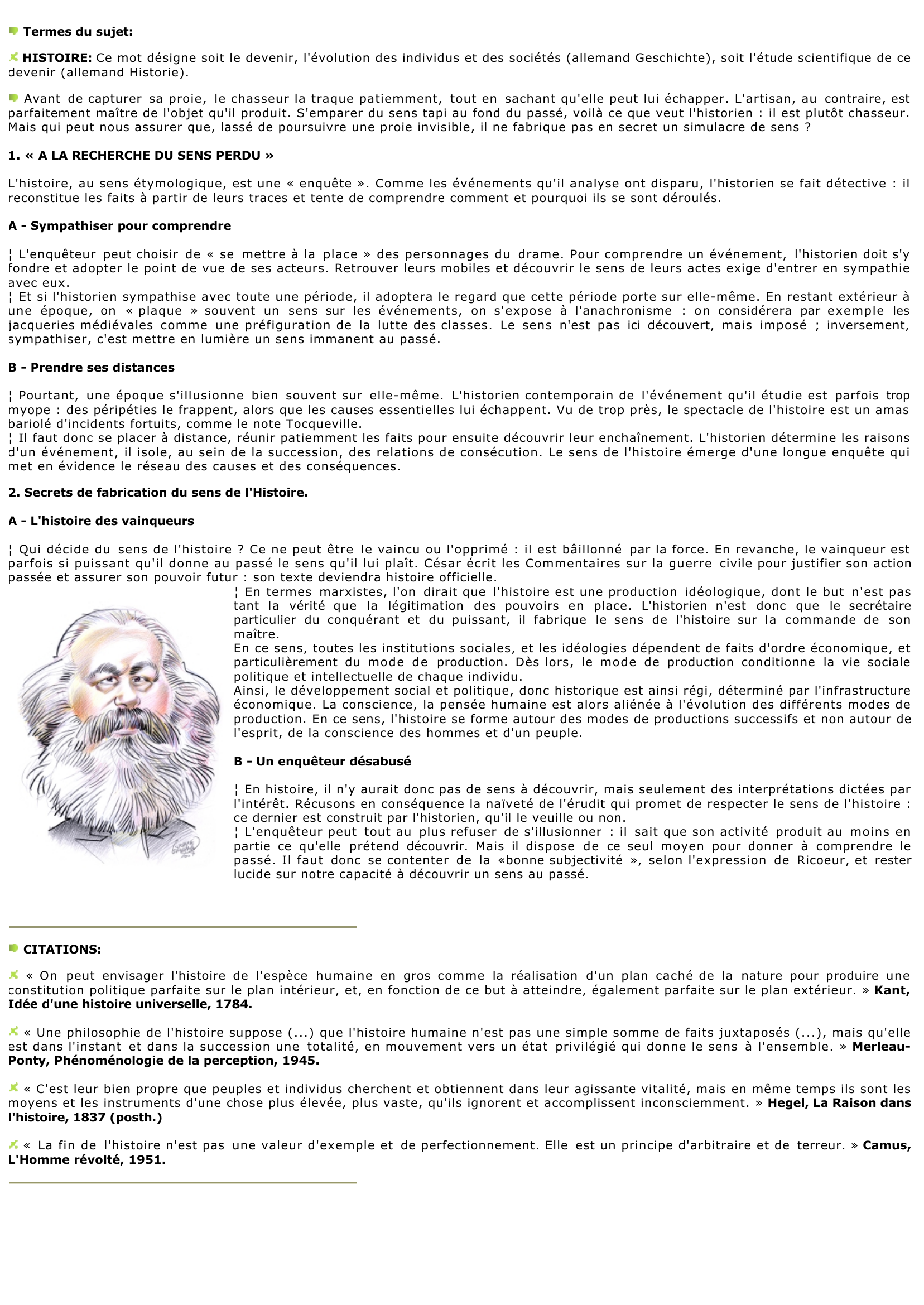Découvre-t-on ou fabrique-t-on le sens de l'Histoire ?
Extrait du document
«
Termes du sujet:
HISTOIRE: Ce mot désigne soit le devenir, l'évolution des individus et des sociétés (allemand Geschichte), soit l'étude scientifique de ce
devenir (allemand Historie).
Avant de capturer sa proie, le chasseur la traque patiemment, tout en sachant qu'elle peut lui échapper.
L'artisan, au contraire, est
parfaitement maître de l'objet qu'il produit.
S'emparer du sens tapi au fond du passé, voilà ce que veut l'historien : il est plutôt chasseur.
Mais qui peut nous assurer que, lassé de poursuivre une proie invisible, il ne fabrique pas en secret un simulacre de sens ?
1.
« A LA RECHERCHE DU SENS PERDU »
L'histoire, au sens étymologique, est une « enquête ».
Comme les événements qu'il analyse ont disparu, l'historien se fait détective : il
reconstitue les faits à partir de leurs traces et tente de comprendre comment et pourquoi ils se sont déroulés.
A - Sympathiser pour comprendre
¦ L'enquêteur peut choisir de « se mettre à la place » des personnages du drame.
Pour comprendre un événement, l'historien doit s'y
fondre et adopter le point de vue de ses acteurs.
Retrouver leurs mobiles et découvrir le sens de leurs actes exige d'entrer en sympathie
avec eux.
¦ Et si l'historien sympathise avec toute une période, il adoptera le regard que cette période porte sur elle-même.
En restant extérieur à
une époque, on « plaque » souvent un sens sur les événements, on s'expose à l'anachronisme : on considérera par exemple les
jacqueries médiévales comme une préfiguration de la lutte des classes.
Le sens n'est pas ici découvert, mais imposé ; inversement,
sympathiser, c'est mettre en lumière un sens immanent au passé.
B - Prendre ses distances
¦ Pourtant, une époque s'illusionne bien souvent sur elle-même.
L'historien contemporain de l'événement qu'il étudie est parfois trop
myope : des péripéties le frappent, alors que les causes essentielles lui échappent.
Vu de trop près, le spectacle de l'histoire est un amas
bariolé d'incidents fortuits, comme le note Tocqueville.
¦ Il faut donc se placer à distance, réunir patiemment les faits pour ensuite découvrir leur enchaînement.
L'historien détermine les raisons
d'un événement, il isole, au sein de la succession, des relations de consécution.
Le sens de l'histoire émerge d'une longue enquête qui
met en évidence le réseau des causes et des conséquences.
2.
Secrets de fabrication du sens de l'Histoire.
A - L'histoire des vainqueurs
¦ Qui décide du sens de l'histoire ? Ce ne peut être le vaincu ou l'opprimé : il est bâillonné par la force.
En revanche, le vainqueur est
parfois si puissant qu'il donne au passé le sens qu'il lui plaît.
César écrit les Commentaires sur la guerre civile pour justifier son action
passée et assurer son pouvoir futur : son texte deviendra histoire officielle.
¦ En termes marxistes, l'on dirait que l'histoire est une production idéologique, dont le but n'est pas
tant la vérité que la légitimation des pouvoirs en place.
L'historien n'est donc que le secrétaire
particulier du conquérant et du puissant, il fabrique le sens de l'histoire sur la commande de son
maître.
En ce sens, toutes les institutions sociales, et les idéologies dépendent de faits d'ordre économique, et
particulièrement du mode d e production.
Dès lors, le mode de production conditionne la vie sociale
politique et intellectuelle de chaque individu.
Ainsi, le développement social et politique, donc historique est ainsi régi, déterminé par l'infrastructure
économique.
La conscience, la pensée humaine est alors aliénée à l'évolution des différents modes de
production.
En ce sens, l'histoire se forme autour des modes de productions successifs et non autour de
l'esprit, de la conscience des hommes et d'un peuple.
B - Un enquêteur désabusé
¦ En histoire, il n'y aurait donc pas de sens à découvrir, mais seulement des interprétations dictées par
l'intérêt.
Récusons en conséquence la naïveté de l'érudit qui promet de respecter le sens de l'histoire :
ce dernier est construit par l'historien, qu'il le veuille ou non.
¦ L'enquêteur peut tout au plus refuser de s'illusionner : il sait que son activité produit au moins en
partie ce qu'elle prétend découvrir.
Mais il dispose d e ce seul moyen pour donner à comprendre le
passé.
Il faut donc se contenter de la «bonne subjectivité », selon l'expression de Ricoeur, et rester
lucide sur notre capacité à découvrir un sens au passé.
CITATIONS:
« On peut envisager l'histoire de l'espèce humaine en gros comme la réalisation d'un plan caché de la nature pour produire une
constitution politique parfaite sur le plan intérieur, et, en fonction de ce but à atteindre, également parfaite sur le plan extérieur.
» Kant,
Idée d'une histoire universelle, 1784.
« Une philosophie de l'histoire suppose (...) que l'histoire humaine n'est pas une simple somme de faits juxtaposés (...), mais qu'elle
est dans l'instant et dans la succession une totalité, en mouvement vers un état privilégié qui donne le sens à l'ensemble.
» MerleauPonty, Phénoménologie de la perception, 1945.
« C'est leur bien propre que peuples et individus cherchent et obtiennent dans leur agissante vitalité, mais en même temps ils sont les
moyens et les instruments d'une chose plus élevée, plus vaste, qu'ils ignorent et accomplissent inconsciemment.
» Hegel, La Raison dans
l'histoire, 1837 (posth.)
« La fin de l'histoire n'est pas une valeur d'exemple et de perfectionnement.
Elle est un principe d'arbitraire et de terreur.
» Camus,
L'Homme révolté, 1951..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il renoncer à l'idée que l'histoire possède un sens ?
- Faut-il présumer que l'histoire a un sens ?
- L'histoire a t-elle un sens et une finalité ?
- Est ce que les actions humaines donnent un sens à l'histoire ?
- L'action politique peut-elle trouver son sens et sa justification dans l'histoire ?