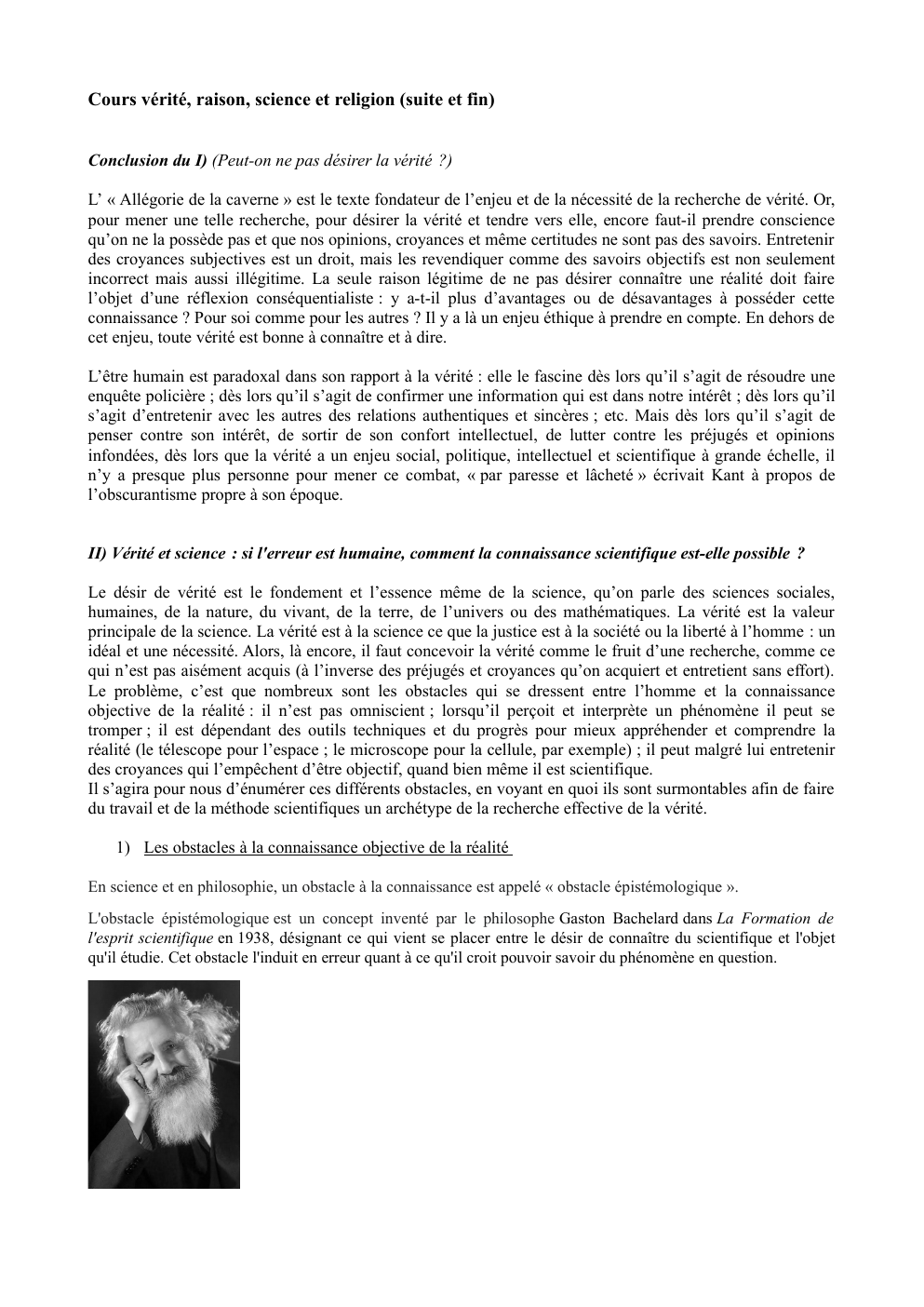Cours vérité, raison, science et religion (suite et fin)
Publié le 19/02/2025
Extrait du document
«
Cours vérité, raison, science et religion (suite et fin)
Conclusion du I) (Peut-on ne pas désirer la vérité ?)
L’ « Allégorie de la caverne » est le texte fondateur de l’enjeu et de la nécessité de la recherche de vérité.
Or,
pour mener une telle recherche, pour désirer la vérité et tendre vers elle, encore faut-il prendre conscience
qu’on ne la possède pas et que nos opinions, croyances et même certitudes ne sont pas des savoirs.
Entretenir
des croyances subjectives est un droit, mais les revendiquer comme des savoirs objectifs est non seulement
incorrect mais aussi illégitime.
La seule raison légitime de ne pas désirer connaître une réalité doit faire
l’objet d’une réflexion conséquentialiste : y a-t-il plus d’avantages ou de désavantages à posséder cette
connaissance ? Pour soi comme pour les autres ? Il y a là un enjeu éthique à prendre en compte.
En dehors de
cet enjeu, toute vérité est bonne à connaître et à dire.
L’être humain est paradoxal dans son rapport à la vérité : elle le fascine dès lors qu’il s’agit de résoudre une
enquête policière ; dès lors qu’il s’agit de confirmer une information qui est dans notre intérêt ; dès lors qu’il
s’agit d’entretenir avec les autres des relations authentiques et sincères ; etc.
Mais dès lors qu’il s’agit de
penser contre son intérêt, de sortir de son confort intellectuel, de lutter contre les préjugés et opinions
infondées, dès lors que la vérité a un enjeu social, politique, intellectuel et scientifique à grande échelle, il
n’y a presque plus personne pour mener ce combat, « par paresse et lâcheté » écrivait Kant à propos de
l’obscurantisme propre à son époque.
II) Vérité et science : si l'erreur est humaine, comment la connaissance scientifique est-elle possible ?
Le désir de vérité est le fondement et l’essence même de la science, qu’on parle des sciences sociales,
humaines, de la nature, du vivant, de la terre, de l’univers ou des mathématiques.
La vérité est la valeur
principale de la science.
La vérité est à la science ce que la justice est à la société ou la liberté à l’homme : un
idéal et une nécessité.
Alors, là encore, il faut concevoir la vérité comme le fruit d’une recherche, comme ce
qui n’est pas aisément acquis (à l’inverse des préjugés et croyances qu’on acquiert et entretient sans effort).
Le problème, c’est que nombreux sont les obstacles qui se dressent entre l’homme et la connaissance
objective de la réalité : il n’est pas omniscient ; lorsqu’il perçoit et interprète un phénomène il peut se
tromper ; il est dépendant des outils techniques et du progrès pour mieux appréhender et comprendre la
réalité (le télescope pour l’espace ; le microscope pour la cellule, par exemple) ; il peut malgré lui entretenir
des croyances qui l’empêchent d’être objectif, quand bien même il est scientifique.
Il s’agira pour nous d’énumérer ces différents obstacles, en voyant en quoi ils sont surmontables afin de faire
du travail et de la méthode scientifiques un archétype de la recherche effective de la vérité.
1) Les obstacles à la connaissance objective de la réalité
En science et en philosophie, un obstacle à la connaissance est appelé « obstacle épistémologique ».
L'obstacle épistémologique est un concept inventé par le philosophe Gaston Bachelard dans La Formation de
l'esprit scientifique en 1938, désignant ce qui vient se placer entre le désir de connaître du scientifique et l'objet
qu'il étudie.
Cet obstacle l'induit en erreur quant à ce qu'il croit pouvoir savoir du phénomène en question.
Ecartant, sans les nier, les obstacles externes (complexité des phénomènes, manque d’instruments de mesure)
et les obstacles liés à la physiologie de l’être humain, Bachelard porte son regard sur le principal obstacle :
l’obstacle présent « dans l’acte même de connaître » puisque c'est l'esprit qui imagine des explications aux
choses.
« Une connaissance n’est jamais construite dans un désert.
Elle doit lutter contre les connaissances usuelles,
établies.
Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune.
Il est même très vieux, car
il a l’âge de ses préjugés.
Accéder à la science, c’est spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation
brusque qui doit contredire un passé ».
Penser rationnellement, scientifiquement, n’est pas un processus spontané de l’être humain.
Cela ne peut se
faire qu’après avoir surmonté un certain nombre d’obstacles épistémologiques.
-
Les sensations, la perception et l’interprétation.
Le premier obstacle épistémologique à surmonter, selon Bachelard, est l’observation elle-même, ce qu’il
nomme « perception immédiate » ou « expérience première » et conteste comme instrument fiable de
connaissance.
L’expérience première est l’expérience sensible et perceptive.
La perception est une faculté, c’est elle qui nous permet de connaître le monde qui nous entoure grâce aux
informations transmises par nos organes sensoriels.
Percevoir consiste à recueillir les données qui
proviennent des sens et à en faire la synthèse par un acte du cerveau, le plus souvent inconsciemment et
immédiatement (exemple : j’entends un coup de feu, je perçois instantanément un danger).
La perception
constitue donc le rapport premier que l’homme entretient avec le monde extérieur.
En ce sens, elle est le
préalable à toute connaissance, mais aussi à toute erreur puisque percevoir, c’est interpréter, et interpréter
c’est prendre le risque de se tromper (ce coup de feu ne signifie pas nécessairement un danger mais c’est
ainsi que je l’ai perçu).
Il importe de bien distinguer la sensation de la perception.
La sensation, c'est l'impression brute reçue par l'un
de nos cinq sens (la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût).
C'est une information sensorielle transmise au
cerveau par l'intermédiaire des nerfs.
On peut ainsi avoir une sensation de chaud, de froid, de couleur, de
son.
Dans la sensation, le sujet est passif, il reçoit simplement une impression mais ne l’analyse pas.
C’est la
conscience spontanée qui sent, ce n’est pas la conscience réflexive (qui elle analyse et donc perçoit puis
interprète).
La perception est l'étape suivante : c'est le jugement qu'un individu va produire sur une sensation.
Par
exemple, on va croiser le regard d’une personne (simple sensation visuelle) et on va y percevoir de
l’animosité ou au contraire de la bienveillance.
Ainsi, pour qu'il y ait perception, il faut qu'il y ait un individu
conscient, c'est-à-dire qui puisse faire retour sur ses sensations et les analyser.
Percevoir ne se réduit donc
pas à recevoir passivement des sensations, percevoir, c’est être actif, la perception est un acte contrairement à
la sensation.
Deux obstacles épistémologiques se posent ici, c’est-à-dire obstacles à la connaissance objective de la réalité.
D’une part, nos sens peuvent nous tromper, nous menant à une perception et interprétation erronées d’une
sensation.
Les 5 sens ne sont pas des récepteurs neutres.
Ils induisent une certaine manière de construire le réel.
Ainsi l’équipement sensoriel variant d’une espèce animale à une autre, chaque espèce ne perçoit pas le réel de la
même manière.
Par exemple, la chauve souris bâtit son monde à partir d’ultra sons pour lesquels nous n’avons pas
d’organes récepteurs.
Ce que la différence homme/animal révèle, les différences d’homme à homme le montrent
aussi car la construction de l’objet dépend de nombreux paramètres.
Les myopes en font l’expérience chaque
jour, sans lunettes ou lentilles, un phénomène vu peut être perçu tel qu’il n’est pas (je crois voir une araignée
sur le mur de ma chambre alors que c’est une tâche…).
Illusions d’optique (je crois voir une oasis dans le
désert), auditives (je crois entendre tel mot dans une chanson), olfactives (je crois sentir un parfum alors qu’il
n’existe que dans ma mémoire), gustatives (si vous regardez top chef et l’épisode de la boîte noire vous
comprendrez) : autant de situations lors desquelles nos sens, malgré nous, nous induisent dans des erreurs
d’interprétation.
Sans parler du fait que nous ne possédons après tout « que » cinq sens alors que la réalité,
pour être entièrement connue, nécessite d’en posséder beaucoup plus.
Certes, nous sommes à l’heure actuelle
capable de reproduire de façon artificielle, grâce à la technique, des sens que certains animaux possèdent que
nous ne possédons pas (le sonar par exemple), mais nous restons, en raison de notre constitution biologique,
profondément démuni face à la réalité qui ne se laisse pas si facilement connaître.
D’autre part, dans la mesure où la perception inclut une forme de jugement, elle pose la question de
l'interprétation des données perçues et du degré d'objectivité de cette interprétation.
Puisque c’est un sujet
singulier qui perçoit, au nom de quoi peut-il prétendre à l’universalité de son jugement ? Comment être
certain que ce que je perçois, tout le monde le perçoit de la même façon, et que mon interprétation sera
partagée par tous ? Là où je perçois un danger suite à un coup de feu, une autre personne – moins anxieuse –
ne percevra-t-elle pas simplement des enfants qui jouent avec des pétards ?
On le voit, l'accès qu'un individu conscient a au monde extérieur dépend entièrement de son individualité, de
sa personnalité, de son éducation, de son environnement, de son expérience personnelle, etc.
Certaines....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- vérité cours
- Science & Vérité: La science doit-elle donner des certitudes ?
- raison et vérité
- Dissertation philosophie Bertrand Russell in Science et Religion: la conscience
- La science dit-elle la vérité ?