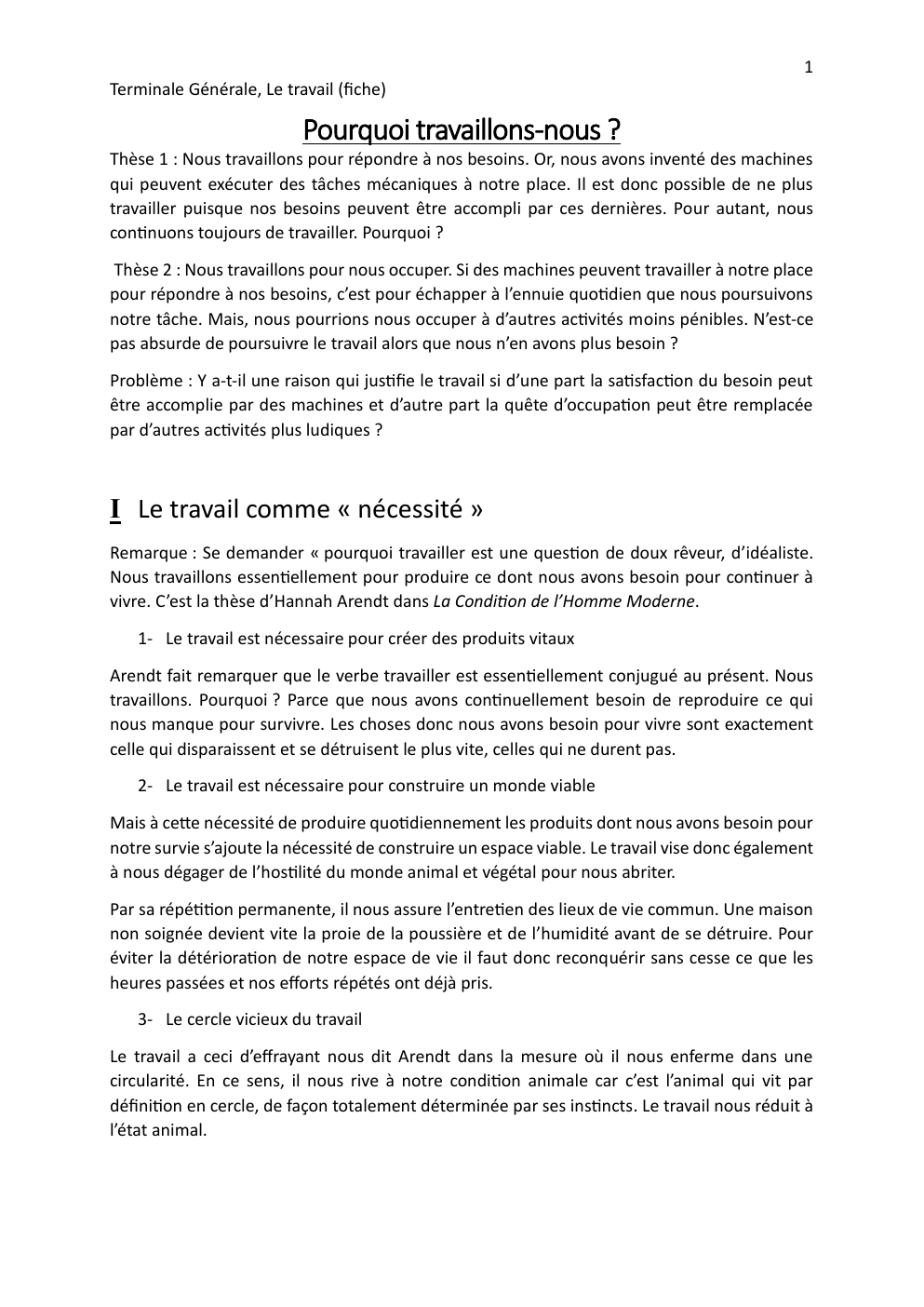Cours Travail Terminale Philosophie
Publié le 16/04/2025
Extrait du document
«
1
Terminale Générale, Le travail (fiche)
Pourquoi travaillons-nous ?
Thèse 1 : Nous travaillons pour répondre à nos besoins.
Or, nous avons inventé des machines
qui peuvent exécuter des tâches mécaniques à notre place.
Il est donc possible de ne plus
travailler puisque nos besoins peuvent être accompli par ces dernières.
Pour autant, nous
continuons toujours de travailler.
Pourquoi ?
Thèse 2 : Nous travaillons pour nous occuper.
Si des machines peuvent travailler à notre place
pour répondre à nos besoins, c’est pour échapper à l’ennuie quotidien que nous poursuivons
notre tâche.
Mais, nous pourrions nous occuper à d’autres activités moins pénibles.
N’est-ce
pas absurde de poursuivre le travail alors que nous n’en avons plus besoin ?
Problème : Y a-t-il une raison qui justifie le travail si d’une part la satisfaction du besoin peut
être accomplie par des machines et d’autre part la quête d’occupation peut être remplacée
par d’autres activités plus ludiques ?
I Le travail comme « nécessité »
Remarque : Se demander « pourquoi travailler est une question de doux rêveur, d’idéaliste.
Nous travaillons essentiellement pour produire ce dont nous avons besoin pour continuer à
vivre.
C’est la thèse d’Hannah Arendt dans La Condition de l’Homme Moderne.
1- Le travail est nécessaire pour créer des produits vitaux
Arendt fait remarquer que le verbe travailler est essentiellement conjugué au présent.
Nous
travaillons.
Pourquoi ? Parce que nous avons continuellement besoin de reproduire ce qui
nous manque pour survivre.
Les choses donc nous avons besoin pour vivre sont exactement
celle qui disparaissent et se détruisent le plus vite, celles qui ne durent pas.
2- Le travail est nécessaire pour construire un monde viable
Mais à cette nécessité de produire quotidiennement les produits dont nous avons besoin pour
notre survie s’ajoute la nécessité de construire un espace viable.
Le travail vise donc également
à nous dégager de l’hostilité du monde animal et végétal pour nous abriter.
Par sa répétition permanente, il nous assure l’entretien des lieux de vie commun.
Une maison
non soignée devient vite la proie de la poussière et de l’humidité avant de se détruire.
Pour
éviter la détérioration de notre espace de vie il faut donc reconquérir sans cesse ce que les
heures passées et nos efforts répétés ont déjà pris.
3- Le cercle vicieux du travail
Le travail a ceci d’effrayant nous dit Arendt dans la mesure où il nous enferme dans une
circularité.
En ce sens, il nous rive à notre condition animale car c’est l’animal qui vit par
définition en cercle, de façon totalement déterminée par ses instincts.
Le travail nous réduit à
l’état animal.
2
Terminale Générale, Le travail (fiche)
En ce sens, seul l’action singulière et originale forme le propre de l’homme.
L’action héroïque
est unique en ce sens qu’elle fait date.
Contrairement au travail, elle sort de l’ordinaire.
Mais Arendt va plus loin encore.
Elle estime que, pour autant, le travail humble est répété est
plus héroïque que l’action unique.
Il y a plus d’héroïsme à poursuivre continuellement un
travail laborieux et répétitif que d’agir spontanément pour marquer l’histoire.
Le propre du travail réside donc dans son inachèvement permanent.
On ne travaille donc pas
pour son épanouissement (« vivre heureux »), ni même pour « bien vivre », mais
fondamentalement pour « vivre ».
II Le travail comme « fatalité »
1- Le travail est un combat contre la mort
Que faisons-nous lorsque nous travaillons ? Nous luttons contre la mort.
Nous luttons pour
vivre et même plus radicalement pour survivre.
C’est l’idée que défend Michel Foucault dans
Les mots et les choses.
Pour lui, la nécessité du travail trouve son enracinement dans
l’économie.
Or, qu’est-ce que l’économie ? L’économie n’est pas le lieu de l’abondance centré
sur le désir.
C’est avant tout le lieu du besoin.
L’économie est le lieu de la rareté.
C’est parce
que les biens sont rares qu’il faut économiser.
Michel Foucault nous invite donc à redécouvrir le sens de l’économie comme acte de
conservation et non comme consommation.
Or, cet acte de conservation est paradoxal.
Nous
préservons nos ressources pour éviter la mort.
Nous travaillons pour conserver ce qui nous
permet d’échapper à la mort.
Il y a là quelque chose d’absurde.
Nous luttons contre quelque
chose d’inévitable : nous allons mourir.
Nous ne faisons, dans le travail, que reporter la date
de notre propre mort.
C’est un combat désespéré qui, dans le fond, est absurdre.
2- Le travail est une malédiction
Cette absurdité du travail est peut-être lié à son origine ou peut trouver une réponse dans
l’examen de son origine.
Et, en ce sens, les mythes sont très utiles pour comprendre la
malédiction liée au travail.
C’est le cas par exemple d’Hésiode dans Les travaux et les jours qui raconte comment les dieux
se sont vengés des hommes une fois que Prométhée leur a dérobé le feu sacré pour l’offrir aux
hommes afin qu’il puisse œuvre avec technique.
C’est le passage célèbre de la boîte de
Pandore contenant la pénibilité qui vient s’ajouter au travail.
Avant cela, les hommes
travaillaient avec aisance aidés par la technique.
Désormais, même l’aide de la technique
n’évite pas la peine au travail.
Cette peine apparaît donc comme la conséquence d’un acte de
transgression à l’égard des dieux, une punition, un châtiment qui vient réduire l’orgueil des
hommes (hubris) à néant.
Dans la Bible on trouve la même logique de punition.
Le travail devient pénible à cause de la
faute humaine (le péché originel).
Mais, la malédiction en tombe pas sur les hommes (au
contraire, ils reçoivent l’annonce d’un sauveur à venir).
La malédiction tombe sur le sol : « le
sol sera maudit à cause de toi.
C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les
3
Terminale Générale, Le travail (fiche)
jours de ta vie » (Genèse, 3 ; 17).
Le travail devient pénible à cause de la méchanceté du cœur
humain, mais il devient également condition de son salut.
3- L’impact des révolutions mécaniques et numériques
a) Le travail avant les révolutions : la mise à distance de nos propres besoins.
Hegel, dans la Phénoménologie de l’Esprit, défend l’idée selon laquelle le travail est le moment
de la mise à distance de nos besoins parce que lorsque nous travaillons nous reportons le
moment de la consommation et du plaisir pour assumer la peine du labeur.
Qu’est-ce que le travail ? Le contraire de la consommation.
Or, la consommation consiste dans
l’acte de négation qui détruit l’objet.
Le sujet nie l’objet en l’intégrant à soi.
Le morceau de pain
devient notre propre chair.
Il y a transsubstantiation (changement de substance).
La
consommation est donc pure négation.
À l’inverse, la production dans le travail est création.
Non seulement le sujet produit l’objet
mais il le produit ne reportant sur lui la négativité de l’effort.
Ce n’est plus l’objet qui est nié et
détruit c’est le sujet qui se nie en supportant la peine et la fatigue du travail : « on se tue à la
tâche ».
D’où le paradoxe du travail : on se tue à la tâche pour vivre.
On se détruit à l’ouvrage pour
survivre plus longtemps.
C’est absurde.
Ceci explique les innombrables recherches de l’homme en faveur des innovations permettant
de réduire cette peine et si possible de se faire remplacer dans le travail
b) La technique (révolution mécanique)
Si le travail est usant, alors l’homme cherche à réduire cette usure.
C’est le propre des
innovations techniques.
L’outil, dans un premier temps, se présente comme un instrument qui s’interpose entre
l’homme et la matière.
Il réduit la peine du travail en se détruisant à la place de l’homme.
Mais, si l’homme ne se détruit plus aussi radicalement en usant de l’outil, il se fatigue toujours.
D’où la machine.
Ce système mécanisé et automatisé permet tout simplement de retourner la
nature contre elle-même en remplaçant le sujet/l’homme.
C’est le principe de la technique
comme ruse.
L’homme échappe au travail en laissant la nature œuvrer contre elle-même.
(ex :
moulin à vent qui moud le grain).
Ainsi, le principe de l’innovation technique repose sur la paresse humaine.
Ceci permet de
soutenir la possibilité de la fin de travail en soi.
La machine peut nous remplacer
définitivement.
c) La Révolution numérique
Les machines peuvent désormais remplacer le travail humain.
Pourtant, l’homme continue à
travailler et à vouloir travailler quitte à créer des métiers qui n’ont aucun sens (cf.
David
Graeber, les « bullshit jobs »).
4
Terminale Générale, Le travail (fiche)
Paradoxe : nous sommes dans un monde où les machines peuvent travailler à notre place et
pourtant nous continuons de travailler.
Et nous travaillons peut-être même plus.
Pourquoi ?
III Le travail comme « occupation »
1- Le divertissement du travail
Si malgré la possibilité de ne plus travailler, nous travaillons encore c’est sans doute pour nous
occuper.
Nous avons peur du temps libre.
Ce temps libre nous effraie car, indubitablement, il
nous permet de penser à nous même et cette pensée s’avère douloureuse.
C’est la thèse que l’on peut défendre....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La philosophie contemporaine (cours)
- Philo (cours rédigé) - Toutes les notions du programme de Terminale
- Le langage (cours de philosophie) - version finale
- La Vérité (cours complet de philosophie)
- cours philosophie sur la nature