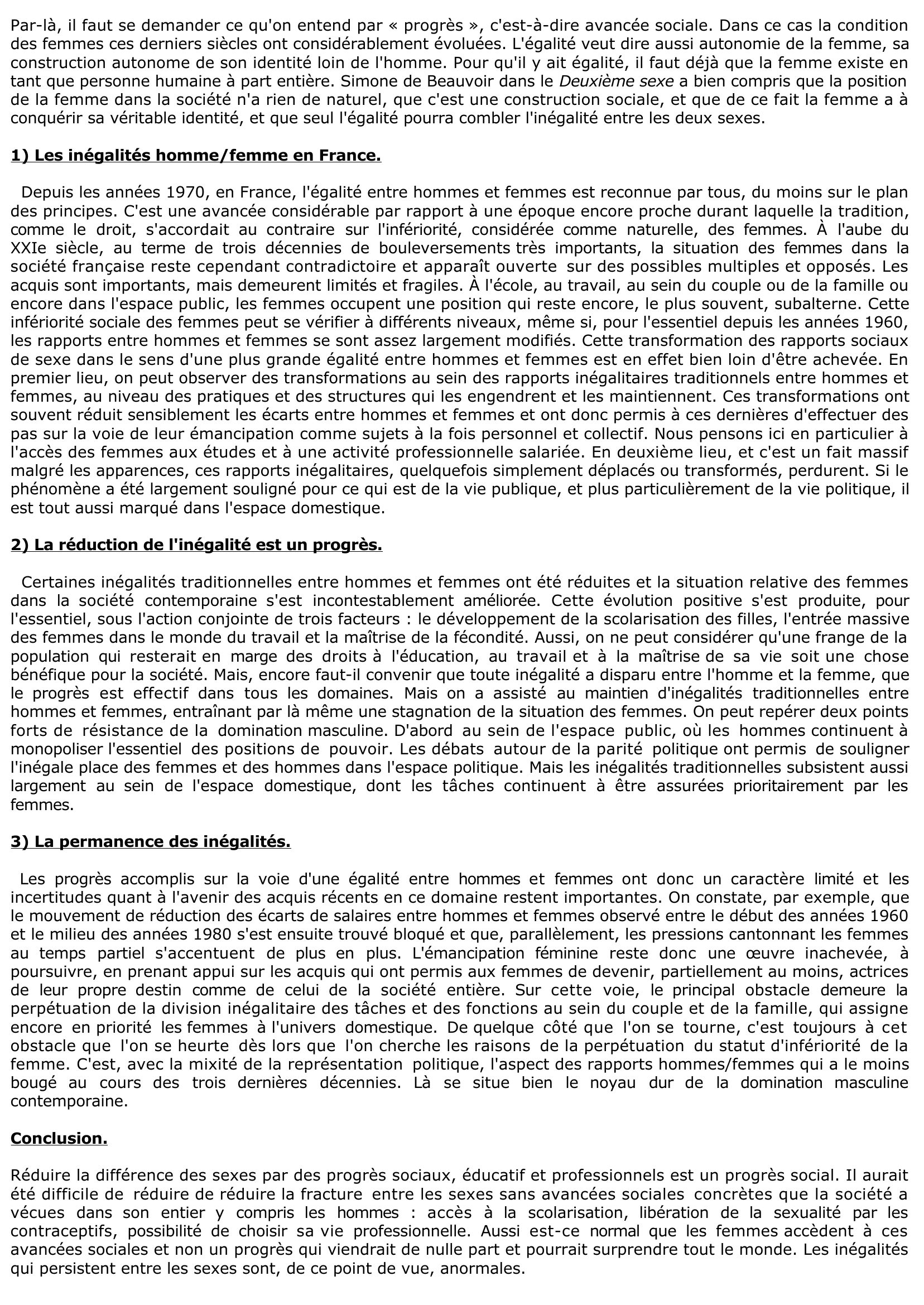Considérez-vous que l'égalité entre l'homme et la femme constitue un progrès ?
Extrait du document
«
Par-là, il faut se demander ce qu'on entend par « progrès », c'est-à-dire avancée sociale.
Dans ce cas la condition
des femmes ces derniers siècles ont considérablement évoluées.
L'égalité veut dire aussi autonomie de la femme, sa
construction autonome de son identité loin de l'homme.
Pour qu'il y ait égalité, il faut déjà que la femme existe en
tant que personne humaine à part entière.
Simone de Beauvoir dans le Deuxième sexe a bien compris que la position
de la femme dans la société n'a rien de naturel, que c'est une construction sociale, et que de ce fait la femme a à
conquérir sa véritable identité, et que seul l'égalité pourra combler l'inégalité entre les deux sexes.
1) Les inégalités homme/femme en France.
Depuis les années 1970, en France, l'égalité entre hommes et femmes est reconnue par tous, du moins sur le plan
des principes.
C'est une avancée considérable par rapport à une époque encore proche durant laquelle la tradition,
comme le droit, s'accordait au contraire sur l'infériorité, considérée comme naturelle, des femmes.
À l'aube du
XXIe siècle, au terme de trois décennies de bouleversements très importants, la situation des femmes dans la
société française reste cependant contradictoire et apparaît ouverte sur des possibles multiples et opposés.
Les
acquis sont importants, mais demeurent limités et fragiles.
À l'école, au travail, au sein du couple ou de la famille ou
encore dans l'espace public, les femmes occupent une position qui reste encore, le plus souvent, subalterne.
Cette
infériorité sociale des femmes peut se vérifier à différents niveaux, même si, pour l'essentiel depuis les années 1960,
les rapports entre hommes et femmes se sont assez largement modifiés.
Cette transformation des rapports sociaux
de sexe dans le sens d'une plus grande égalité entre hommes et femmes est en effet bien loin d'être achevée.
En
premier lieu, on peut observer des transformations au sein des rapports inégalitaires traditionnels entre hommes et
femmes, au niveau des pratiques et des structures qui les engendrent et les maintiennent.
Ces transformations ont
souvent réduit sensiblement les écarts entre hommes et femmes et ont donc permis à ces dernières d'effectuer des
pas sur la voie de leur émancipation comme sujets à la fois personnel et collectif.
Nous pensons ici en particulier à
l'accès des femmes aux études et à une activité professionnelle salariée.
En deuxième lieu, et c'est un fait massif
malgré les apparences, ces rapports inégalitaires, quelquefois simplement déplacés ou transformés, perdurent.
Si le
phénomène a été largement souligné pour ce qui est de la vie publique, et plus particulièrement de la vie politique, il
est tout aussi marqué dans l'espace domestique.
2) La réduction de l'inégalité est un progrès.
Certaines inégalités traditionnelles entre hommes et femmes ont été réduites et la situation relative des femmes
dans la société contemporaine s'est incontestablement améliorée.
Cette évolution positive s'est produite, pour
l'essentiel, sous l'action conjointe de trois facteurs : le développement de la scolarisation des filles, l'entrée massive
des femmes dans le monde du travail et la maîtrise de la fécondité.
Aussi, on ne peut considérer qu'une frange de la
population qui resterait en marge des droits à l'éducation, au travail et à la maîtrise de sa vie soit une chose
bénéfique pour la société.
Mais, encore faut-il convenir que toute inégalité a disparu entre l'homme et la femme, que
le progrès est effectif dans tous les domaines.
Mais on a assisté au maintien d'inégalités traditionnelles entre
hommes et femmes, entraînant par là même une stagnation de la situation des femmes.
On peut repérer deux points
forts de résistance de la domination masculine.
D'abord au sein de l'espace public, où les hommes continuent à
monopoliser l'essentiel des positions de pouvoir.
Les débats autour de la parité politique ont permis de souligner
l'inégale place des femmes et des hommes dans l'espace politique.
Mais les inégalités traditionnelles subsistent aussi
largement au sein de l'espace domestique, dont les tâches continuent à être assurées prioritairement par les
femmes.
3) La permanence des inégalités.
Les progrès accomplis sur la voie d'une égalité entre hommes et femmes ont donc un caractère limité et les
incertitudes quant à l'avenir des acquis récents en ce domaine restent importantes.
On constate, par exemple, que
le mouvement de réduction des écarts de salaires entre hommes et femmes observé entre le début des années 1960
et le milieu des années 1980 s'est ensuite trouvé bloqué et que, parallèlement, les pressions cantonnant les femmes
au temps partiel s'accentuent de plus en plus.
L'émancipation féminine reste donc une œuvre inachevée, à
poursuivre, en prenant appui sur les acquis qui ont permis aux femmes de devenir, partiellement au moins, actrices
de leur propre destin comme de celui de la société entière.
Sur cette voie, le principal obstacle demeure la
perpétuation de la division inégalitaire des tâches et des fonctions au sein du couple et de la famille, qui assigne
encore en priorité les femmes à l'univers domestique.
De quelque côté que l'on se tourne, c'est toujours à cet
obstacle que l'on se heurte dès lors que l'on cherche les raisons de la perpétuation du statut d'infériorité de la
femme.
C'est, avec la mixité de la représentation politique, l'aspect des rapports hommes/femmes qui a le moins
bougé au cours des trois dernières décennies.
Là se situe bien le noyau dur de la domination masculine
contemporaine.
Conclusion.
Réduire la différence des sexes par des progrès sociaux, éducatif et professionnels est un progrès social.
Il aurait
été difficile de réduire de réduire la fracture entre les sexes sans avancées sociales concrètes que la société a
vécues dans son entier y compris les hommes : accès à la scolarisation, libération de la sexualité par les
contraceptifs, possibilité de choisir sa vie professionnelle.
Aussi est-ce normal que les femmes accèdent à ces
avancées sociales et non un progrès qui viendrait de nulle part et pourrait surprendre tout le monde.
Les inégalités
qui persistent entre les sexes sont, de ce point de vue, anormales..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- ROUSSEAU: «Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire, et
- « Deuxièmement, l'homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu'il est poussé à se trouver lui-même, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement, dans ce qui s'offre à lui extérieurement. » Hegel, Esthétique, 1832
- Les philosophes classiques pensaient que la connaissance de soi-même conduirait à la libération de la personne ; or, les progrès de la psychologie ont souvent pour conséquence pratique le conditionnement de l'homme par l'homme. Une telle évolution est-el
- ROUSSEAU: «Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire, et les vastes forê
- Le progrès technique est-il favorable au déploiement de l'homme ?